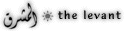
|
|
Association "Pour une Fondation des Villes et Territoires
Méditerranéens" Rencontres Méditerranéennes de la Ville Séminaires préparatoires
Séminaire "Ville et Territoires" Aix-en-Provence, 16-17 décembre 1994
Centre et Centralités à Beyrouth, 1850-1995
Michael F. DAVIE[*]
L'espace de la ville est l'expression de modes de production particuliers et de pratiques sociales, bien cernés dans le temps, qui ont généré des espaces vitaux à leur survie ou reproduction. Ces centralités (économiques, politiques, sociales), sont autant l'expressions de stratégies d'acteurs dans des contextes géopolitiques précis.
Cette contribution se propose de démontrer que les déplacements des lieux d'installation de fonctions centrales à l'économie et aux réseaux de la ville de Beyrouth (et donc ceux de sa "centralité") ne sont que l'expression spatiale de phénomènes conjoncturels variés. La centralité beyrouthine, loin de se focaliser en un seul lieu par une accumulation progressive d'attributs, s'est déplacée selon des contextes géopolitiques.
Beyrouth n'est pas la seule ville en Méditerranée orientale à offrir une multiplicité de centralités conjoncturelles: des similitudes se manifestent en Syrie, en Palestine/Israël, à Chypre, en Turquie.
1) La ville arabe
Beyrouth était, au début du XIXème siècle, un centre secondaire dans le réseau urbain ottoman s'auto-gérant par l'action combinée des religieux, des notables et des marchands. L'espace commercial (les souks) et l'espace politique se confondaient dans le cadre étroit de la ville intra-muros, et la centralité de Beyrouth était la ville elle-même, expression aussi de la faiblesse de ses réseaux extra-muros. On pouvait certes identifier des espaces forts articulés autour de lieux cultuels ou professionnels, mais pas un espace central unique à la ville.
2) La ville ottomane modernisée
A partir des années 1860, la ville devient le port privilégié de la pénétration économique européenne au Levant. Les élites locales, marchands et notables, aidés par les possibilités offertes par les Tanzimats, remodèlent la ville en fonction d'impératifs propres: se maintenir comme intermédiaires incontournables entre le monde de production de biens qu'est l'Europe et le monde de consommation du Levant, tout en restant au coeur du système administratif ottoman.
Un schéma général se dégage: d'un côté, un centre où trois centralités s'affirment: le Sérail et ses annexes, le port, et enfin les espaces de commerce, et de l'autre les espaces résidentiels.
3) La ville du Mandat
En 1920, Beyrouth passe sous Mandat français et devient le centre nerveux de l'administration française des territoires dont elle a la responsabilité. Le schéma précédent reste semblable, mais le centre de la ville est remodelée en fonction de la nouvelle conjoncture, entraînant une distribution spatiale nouvelle des centralités et le début de l'éclatement des centralités traditionnelles.
L'activité commerciale et les services s'enferment progressivement dans le cadre étroit de l'économie coloniale. Une nouvelle morphologie urbaine apparaît avec la construction d'un nouveau quartier des affaires à la place des souks de l'ancien régime économique. Beyrouth est annexée à un nouvel État, celui du Grand-Liban, dont elle devient la capitale.
D'où trois centralités à des échelles différentes. En premier lieu, la centralité coloniale, qui fait de Beyrouth le point nodal du réseau économique français mondial. En deuxième lieu, une centralité régionale, politique et administrative et en dernier lieu, la centralité politique du Grand-Liban. Les trois centralités opèrent à partir d'espaces distincts.
4) La capitale de la République
La fin de l'ordre politique et économique français à la fin de la Seconde Guerre Mondiale annonce l'irruption d'un nouvel ordre. Le début des Trente Glorieuses se traduit par l'intégration des capitaux des États producteurs de pétrole dans les circuits financiers du Nord. Beyrouth, et notamment un espace approprié et "moderne" à Hamra est le relais régional de leur gestion. Cet espace devient stratégique; c'est le lieu privilégié de la production des surplus nécessaires à la survie de l'économie nationale et donc du système politique local. Il s'articule sur l'aéroport et les nouvelles technologies de communication.
De l'ancien ordre, on constate le déclin de la place du Centre-Ville dans l'économie nationale et sa une lente désaffection. Cependant, l'espace articulé autour du port maintient un dynamisme certain, car c'est un espace stratégique dans le Moyen-Orient en guerre.
D'où deux centralités, celles du port et de Hamra mais en porte-à-faux par rapport à l'État-Nation en construction.
5) La ville de la guerre
Le début de la guerre civile, en 1975, marque l'anéantissement de toutes les centralités beyrouthines et leur remplacement par d'autres, excentrées, tant aux plans spatial et fonctionnels.
Dans un premier temps, les commerces et les services effectuent un repli vers les espaces péri-centraux, sans pouvoir recréer de véritables centres de rechange. Dans un second temps, de nouveaux espaces se structurent loin des fronts militaires. Cependant, ils sont fortement marqués par des identités confessionnelles ou politiques. Sur la périphérie de la ville, au-delà des limites municipales, émergent une multitude de micro-centralités, surtout le long du littoral. Quant à Hamra, la violence physique, puis l'appropriation de cet espace par des réfugiés ruraux, mettent fin à sa fonction de gestion des capitaux étrangers.
6) La ville de la reconstruction
La fin des combats permet d'envisager la reconstruction de la ville et une réaffirmation, voire une réinvention, de centralités perdues. Les plans de reconstruction semblent indiquer la mise en place, en plein coeur historique de la ville, d'un centre d'affaires et de finances à prétention régionale et mondiale qui absorbera Hamra , mais laissera les micro-centralités confessionnelles périphériques à leur sort. Sur cet espace très limité se concentreront la centralité financière et son appendice, la centralité politique.
Conclusion: une situation banale en Méditerranée orientale?
L'itinéraire spatial de la centralité beyrouthine depuis 150 ans peut surprendre. Il est en effet convenu de concevoir la centralité comme un processus de consolidation progressive, dans le temps long, de fonctions en des lieux peu "mobiles", conférant par cette relative stabilité leur unicité et leur richesse, dont la symbolique. C'est du moins ce que les modèles proposent pour l'Europe.
La Méditerranée orientale semble échapper à ce modèle, les conjonctures étant aussi variées dans le temps que sur des espaces étatiques fragiles. Ainsi, la centralité politique et économique palestinienne, celle de Jérusalem, est perdue en 1948; elle est reconstituée par une centralité israélienne sur d'autres espaces, plus littorales, à Tel-Aviv notamment. Elle se redéfinit progressivement et à nouveau à Jérusalem, notamment après 1967 et s'invente à nouveau avec les Accords d'Autonomie. En Jordanie, l'accession d'un village au rang de capitale, Amman, a imposé une centralité sur un espace inventée de toutes pièces: le Royaume Hachémite. Chypre voit le dédoublement de sa centralité avec le partage de l'île, et de sa capitale Nicosie, en deux territoires antagonistes. Cependant, avec l'urbanisation progressive du littoral, dans sa composante méridionale, la centralité se décale, notamment pour les services et le commerce liés au tourisme. La concurrence entre Ankara et Istanbul pour la centralité turque est bien documentée. La Syrie offre un autre cas de figure, avec de nouvelles centralités, politiques et économiques, qui émergent dans le Jabal `Alaoui, notamment à Lattaquié, fief du Pouvoir en place à Damas.
La diversité des cas et des conjonctures historiques n'autorisent pas une modélisation simple de la "centralité" des espaces urbains de la Méditerranée orientale.
|
 al@mashriq 960325/960614 |