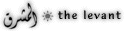
|
|
Colloque "Reconstruire le Liban: espoirs et réalités" Atelier "L'aménagement de Beyrouth ou l'urbanisme en question" Paris, Le Sénat 12 septembre 1994
BEYROUTH: QUELLE CAPITALE POUR QUEL PAYS?
Michael F. DAVIE[*]
La question paraît incongrue: on ne peut en effet concevoir un pays sans sa capitale, et inversement. C'est dans cet espace privilégié, en effet, que s'exprime et se manifeste le Pouvoir étatique, que s'articule l'économie, que s'intégrent les régions périphériques et que les populations identifient comme ville primatiale, le centre du pays, le coeur de la Nation.
Pourtant, au Liban, la question se pose, car la guerre a tué la ville et les réponses conditionnent l'avenir de cet espace urbain et par extension, du Liban tout entier. Beyrouth a-t-elle joué le rôle de capitale avant la guerre, a-t-elle maintenu ce rôle durant le conflit, l'a-t-elle récupéré après les opérations militaires, restera-t-elle capitale? Doit-elle plutôt encore découvrir, puis forger et consolider cette fonction dans le proche futur? Inversement, comment et sous quelle forme faut-il concevoir une capitale pour un pays comme le Liban?
Quelques mots préliminaires sont nécessaires pour clarifier le débat. Qu'entend-t-on par "capitale"? C'est certes un espace de concentration démographique, là où se retrouve une part notable de la population; mais c'est aussi le lieu des prises de décisions politiques et stratégiques. En effet, c'est le lieu d'exercice du Pouvoir national et l'expression des autres pouvoirs politiques, le lieu de la définition des stratégies de quadrillage ou des aménagements du territoire. C'est le centre de commandement et de contrôle. Lieu d'installation des représentations étrangères et des négociations diplomatiques, c'est aussi la façade du pays.
Le "Pays", (le terme "territoire" paraît plus adéquat) nous l'entendons comme un espace physique, limité par des frontières, organisé et géré par un pouvoir, émanant sinon représentant de façon plus ou moins forte les populations qui y vivent. Ce pouvoir utilise un sous-espace, la capitale, pour se manifester et pour gérer les différentes régions du pays. C'est dans la capitale que s'expriment les parties constituantes de l'État, les régions, les groupes sociaux, les individus. Ainsi, la capitale est le lieu de régulation des conflits et des enjeux régionaux, communautaires, politiques, etc. C'est le lieu de la négociation nationale par excellence.
L'inadéquation de ce modèle.
Ce modèle idéal ne répond que médiocrement à la réalité-terrain du cas beyrouthin. Pour simplifier, trois phases historiques peuvent être dégagées, toutes convergeant vers le constat que Beyrouth n'était que marginalement la capitale d'un espace national.
1. Une capitale qui ne polarise pas son monde: la période d'avant-guerre.
Depuis 1945, et même depuis les premières années du Mandat, Beyrouth ne répondait que médiocrement au modèle classique. Beyrouth était certes la ville primatiale du Liban au plan démographique d'abord: elle accueillait, au début des années 1970 autour de 750.000 habitants si on incluait les grandes banlieues, sur une population totale proche de 2 millions habitants. C'était aussi le lieu exclusif de l'ensemble des services nobles, des décisions économiques, de la culture.
C'était aussi le lieu exclusif du Pouvoir: l'Exécutif et le Législatif, ainsi que les lieux physiques d'exercice de ces pouvoirs (les ministères) étaient dans l'espace beyrouthin; la plupart des partis politiques y avaient aussi leurs quartiers-généraux. De Beyrouth émanaient toutes les décisions affectant la vie des Libanais; de cette ville l'intégration des marges de la République devait, en principe, être planifiée.
Les apparences extérieures des fonctions d'une capitale nationale étaient formellement maintenues et soutenues par le rôle économique de la ville. En effet, Beyrouth ne prédominait dans le pays que grâce à son économie: c'était l'espace de création de surplus. Ces surplus étaient en partie ré-injectée dans la ville, créant des emplois par des effets de chaîne, tant sur l'espace beyrouthin que dans l'ensemble du pays. Le Liban, en quelque sorte, vivait des miettes produites par Beyrouth. Cette prédominance économique ne s'exprimait cependant pas au plan politique. Le pouvoir national, en effet, m'émanait pas d'elle. Aux yeux de ce pouvoir national, Beyrouth était le lieu de ponction privilégié des surplus nécessaires à la consolidation du système de clientèle de l'arrière-pays libanais. Parasitaire, ce pouvoir politique profitait du système confessionnel ainsi que la position incontournable de Beyrouth en Méditerranée orientale pour placer ses hommes-lige dans des postes-clés. A l'amont, aux les franges de la République, leurs clients sont arrivés alors à survivre, voire à s'enrichir tandis que les moins soutenus émigraient, écartés du "Miracle Libanais", en fait la corne d'abondance beyrouthine. Dans ces deux cas de figure, la contestation était écartée et le développement régional n'était pas perçu comme vital; les périphéries, le Sud, la Béqa`a, le `Akkar, la Montagne souffraient de sous-équipement, d'enclavement, de marginalisation. Beyrouth elle-même était d'ailleurs peu développée, hormis des espaces stratégiques de production de surplus: Hamra, les espaces bancaires, le port, l'aéroport... La façade du Liban se réduisait à ces quelques espaces "modernes".
Il n'était donc pas surprenant que tous les laissés-pour compte aient afflué vers la ville dans l'espoir de trouver des solutions à leurs problèmes. D'ailleurs, cette situation reflétait une constante historique et avait justifié l'annexion, en 1920, de Beyrouth à la montagne: sans la ville le Grand-Liban n'avait aucune chance de survie. Depuis la fin du XIXème siècle, et surtout depuis l'Indépendance, la ville était perçue comme un noyau d'enrichissement et Beyrouth n'a pas été autorisée à forger une citadinité propre, une identité urbaine particulière et efficiente. Inversement, elle n'a pas joué un quelconque rôle central, un rôle de capitale, le lieu possible de la gestion de l'ensemble du Liban, indifféremment de ses composantes, bref le lieu de l'intégration nationale. Le système électoral, par ses découpages administratifs et confessionnels perpétuait la non-intégration des Libanais à la ville et au Liban.
Tant que Beyrouth n'avait pas dépassé l'optimum démographique et maintenait le monopole régional des échanges entre les mondes producteurs de biens et l'hinterland moyen-oriental, ces surplus suffisaient pour garantir la pérennité du système politique. Cependant, avec la fragilisation des espaces et des pays mitoyens du Liban, suite aux deséquilibres apparus au grand jour par suite du morcellement du Moyen-Orient et des effets déstructurants des politiques d'expansion territoriale d'Israël, ce jeu politique libanais délicat allait être remis en cause. Beyrouth, malgré ses avantages, ne nourrissait plus tout le monde. Ses populations périphériques ont alors cherché d'autres solutions, exprimées par une polarisation politique croissante, notamment dans les bidonvilles qui s'étalaient et encerclaient maintenant la capitale.
Cette radicalisation fit naître deux tendances, qui allaient s'exprimer sur le terrain beyrouthin: d'un côté la défense des intérêts, à travers la défense du Pouvoir en place, de l'autre la conquête des espaces nourriciers de ces pouvoirs. Comme le système confessionnel n'offrait aucune chance de négociation, la porte fut ouverte à la violence. La conquête des lieux de production de surplus devenait alors une option traduite par l'émergence des différentes milices, qui ont pris en mains la dynamique politique. En retour, la ville s'effaçait.
2. Une capitale oblitérée durant la guerre: les années 1970 à 1990.
La guerre libanaise a été surtout une guerre urbaine; c'est donc dans un cadre urbain qu'il faut chercher les espaces centraux à la victoire militaire. Ils étaient, pour l'essentiel, dans le Centre-Ville de Beyrouth, le centre des affaires et des communications, et dans sa périphérie immédiate: le port, la rue des banques, la rue Hamra et sa Banque Centrale, l'aéroport enfin.
L'échec de la stratégie de conquête militaire de l'urbs, qui aurait pu être celle d'unifier Beyrouth sous un seul pouvoir, s'est traduite par une fossilisation du front le long de la rue de Damas, l'interface où coïncidaient les optima démographiques, confessionnels, idéologiques et tactiques. Parallèlement, le centre-ville était pillé puis détruit; ses espaces producteurs périphériques étaient fermés ou endommagés. Partout, les populations péri-urbaines remplaçaient ou marginalisaient progressivement celles de la ville qui se sont déplacées vers une périphérie plus lointaine encore, sinon vers l'étranger. Autour de la ville, des espaces sous-intégrés souvent très ruralisés s'étalaient à proximité de quelques poches de prospérité et de luxe. Partout des territoires idéologiques, fermés, remplaçaient l'espace national.
Mais sans doute le phénomène le plus important a été celui du développement des villes et bourgs secondaires du pays, par suite de la récupération des services nobles offerts par la capitale. Chaque territoire idéologique, création de milices, s'appuyait sur des infrastructures et des services parallèles qui remplaçaient ceux de la capitale. Des économies parallèles, s'articulant sur de petits espaces, remplaçaient les activités de la capitale. Cela s'est traduit par l'émergence de points forts dans l'urbanisation de la périphérie de la ville et concrétisés par de nouveaux centres de commerce ou d'affaires (Dora, Jdaidé, Jouniyé, Verdun, Broummana...)
Le Pouvoir lui-même s'est fragmenté en d'innombrables pouvoirs locaux, chacun avec son territoire, ses lieux de confrontation. De nouvelles compositions territoriales, voire des recompositions territoriales ont secrété ainsi de nouvelles identités, dont aucune n'était à proprement parler beyrouthine, et par là aucune ne pouvait être nationale.
Ainsi, Beyrouth a fini par perdre même le rôle formel de capitale qu'elle n'avait d'ailleurs jamais pleinement exercé. Elle n'était plus qu'un espace fragmenté en de minuscules territoires idéologiques et subissant des décisions politiques de sa périphérie militarisée, milicianisée, de la montagne ou les marges lointaines du Liban. Celles-ci, de leur côté, se passaient de Beyrouth et du symbole national qu'elle représentait.
3. L'après-guerre: une capitale à inventer
La fin des opérations militaires aurait pu (ou dû) signaler le retour à la situation imparfaite d'avant 1975. Certes, Beyrouth est toujours la ville première du Liban, avec un habitant sur deux, voire deux sur trois vivant dans Beyrouth et sa grande périphérie urbaine. Mais la ville, excisée de son rôle producteur de surplus, marginalisée par d'autres villes du Moyen-Orient, à l'écart des nouveaux réseaux d'échange et de communications, concurrencée au Liban même par les autres villes et les centres nés durant la guerre, est encore plus en porte-à-faux par rapport au reste du Liban.
Malgré le retour du Pouvoir national vers la capitale réunifiée, son expression traduit encore les logiques de la guerre. Les "Accords de Taëf" ont paradoxalement perpétué le système désuet d'avant-guerre, générateur de violences. De surcroît, issu d'élections contestées, le Législatif et par extension l'Exécutif, quoique siégeant à Beyrouth, gèrent plus des intérêts personnels ou locaux que des attentes nationales.
Quant au pouvoir municipal, il n'existe simplement pas: les Beyrouthins en ont été exclus depuis une trentaine d'années, et leur participation à la gestion de cet espace urbain paraît problématique. D'ailleurs, les nouvelles identités territoriales font que le débat sur l'identité beyrouthine est maintenant purement académique.
La crise du Pouvoir se dédouble d'une crise d'identité de la ville. Sa destruction par la guerre a été complétée par sa préparation à la reconstruction. Elle a été d'abord privatisée et aménagée par une entreprise dont les actionnaires, sinon les membres directeurs et fondateurs occupent des postes-clés dans la hiérarchie du Pouvoir. Son futur a été repensée en fonction d'un nouveau rôle, créateur de profits rapides, et au diapason des finances internationales, excluant par là un sérieux pourcentage de "consommateurs de ville" qui résident dans les périphéries ou ailleurs au Liban. Branchée sur l'extérieur, la Beyrouth reconstruite (en fait le Centre-ville seulement) tourne le dos à ses populations, et donc à l'ensemble du Liban. Elle sera elle-même cernée par de larges banlieues polymorphes: bidonvilles et espaces sous-intégrés pour l'essentiel, sinon des quartiers médiocrement articulés au centre-ville et portant quelques nouveaux centres modernes et efficients ainsi que des noyaux résidentiels. On peut se demander dans ce cas pourquoi reconstruire, et à quel prix? En tous les cas, la chose certaine est que la reconstruction soulignera l'état fragmenté de Beyrouth.
Vu les coûts, on risque de ne pas voir appliqués les plans de reconstruction actuels, ceux qui ont été régulièrement offerts au regard du public. Le relais de SOLIDERE sera sans doute assuré par des compagnies privées, à la recherche de profits rapides et faciles crées par des conjonctures précises liées au contexte économique du Moyen-Orient. Elles ne pourront donc être libanaises. Ces compagnies interviendront sur l'espace beyrouthin grâce à des concessions vendues par SOLIDERE, une fois que quelques bâtiments-phares stratégiques auront été rapidement édifiés pour montrer le sérieux de l'opération. Le résultat final fera que le centre-ville sera un espace privatisé, "moderne", entouré d'une première couronne dégradée, héritage de l'économie d'avant-guerre, contenant quelques espaces fonctionnels dont certains, à l'instar de Hamra, Sinn el-Fil ou Verdun, concurrenceront sérieusement le Centre-Ville par les prix offerts ou des centralités plus attractives.
Mais cette reconstruction économique ne va pas s'accompagner d'une nouvelle construction politique. Le centre sera articulé sur l'économie mondiale, et le Liban ne sera qu'une annexe minime à cette entreprise. D'ailleurs, le Liban n'a rien offrir au projet et à sa réalisation, si ce n'est que quelques capitaux annexes; même la main-d'oeuvre utilisée sera étrangère, notamment syrienne. Le Législatif, continuant dans la tradition clientéliste, sera objectivement alliée à ce projet, puisqu'il contrôle les points stratégiquement incontournables du marchandage autour de la prise de décisions. Entreprise privée, la renconstruction ne pourra avoir la prétention d'être au coeur du développement national, ni même au centre de la régulation sociale. Le projet nourrira, comme avant la guerre, les parasites et les prédateurs, mais ne suscitera aucune nécessité de développer les régions périphériques de la ville, c'est à dire le reste du Liban, qui se dépeuplera lentement. C'est faire appel à la violence future dans un cadre urbain groupant l'essentiel de la population libanaise. Ainsi, Beyrouth reste une capitale à inventer.
Conclusion
Beyrouth restera ainsi simplement un lieu, jadis privilégié, que des conjonctures précises de l'Histoire méditerranéenne ont favorisé depuis la fin du siècle dernier, un espace pratique de rencontre, mais non pas un lieu de prise de décisions engageant le pays. C'est un lieu de travail ou de résidence, mais pas d'intégration, ni le lieu d'émergence d'une identité nationale. C'est un centre désarticulé d'un pays et d'un État lui-même désarticulé.
En retour, le Liban ne connaît aucun développement régional cohérent: chaque espace laissé à lui-même (le `Akkar, le Chouf, le Jabal `Amel, le Koura, le Kesrouan, la Béqa`a), constitué en territoire autonomisé durant la guerre, campe sur ses positions, et réclame une part d'autonomie mal définie. Il s'en suit apparemment qu'aucun projet national, (politique, social, ou économique) qui s'appuierait sur une capitale, ne peut voir le jour.
Beyrouth n'aurait ainsi aucune raison d'être et les fragments du Liban, sans une politique nationale de développement, peuvent encore se passer d'une capitale.
Tours, le 11 septembre 1994
|
 al@mashriq 960325/960614 |