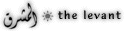
|
|
CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR L'URBANISATION DU MONDE ARABE URBAMA - TOURS
TABLE-RONDE SUR LA CITADINITÉ 29 - 30 JUIN 1992 FASCICULE 27
ETRE BEYROUTHIN EN 1800
MAY DAVIE
Beyrouth, ville équivoque, n'en finit pas d'interpeler son élite intellectuelle qui désespère de pouvoir la comprendre, l'expliquer, voire la modéliser. L'ambiguïté, pour peu qu'elle existe, n'est pas dans l'objet mais dans l'insuffisance de nos connaissances. Bourgade remparée jusqu'au milieu du XIXème siècle sur une surface d'environ 15 ha et peuplée d'environ 9.000 à 10.000 habitants, la ville a moins fasciné qu'Alep, Antioche ou Jérusalem; elle n'a pas connu la grandeur de Damas, la splendeur de Bagdad ou la majesté impériale d'Istamboul. La recherche sur la ville a progessé, et progresse encore aujourd'hui, très lentement, en ordre dispersé. Faute de mieux, les auteurs procèdent par analogie et se tournent vers des spéculations générales, sans échelle ni chronologie et qui ne rendent pas compte de toutes les situations et des évolutions. Le quant-à-soi de la ville, l'historique ou le moderne, n'est pas approché, l'analyse de la dynamique propre de l'espace beyrouthin et de la société urbaine est occultée: ordres, sociétés, quartiers, activités, réseaux et rapports sont ignorés.
L'élite politique, quant à elle, désarçonnée face à cette ville qui change de population tous les 20 ans, désespère d'imposer ses mythes. En face, l'être beyrouthin n'existe que pour affirmer son absence, regretter sa disparition, sinon sa marginalité. Dans tous les cas, un problème d'identité: ville qu'on accuse de tous les maux; ville sans liberté, sans cesse prise et reprise; ville sans royaume et néanmoins très convoitée.
Autrefois, la ville s'étalait, s'étirait, se faisait par elle-même. Peu lui importait d'être pensée, programmée. Elle se contentait de vivre, au rythme de son port et des marchandises que les négociants y entreposaient et des capitaux que ses banquiers brassaient. Elle tirait aussi profit des rencontres et des loisirs que les hommes organisaient. Puis, dans un tourbillon d'inconscience, elle est allée un jour vers le gouffre, y a laissé son coeur et sa mémoire. Plus rien ne subsiste matériellement de la ville d'autrefois, le centre-ville d'aujourd'hui. Et dans le pays, comme on n'écrit l'histoire qu'en fonction de l'idéologie, la ville n'a pas de place. Face au néant, les hommes s'interrogent, se cherchent des racines. Comment discerner le fait urbain quand la forme n'existe plus pour expliquer la nature, quand l'histoire ne dit pas le jeu du mécanisme social? C'est le centre-ville, la ville d'hier, qui focalise tous les débats, tous les appétits. Les scientifiques le baptisent et le rebaptisent: zone utile, coeur, espace public, noyau originel, centralité, city, down-town, pour signifier terre nourricière, secteur névralgique, potentiel économique, survie et habitudes de vie. Le commun l'appelle balad, aswâq, mdîneh. Il est certain que tout ce qui fait la ville s'y trouvait: le port, les marchés, la bourse, le Parlement, quelques administrations et surtout les principaux lieux de culte. Ce fut l'espace fondamental, porteur de convivialité, pourvoyeur de citadinité. Elément si fort qu'on en oublie les limites et les éléments moins marqués. On oublie surtout que cet espace familier n'a pas plus de quelques décennies d'âge. Car, dans ce terroir, depuis le siècle dernier, quatre villes se sont succédées, quatre strates juxtaposées et enchevêtrées: à la ville arabe ont succédé les villes méditerranéenne et coloniale, puis la ville contemporaine, persistance et reconversion d'un être urbain en évolution. Au départ, Bayroût al Qadîmat, Beyrouth la vieille, le nucléus originel, cadre urbain qui forgeait l'être beyrouthin.
Des documents iconographiques et autres archives nous ont permis d'établir le contact avec la ville du XVIIIème siècle. C'était Baruth, l'escale des pélerins et des consuls, c'était Bayroût al Mahroûsat des dossiers du Tribunal Char`î et encore Bayroût al Qadîmat, celle de nos grands-parents.
C'était alors une toute petite ville ottomane, une villette nichée dans une ample muraille, portée par ses jardins et vergers, sa réserve alimentaire. C'était aussi un centre de production des richesses de l'artisanat de même qu'un port de cabotage, minuscule mais suffisant pour la mettre en relation avec le dehors jusqu'aux limites de l'univers dans lequel elle était intégré: Damiette et Alexandrie d'une part, Izmir et Istamboul puis Gênes et Livourne de l'autre. Sur la route littorale, elle servait d'étape aux voyageurs et aux marchandises cheminant entre les villes de Tripoli et Sayda et convoyés vers la Terre Sainte ou vers Damas. Par sa manière de vivre et d'agencer ses moyens matériels, Beyrouth était une réplique de la ville arabe: un entassement extrême, un mode d'habiter particulier et des pratiques économiques spécifiques, les soûq, consacrés chacun à un métier déterminé qui les occupait de façon permanente et auxquels il donnait son nom. Des zones économiques s'étaient ainsi inscrites dans la trame urbaine[1] (Fig. 1).
Fig. 1: Les zones économiques de Bayroût al Qadîmat: les deux villes. Pas d'opposition, à Beyrouth, entre les quartiers d'habitation et les quartiers de production: les activités professionnelles et la vie privée se déroulaient dans le même cadre. Les Beyrouthins résidaient dans des hârat ou des zouqâq rattachés aux soûq. Le plus souvent, à même le soûq, la maison surplombait la rue principale; sinon, elle était accolée à l'arrière d'une boutique: un passage et quelques marches y attenaient. Deux types architecturaux marquaient le bâti. La maison familiale, une structure basse, fermée sur l'extérieur et composée de plusieurs pièces adjacentes agencées autour d'une cour à ciel ouvert, était l'habitat-type des gens aisés. L'habitat collectif, plus répandu et plus modeste, était une combinaison modulable selon un volume de base cubique, composée de quelques pièces carrées et étroites, surmontées de deux ou trois étages, et qui donnait à la construction l'illusion d'une tour carrée et à la ville cet aspect en hauteur, aux ruelles sombres tant décriées par les voyageurs occidentaux. Beyrouth ne connaissait pas de regroupement confessionnel. Les Chrétiens, éparpillés partout dans cette ville musulmane, prédominaient dans certains secteurs, celui du port, surtout à Mahallat (quartier) al Dabbâghah, et celui de la cathédrale Saint-Georges des Grecs-Orthodoxes, dans les Mahallat al Charqiyyah et Birkat al Moutrân. Ils étaient aussi présents le long des deux axes structurants, à Mahallat al Arwâm, Chaykh Raslân, al Gharbiyyah et, au Sud, à Bâb al Dirkah et Bâb Ya`qoûb (Fig. 2).
Fig. 2: Les principales zones résidentielles des Chrétiens.
Malgré sa petite taille, la ville présentait une structure dense, projection d'une société aux relations sociales très complexes. Elle ne connaissait pas de concentration totale des fonctions centrales mais était organisée autour de plusieurs pôles, en fonction de la composition de la société et de ses activités, faisant bénéficier la ville d'un système souple de gestion du territoire, une logique communautaire aux pouvoirs limités, aux arrangements spontanés. Car l'économique n'était pas seul à l'oeuvre, le temps appartenait aussi à Dieu, à la Mosquée et à l'Eglise. La communauté et la famille prédominaient.
La famille était le vecteur principal de la communication et de la diffusion dont les soûq et les autres lieux publics (hammâm, cafés ou terrasses des habitations) étaient les foyers. C'était la cellule de base de la société beyrouthine, la famille au sens large, appelée banî et qui groupait toutes les familles parentes selon une ascendance patrilinéaire, un ancêtre commun dont elles portaient toutes le nom. Des familles associées par le mariage ou proches par l'origine faisaient aussi partie de ces groupes. Les familles parentes reconnaissaient, par consensus, la préséance de l'une d'entre elles selon l'aînesse ou la fortune et son chef comme le notable représentant du groupe. A une échelle supérieure, les familles formaient des communautés professionnelles, confessionnelles, de quartier ou d'origine qui fonctionnaient comme des corps intermédiaires entre le gouverneur et la population. Le gouverneur les consultait dans les décisions importantes, les associait au pouvoir et leur conférait des responsabilités d'ordre public (municipalité, justice, fisc) et social (éducation, assistance, asile...). A cet égard, il reconnaissait leurs chefs, les machâyikh, comme représentants des communautés et les organes de représentation étaient aussi nombreux que les quartiers, les métiers et les religions, et autant de recours en cas de conflits. Les communautés confessionnelles étaient toutefois fondamentales et la communauté musulmane connaissait des sous-groupes religieux, les confréries. Leur dimension religieuse intéressait moins le pouvoir central que leur forte capacité à organiser la cité. Comme le soûq, la mahallat ou le khân, les lieux de culte, mosquées, églises ou zawiyât, jouaient un rôle dans la gestion urbaine et la régulation sociale. C'étaient des centres administratifs importants, des sièges d'autorité annexes au pouvoir du Qâdî, le juge suprême, et au pouvoir central installé dans le Sérail (Fig. 3). Par leur composition familiale, les communautés étaient également des organes de contrôle social: de génération en génération, les familles transmettaient les usages, les valeurs et les métiers, elles étaient garantes de la continuité et modératrices des excès.
Fig. 3: Les pôles administratifs des communautés confessionnelles.
Deux morphologies urbaines ont exprimé cette situation, deux villes distinctes par la forme et la vocation (Fig. 1). Le secteur méridional polarisait les activités artisanales et le marché local. C'était un centre administratif où s'exprimait également la vie spirituelle. Artisans et boutiquiers s'y activaient et une grande partie des Beyrouthins y habitait avec notables et clergé. Ses dédales étaient truffés de lieux de culte, autant de pôles économiques ou d'agents publics. Ici, se trouvaient les deux principaux pôles communautaires, la mosquée al `Oumarî et la cathédrale Saint-Georges des Grecs-Orthodoxes. Le Nord-Est était un centre d'affaires tourné vers l'extérieur, relais entre le port et les caravanes. Il attirait marchands, agents, courtiers, armateurs et caravaniers. Les plus riches commerçants s'y activaient et généralement y résidaient; ils dominaient d'ailleurs la cité par leur poids financier et foncier. Cette zone était marquée par la monumentalité des khân et autres équipements lourds, par des percées moins tortueuses et par une porte, Bâb al Dabbâghah, qui lui était vouée.
La superposition des trois cartes précédentes nous enseigne que la ville n'était pas une simple fédération de quartiers, mais le produit d'espaces urbains qui se croisaient et s'entremêlaient, formant des espaces pluriels, favorisant le rapprochement humain et les relations sociales, indifférents au ghetto économique ou confessionnel. Les regroupements par affinité religieuse ou professionnelle existaient et traçaient des cercles de relations sociales strictement communautaires (endogamie, assemblées de familles, réunions de prière, sociétés de bienfaisance...); les activités distinctes n'étaient cependant pas disjointes. Malgré leur identité apparemment bien déterminée, les communautés étaient des groupes souples et vastes, aux pratiques fortement intégratrices. Elles n'étaient pas soumises à des lois rigides et avaient toute la latitude de se réorganiser face à une éventualité. Elles fonctionnaient comme des réseaux, moins des espaces de pouvoir en concurrence que des espaces administratifs informels ou des espaces fonctionnels où s'excercaient certaines activités. Les activités professionnelles n'étaient pas toujours confessionnellement exclusives, et le groupe avait une responsabilité totale sur l'ensemble du territoire, partout où habitaient et exerçaient les ouailles. D'où le contact quotidien entre les particuliers et entre les communautés, entraînant négotiation, tolérence et alliance. Cela était d'autant plus vrai que les communautés étaient aussi, à travers le waqf, des appareils de production urbaine, propriétaires d'équipements sociaux (écoles, gîtes...), économiques (boutiques, boulangeries, moulins, khân, soûq...) et publics (fontaines, places, cafés, hammâm, habitations...). Quand le groupe produisait de l'urbain, il le mettait à l'usage de tout le monde. Les Musulmans louaient boutique chez les Chrétiens et inversement, et l'assistance n'était jamais exclusive. La ville était ainsi un territoire commun et la société une entreprise collective. Elle était différenciée, sans hiérarchie stricte mais solidaire par la convergence des intérêts de la cité. Les réseaux de quartiers et de communautés n'étaient certes ni en parfaite harmonie, ni en conflit permanent mais cherchaient à se reéquilibrer suivant les conjonctures. Le particulier ne s'exprimait pas en opposition au général et la pluralité des regroupements et des alliances ne signifiait pas la division mais un mode local, bien méditerranéen, d'organisation, qui acceptait les différences et les gérait sans vouloir soumettre l'ensemble à une loi universelle. Chaque acteur gardait ses usages et ses domaines propres, et participait de plain pied à la collectivité. Cette réalité se projetait de manière exemplaire au plan matériel: le quartier administratif orthodoxe, par exemple, alignait d'Ouest en Est des constructions communautaires qui inscrivaient, sur le terrain, un glissement progressif, naturel dirions-nous, du privé vers le public (Fig. 4).
L'embranchement des hârat ou des zouqâq sur l'espace d'un soûq est un autre exemple. Il dit non seulement la manière dont le privé était imbriqué dans le public mais aussi l'"omniprésence" du public (Fig. 5). La forme architecturale des habitations, cernées de murs hauts et aveugles, n'exprimait-t-elle pas, dans ce cas, une résistance à cet excès? Toujours est-il que la petite taille de la ville et la promiscuité des maisons multipliaient les liens entre les hommes: elles accentuaient l'intimité de la rue et renforçaint les rapports de voisinage.
Fig. 4: Du privé vers le public, le quartier administratif orthodoxe.
Fig. 5: Du zouqâq au soûq. La superposition des trois cartes met également en évidence un secteur privilégié par la variété des flux économiques et la diversité des interactions sociales. Il se trouvait à l'intersection des deux villes et des nombreuses boucles figurant les espaces urbains et s'alignait le long de l'axe du Soûq al Fachkha. Il n'est pas étonnant d'y trouver, à proximité du Soûq al Dallalîn (les changeurs), la porte principale, Bâb al Sarâyâ, et les deux pôles majeurs de la gestion urbaine et du contrôle social: le Sérail avec la caserne annexe des Janissaires et la mosquée principale, al `Oumarî. Débouchaient sur cet axe, la rue al Toujjâr (les commerçants et les agents), le marché des produits supérieurs ainsi que les quartiers administratifs des minorités. Là, se traitaient les activités hautes de qualité et de volume, d'importance politique et financière, qui génèrent et gèrent les surplus de la cité. N'était-ce pas le quartier directionnel, lieu de la décision et du pouvoir où se rencontraient les éléments forts de l'urbanité et se négociait la paix de la cité?
Au delà de leur enchevêtrement, et ceci reste essentiel pour Beyrouth, ces configurations urbaines disent l'imprécision des limites entre le public et le privé, le public et l'économique, le communautaire et le civil... Ce flou des frontières dit la fluidité des relations et contredit la rigueur du découpage vertical. Ce petit monde entrelacé, qui mêlait sa diversité, paraissait opaque à l'oeil du non-initié. Pour celui qui pratiquait la ville, c'était la règle. Celui-là en possédait le code de conduite. Il en connaissait les réseaux et les mécanismes, les valeurs et les habitudes. Celui-là était beyrouthin, un citadin.
De la ville arabe du XVIIIème siècle, rien n'a été conservé. Bayroût al Qadîmat avait d'abord cohabité avec la ville du XIXème siècle, mêlant ses vieilles figures aux formes nouvelles[2] nées du progrès amené par le siècle et la centralisation du pouvoir urbain au sein de nouvelles institutions politiques et publiques: le majlis al idârat et le majlis al baladiyyat. Elle n'allait cependant pas survivre aux étapes ultérieures, celles du Mandat français et de la République Libanaise[3]. Période de bouleversements profonds, assise politique de l'Etat national qui allait naître, le Mandat amena la domination économique, la rupture institutionnelle et de nouveaux rapports de force entre les communautés. La ville s'est confessionnalisée, pervertissant les modes traditionnels d'organisation et de gestion. La citoyenneté ne prit pas la relève de la citadinité et rompit l'équilibre à l'ancienne de la cité. Simultanément, les traces du passé furent effacées, gommant l'histoire, la mémoire, les repères.
ANNEXE MéTHODOLOGIQUE
Les sources
Deux documents cartographiques, de facture inégale, ont été utilisés. Le fond topographique a été extrait de la carte Plan of the Town and Defences of Beyrut and its vicinity by T.F. Skyring, L. Rl. Engr., May 1841, scale 400 feet to an inch. L'analyse de ce document a été présentée ailleurs (DAVIE, 1984). Les toponymes (les noms de rues, des soûq, des khân) ont été tirés de Kanaan (1963). Cet auteur présente une carte (apparemment une copie manuscrite d'un plan français des années 1860) qui est le seul document disponible à ce jour signalant la quasi-totalité des toponymes de la ville. Ces documents ont été complétés par des renseignements tirés d'archives de 1848 et publiées (HALLAQ 1985 et 1987), ou inédites, certaines de l'Archevêché Grec-Orthodoxe de Beyrouth qui remontent à 1803 (Davie 1993). Nous avons admis qu'il y a concordance entre le toponyme et la fonction effectivement exercée à cet endroit: le soûq des légumes indique qu'on y vend là des produits maraîchers. Nous avons également admis qu'un toponyme exprimait la pérennité de cette fonction sur un laps de temps relativement long (un siècle au moins): en l'absence de destructions massives, de massacres ou de déportations de la population autochtone, il ne serait pas erroné d'affirmer que les toponymes existant au XIXème siècle sont l'expression de fonctions qui s'y pratiquaient au moins au début de ce même siècle, sinon durant la période antérieure.
La méthode
Sur ce fond de carte, un quadrillage régulier mais arbitraire a été superposé; la fonction de chaque carré a ensuite été déterminée en fonction du ou des toponyme(s) présents dans ce carré. Nous avons retenu une classification générale groupant les activités économiques selon la spécialisation et la qualité du produit ou du service.
L'artisanat lourd que nous avons avons marqué I, comprend les soûq al Haddadîn (des ferroniers), al Fakhkhârîn (des potiers) et al Dabbâghah (des tanneurs), activités bruyantes, malodorantes et salissantes, qui exigent une surface d'exploitation importante et éloignée des habitations. Dans cette rubrique, nous avons classé les activités tout aussi encombrantes par le volume des matières premières et du matériel utilisés et qui, elles aussi, exigent un minimum d'espace de travail: les soûq al Najjârîn (des menuisiers), al Kharrâtîn (des tourneurs du bois), al Mounajjidîn (des matelassiers), al Nahhasîn (des travailleurs du cuivre).
Nous avons désigné par F toutes les autres activités de fabrication et de vente identifiées par le nom du soûq où elles s'exercent: les soûq al Narâbîj (des pipes à eau), al Hayyâkîn (des tisserands), al Sarâmih (des chaussures)... Les soûq qui portent un toponyme à référent communautaire ou familial font aussi partie de cette classe: les soûq al Noûriyyah et al Arman, al Bazarkhân ou le khân Sa`îd Aghâ... Pour l'époque qui nous concerne, ces soûq, qui n'indiquent pas une production particulière, semblent, pour la plupart, agencés autour des équipements communautaires des minorités confessionnelles, sinon situés dans des zones périphériques de la ville. Etaient-ils des zones de production mixte ou étaient-ils consacrés à la distribution, sur le marché local, de produits multiples importés des villes voisines? La question reste posée.
L'artisanat supérieur est désigné par la lettre S. Il concerne la fabrication et la vente d'objets fins et élaborés installées dans les soûq al Jawharjiyya (des bijoutiers), al `Attârîn (des parfumeurs), al Moûsîqâ (des instruments de musique) et al Khayyâtîn (des couturiers).
Le marché alimentaire (A) regroupe les soûq al Khoudra (des légumes), al Lahhâmîn (des bouchers), al Khoubz ( du pain), al Qatâwif (des gâteaux) et le khân al Bayd (des oeufs).
Quant aux soûq où se traitent les produits destinés au commerce extérieur et les activités associées, nous les avons marqués par la lettre C: les soûq al Qoutoun (du coton), al Harîr (de la soie), al Qazâz (du verre), al Hallâj (des cordeliers), al Bayâtirah (de la maréchallerie), al Toujjâr (des agents-commerçants) et le khân al Mkâriyya (des caravaniers), ainsi que les khân al Qamih (du blé), al Basal (des oignons), directement installés sur les quais du port. Nous avons volontairement marginalisé le khân al Khamâmîr (des produits alcoolisés), situés aussi dans ce secteur, à proximité du quartier al Arwâm (des Grecs-Hellènes). Cet espace avait-il une fonction publique que sa localisation semble indiquer? Nous attendons les résultats des recherches en cours pour le confirmer.
B désigne le soûq des Dallâlîn, les banquiers et les courtiers.
P figure le Pouvoir, c'est-à-dire le Sérail, la résidence du gouverneur ottoman et la caserne annexe des Janissaires.
Les résultats
D'emblée, il apparaît une différentiation spatiale des fonctions de la ville, l'artisanat supérieur ne partageant pas, par exemple, les mêmes zones que l'artisanat inférieur ou l'alimentation, par exemple. Cette ségrégation des fonctions n'était en rien particulière à Beyrouth: on la retrouvait dans l'ensemble des villes du monde arabe au XIXème siècle, et elle semble avoir été la norme depuis l'invention des marchés urbains, au Néolithique.
La ségrégation des fonctions semble obéir à une certaine logique liée aux grands axes de circulation dans la ville et à l'accessibilité du monde extra-muros, par les portes principales de la ville: Bâb al-Sarâyâ, Bâb Ya`qoûb, Bâb Dabbâghah et Bâb al Dirkah. En effet, l'alimentation de base (pain, légumes, viande...), située en plein coeur de la ville, le long des dédales de ruelles à l'Ouest de la cathédrale Saint-Georges des Grecs-Orthodoxes, était en communication directe avec Bâb al Dirkah. L'alimentation de la ville se serait donc effectuée depuis le Sud. Il est vrai que plusieurs routes convergaient sur cette porte, après avoir traversé l'ensellement entre les collines d'Achrafiyyé et de Basta-Zouqâq al Blât. A noter que ces soûq étaient desservis par deux points d'eau, Birkat al Soûq et Qâyim al Mâ'.
La production artisanale, destinée surtout à la consommation locale, était concentrée, pour l'essentiel, dans le secteur méridional de la ville, suivant une ségrégation géographique selon la nature de l'activité. Les produits encombrants en occupaient les régions périphériques alors que les produits salissants ou malodorants étaient situés dans le secteur Nord, loin de la zone d'habitation dense que représentait le secteur méridional. Seul, Soûq al Najjârîn était dans un lieu central; il semble indiquer une activité exclusivement pratiquées par des minorités, sauf erreur de transcription de Kanaan. L'artisanat supérieur était aussi concentré dans une même zone, occupant une place centrale privilégiée, entre la mosquée al `Oumarî et celle de l'Emir al Mounzir. Le quart Nord-Est de la ville, à proximité du port, regroupait les soûq à vocation régionale. Il était desservi par deux portes, Bâb al Sarâyâ, la porte principale de Beyrouth, et Bâb al Dabbâghah, sa porte économique. Par opposition au secteur méridional réservé au marché local, on y effectuait le commerce de gros et tous genres d'activités en relation avec ce commerce.
Soulignons la place centrale, du Soûq al Dallalîn, entre les deux secteurs de Beyrouth, à proximité directe du Sérail.
Enfin, les positions militaires étaient toutes concentrées à proximité du port (le château et le fortin, le magasin de poudre); deux tours couvraient le flanc méridionnal de la ville, l'une sur l'éperon "du Grand Sérail", l'autre en plaine, le célèbre Bourj al-Kachaf.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
ABDEL NOUR, A., 1982: Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie ottomane (XVIè-XVIIIè siècle). Beyrouth, Publications de l'Université Libanaise, Section des Etudes Historiques XXV, 422 p.
ABOUJAOUDé, M-T., 1978: Edition, traduction et commentaire de quelques actes juridiques se rapportant à la ville de Beyrouth au 19è s. Mémoire d'histoire urbaine, Université Paris IV-Sorbonne, 151 p.
CHEVALLIER, D. (sous la dir. de) 1979: L'espace social de la ville arabe. Paris, Maisonneuve et Larose. 363 p.
CHEVALLIER, D., 1972: "Signes de Beyrouth en 1834." Bull. Et. Or. (Damas), T. XXV, pp. 211-229.
CHEVALLIER, D. 1982: Villes et travail en Syrie du XIXe au XXe siècle. Paris, Maisonneuve et Larose. 165 p.
DAVIE, M., 1986: "Les familles orthodoxes à travers les cahiers du Badal `Askariyyet". Ann. Hist. Arch. (Beyrouth), vol. 5, pp. 1-44.
DAVIE, M., 1993: "L'espace communautaire orthodoxe dans la ville de Beyrouth. (1775-1850)". Les Cahiers du CERMOC, (Beyrouth-Amman),vol. 5, (sous presse).
DAVIE, M. et NORDIGUIAN L., 1987: "L'habitat urbain de Bayrout al Qadimat". Berytus (Beyrouth), vol. XXXV, 1987, pp. 165-197.
DAVIE, M., 1993: La millat grecque-orthodoxe et la ville de Beyrouth - Structutation interne et rapport à la cité, 1800-1940. Thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, 448 p.
DAVIE, M. F., 1984: "Trois cartes inédites de Beyrouth. Eléments cartographiques pour une histoire urbaine de la ville". Annales de Géographie, (Beyrouth), vol. 5, pp. 37-82.
DEBBAS, F., 1986: Beyrouth, notre mémoire. Beyrouth. Naufal Group. 256 p.
DU MESNIL DU BUISSON, 1921: "Les anciennes défenses de Beyrouth". Syria (Paris) T. II, 235-257 et 317-327.
DU MESNIL DU BUISSON, 1925: "Recherches archéologiques à Beyrouth". Paris, Bulletin de la Société Française des Fouilles Archéologiques, 1824-1925, pp. 6-134.
GUYS, H., 1985: Beyrouth et le Liban, (réédition de l'original de 1850). Beyrouth, Dar Lahd Khater, vol. 1: 256p., vol. 2: 260p.
HALLAQ, H., 1985: Awqaf al mouslimîn fi Bayrout fi `ahdal `outhmani. Beyrouth, al Markaz al Islami lil I`lam wa al Inma' 363 p.
HALLAQ, H., 1987: Al tarîkh al ijtima`i wa al iqtisadi wa al siyasi fi Bayrout. Beyrouth, Dar al Jami`at, 453p.
KANAAN, D. et I., 1963: Bayrout fi al tarikh. Beyrouth, Matbaat Aoun, 268 p.
LAUFFRAY, J. 1948: "Forums et monuments de Beryte". Beyrouth, Bulletin du Musée de Beyrouth, 1948, n[[ordmasculine]] 7-8. pp. 1-78.
MOUTERDE, R., s.d. (1966): Regards sur Beyrouth, phénicienne, hellénistique et romaine. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 55 p.
RAYMOND, A., 1985: Grandes villes à l'époque ottomane. Paris, Sindbad. 389pp.
TARAWALI, Ch., 1993: Bayrout fi al tarikh wa al hadarat wa al `oumran. Beyrouth, Dar al `oulm lil Malayin, 355 p.
|
 al@mashriq 960325/960614 |