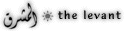
|
|
DEUXIèME CONFéRENCE INTERNATIONALE D'HISTOIRE URBAINE Strasbourg 8-10 Septembre 1994
BEYROUTH: DE LA VILLE OTTOMANE À LA VILLE FRANÇAISE
May DAVIE
U.R.A. 365 URBAMA (Centre d'Études et de Recherches sur l'Urbanisation du Monde Arabe) Tours
"Le 7 octobre 1918, sur l'ordre du Ministre français de la Marine, la Division Navale de Syrie se déploie pour prendre possession du port de Beyrouth. Le lendemain, un premier détachement britannique arrive à Beyrouth avec l'État-major du Général Allenby. Le 10 enfin, les Chasseurs d'Afrique, flanqués d'une "compagnie syrienne" sous commandement français et transportés par mer de Hayfa, défilent dans les rues de Beyrouth, drapeau tricolore au vent, acclamés par la foule"[1].
Deux semaines auparavant, le dernier wâlî ottoman de Beyrouth, Ismâ`îl Haqqi Bey, avait transmis le pouvoir à `Oumar Dâ`oûq, Président du Conseil Municipal, et quitté son poste, laissant derrière lui une ville épuisée par l'administration militaire, la tension de quatre années de guerre et la famine. Avec son départ, quatre siècles d'administration ottomane prennent fin. Le 3 octobre, quelques heures après la libération de Damas par les armées arabe et britannique, les couleurs chérifiennes sont hissées sur le bâtiment de la Municipalité. Mais immédiatement après l'entrée des troupes françaises à Beyrouth, la libération se transforme en occupation. Elles font amener le drapeau arabe et prennent la direction de l'administration: c'est le début de la tutelle française sur le Levant qui s'étendra de Beyrouth où elle s'installe, sur l'ensemble de la Syrie d'où sera chassé le roi arabe Faysal[2].
Porte de la Syrie, Beyrouth et son port sont sans doute les lieux les plus stratégiques pour la France à cette époque, pour ses investissements et son commerce au Levant et pour ses communications avec l'Extrême-Orient. Elle y installe d'abord les quartiers-généraux des Armées, et cinq ans plus tard, quand l'occupation transmue en mandat, la ville devient le siège du Haut-Commissaire et des services administratifs qui entament, sous cette formule, une oeuvre complexe de restructuration politique et économique des territoires. Simultanément, la ville change de nationalité et de vocation: ville-relais de la Syrie ottomane, chef-lieu de wilâyat, Beyrouth devient la capitale du Grand-Liban, le centre politique d'un pays essentiellement montagneux auquel elle vient d'être annexée. Ce rôle et cette identité façonnés de toutes pièces par les Français vont être maintenus jusqu'à l'époque présente. Expression de ces temps troublés, l'organisation urbaine est bouleversée, tant en son centre qu'à sa périphérie. Plus qu'un changement de régime ou l'adoption de méthodes et d'un savoir-faire nouveaux, on assiste à une remise en question des fondements mêmes de la cité, un basculement vers un ordre étranger.
Notre intervention se propose de décrire le passage de l'ordre traditionnel ottoman vers le nouvel ordre français et, chemin faisant, de mettre en lumière les principales mutations urbaines qui en ont été l'expression.
La période ottomane: de la ville arabe à la ville méditerranéenne
Née tard à la vie de grande agglomération, Beyrouth est une ville jeune dans l'ordre des villes importantes du Moyen-Orient. Son développement et son étalement spatial sont des phénomènes récents qui ne datent que de la fin du XIXème siècle. En 1918, au voyageur arrivant par bateau, Beyrouth offrait le spectacle d'une ville saisissante par la beauté de la rade et l'ordonnance des maisons de couleurs vives, aux façades ornées d'arcades, aux toits recouverts de tuiles rouges et étagées sur les flancs des collines surplombant la baie. A cette période, Beyrouth était une ville de taille moyenne; par son aspect, c'était une réplique des villes de la Méditerranée orientale, façonnées par les sociétés marchandes du XIXème siècle qui y avaient prospéré et fait sortir de leur léthargie ces cités côtières dont certaines, à l'instar de Beyrouth, étaient aussi vieilles que le monde. Sur toute la périphérie de Bayroût al Qadîmat, la ville ancienne, s'égrenaient les beaux quartiers de Qirât, Rmayl, Zouqâq al Blât et Mînat al Housn, confortablement installés dans la campagne environnante, parmi les jardins et les vergers. Ils abritaient bourgeoisie et familles parentes ou associées, tandis que des populations moins nanties occupaient Sayfî, Ghalghoûl, Bâchoûrah ou Dâr al Mraysseh[3]. La vieille ville, qui fut autrefois toute la ville, n'était plus à présent que le centre-ville, le moteur économique de l'agglomération. Au delà, les localités rurales de Rmayleh, Ras Nabe`, Mazra`at al `Arab, Mousaytbeh, Jimmayzit al Yammîn et Râs Bayroût occupaient la banlieue plus lointaine. Plus proches du village que du faubourg, mais spatialement dynamiques en raison de la conjoncture économique favorable, elles tendaient à se souder entre elles et à fusionner avec la ville.
Au voyageur qui contemplait Beyrouth à cette date, il aurait été difficile d'imaginer ce qu'avait été cette ville ottomane quelques décennies plus tôt. Depuis le milieu du XIXème siècle, la rapidité de l'urbanisation et l'intensité des transformations avaient en effet changé sa physionomie de fond en comble. Autrefois, elle n'était qu'une toute petite ville remparée, nichée au centre de son promontoire et portée par une étroite plaine, sa réserve alimentaire. Elle était alors un centre artisanal de même qu'un port de cabotage, minuscule certes, mais suffisant pour la mettre en relation avec le dehors. Sur la route littorale, elle servait aussi d'étape aux voyageurs et aux marchandises cheminant entre les villes de Tripoli et Sayda et convoyés vers la Terre Sainte ou vers Damas.
A l'instar de toute ville arabe, Beyrouth était caractérisée par un entassement extrême, des habitations basses en pierre et aux terrasses plates, et séparées par un lacis de ruelles étroites, de dédales et d'impasses, le tout ceinturé par une muraille. Ce tissu urbain était la projection d'une société aux relations sociales très complexes qui ne connaissait pas une concentration spatiale des fonctions centrales mais qui était organisée autour de plusieurs pôles, en fonction de la structure sociale de la société et de ses activités. La ville bénéficiait d'une logique communautaire de gestion, au pouvoir composé, à la recherche d'équilibre et d'alliances et nourri de pratiques collectives. La ville ne connaissait pas d'espaces clos, mono-fonctionnels ou mono-confessionnels. Les Chrétiens étaient éparpillés un peu partout dans cette ville musulmane et les activités professionnelles et la vie privée se déroulaient dans le même cadre. Ainsi, les espaces urbains s'entrelaçaient, rendant flou la limite entre le public et le privé, le public et l'économique, le communautaire et le civil, favorisant les contacts et la convivialité. La petite taille de la ville et la promiscuité des maisons multipliaient aussi les liens entre les hommes, renforçant l'intimité de la rue et les liens de voisinage. Le Pouvoir ottoman, installé dans le sérail, assurait l'ordre et la sécurité publique. Il négociait la paix sociale avec les représentants locaux, les chefs religieux et les notables civils qui organisaient la production et le marché[4].
Le XIXème siècle est celui de l'irruption du capitalisme occidental et le transfert des activités économiques de l'intérieur syrien vers le littoral levantin, entraînant des modifications dans les voies et les modes de communication et une redistribution géographique du poids économique des villes du Moyen-Orient. Ce concours de circonstances place Beyrouth au centre de nouveaux enjeux régionaux. Elle devient le site le plus important du littoral, relais obligé entre la mer et l'intérieur. Beyrouth s'ouvre alors aux échanges et aux rencontres: c'est le temps de la Méditerranée, du vapeur et des contacts lointains avec l'Égypte des Khédives, les soyeux lyonnais et les drapiers anglais. C'est le temps du positionnement, de l'essor et du déploiement des commerces beyrouthins dans la région. Beyrouth usurpe l'échelle à Sayda, puis à Haifa qui essaie pendant un temps de la concurrencer. Elle devient le port principal de la Syrie, la porte de Damas. A cette dernière, elle dérobe sa prédominance commerciale, puis diplomatique et culturelle. Simultanément, la ville amorce une urbanisation annonçant le passage d'une économie à fonction locale à une économie ouverte sur les grands échanges et annonçant encore les changements sociaux en cours, la montée de la bourgeoise d'affaires et le recul de la campagne.
Le XIXème siècle est surtout l'ère des Tanzîmât, le passage de l'oral à l'écrit, de la coutume au droit et à la décision collective. D'une réforme à une autre, les Ottomans introduisent la laïcité et la représentativité, les conseils administratif et municipal, sans rompre avec le système communautaire et notabilitaire[5]. Les notables, riches marchands, chefs de familles et représentants communautaires[6], prennent la relève des `oulamâ' et du clergé et prédominent dans l'administration de la cité. Ils y jouent un rôle décisif et très sensible, faisant converger intérêts privés et communautaires et aussi ceux de l'ensemble de l'urbs[7]. Par leur action, le système collectif à l'ancienne est rendu plus performant, postulant l'existence d'espaces publics plus amples: Bayroût al Qadîmat se transforme. L'urbanisation a pour levier une amélioration des techniques de transport: la route carrossable, le chemin de fer et le télégraphe, mais aussi et surtout, un nouveau régime foncier. Transactions immobilières, constructions et aménagements font que les jardins intérieurs sont éliminés, les portes éventrées, la muraille abattue et de nouveaux soûq ouverts loin de l'étranglement de l'ancien marché. Bayroût al Qadîmât est rebaptisée: la vieille ville devient le centre-ville. En dehors, une ville nouvelle est née, marquant l'ascension des nouveaux groupes à un statut supérieur de respectabilité. Les espaces se spécialisent sans plus se croiser. Le public se sépare du privé, inculquant aux Beyrouthins une pratique nouvelle de la cité. Le négoce est certes le principal bénéficiaire de l'aménagement, mais la Municipalité sécrète aussi des services publics à l'usage général.
Fig. 1: La ville méditerranéenne.
La réglementation remplace les arrangements spontanés d'antan et planifie d'importants projets: bâtiments administratifs, jardins et places publics, kiosques à musique, chemins de promenade, théâtres et trottoirs font leur entrée à Beyrouth. Au même moment, à l'école ou par la presse, la philosophie de l'hygiène pénètre les esprits: l'eau à domicile, les vaccins, les hôpitaux, les cimetières hors des murs, l'élargissement des voies et enfin, le gaz d'éclairage et un réseau d'égouts font partie maintenant des nécessités. La ville se restructure et prend l'allure d'une énorme ceinture résidentielle cerclant un noyau voué irrévocablement aux affaires et à l'administration (Fig. 1).
Des soûq modernes naissent dans le Nord-Ouest de l'agglomération et se spécialisent dans des articles de luxe et les produits importés[8]: coutellerie, étoffes, bonneterie, passementerie ou vêtements. Par leur allure régulière, leurs rues droites, leurs belles vitrines aux enseignes décorées et par de nouvelles techniques de vente, ils contrastent avec les vieux soûq arabes, le coeur historique de la cité, ancrés dans les vieilles formes de pierre et le même réseau humain. Dédales, ruelles couvertes, échoppes et étalages à même le soûq se maintiennent, offrant des produits locaux de l'artisanat et du marché. Et quand, à la fin du siècle, cet espace est à son tour assaini, il résiste encore perpétuant l'enchevêtrement, la promiscuité des constructions, reproduisant l'intimité de la rue, les lois à l'ancienne du marché et les gestes quotidiens de fabrication. Quelques familles persistent aussi à y écouler leur vie. Ainsi, la vieille ville s'enrichit de nouveaux espaces économiques et s'ouvre à la modernité sans se remettre en question. Offrant une gamme variée de prix et de produits et une diversité de services, elle reste accessible à l'essentiel de la population à qui elle procure aussi travail et survie.
Cerclant le vieux noyau urbain, les grands projets modèlent une nouvelle trame du bâti par la création d'espaces urbains organisés rationnellement, horizontalement et verticalement. Par l'architecture, une nouvelle esthétique s'inscrit dans le paysage public et contribue à créer une autre centralité. Progressivement bâtis et aménagés, ces espaces abritent les lieux de pouvoir, de loisirs et les carrefours, qui quittent la vieille ville pour s'installer dans la périphérie immédiate. Le Grand Sérail, une caserne ottomane, et l'hôpital militaire s'imposent sur la crête dominant la vieille ville. Par sa monumentalité et ses couleurs, leur architecture tranche avec le reste de la ville, symbolisant la présence ottomane. Sur la récente Place Assoûr, les nouvelles Halles, construction en brique rouge et fer forgé issue de la mode et de l'industrie européennes et rehaussée par une fontaine, se démarquent des habitations de Bâb Ya`qoûb. La place Hamidiyyeh, convertie en jardin public, avec son kiosque, son bassin, ses allées de promenade et ses bancs, s'étale en perspective au pied du petit Sérail. A l'architecture triomphante, ce dernier est la construction la plus importante de la place, le siège du pouvoir local, des conseils administratif et municipal. Le port est agrandi et équipé. Ce quartier se dote aussi d'un visage nouveau avec sa gare neuve et ses grands immeubles, dont la Banque Ottomane, qui alignent étages et fenêtres agrémentés de bas-reliefs et de moulures au goût de la fin du XIXème siècle. Plusieurs nouveaux khân y sont érigés. Des chemins de promenade et des plages prolongent cet espace à l'Est comme à l'Ouest, tout le long du littoral.
Ces espaces nouveaux, à proximité des sérails ou au port, s'animent avec faste lors des grandes parades politiques ou militaires ou à l'arrivée d'un vaisseau important. Ils restent éveillés en soirée, avec la fréquentation des lieux de loisir et de plaisir, clubs, cafés, restaurants, hôtels et maisons closes, qui se sont installés à proximité. Tandis que le centre-ville, très animé le jour et désert la nuit, devient un espace public de vie intermittente. Au delà, dans les jardins environnants, le calme règne et l'animation reste très respectable; c'est la zone résidentielle, la "ville haute", un autre monde, loin de la "ville basse", le coeur économique récemment couronné d'une auréole politique et publique.
Dans les aires neuves, la vie des notables s'ouvre à l'espace et aux commodités de la vie et perd progressivement ses amarres avec le passé. Les Beyrouthins aisés adoptent partout un nouveau mode d'habiter. La maison à hall central, d'un ou de quelques étages, au toit rouge et entourée d'un jardin[9] est introduite et tend à prédominer. Dans les quartiers riches, la bourgeoisie d'affaires et l'aristocratie urbaine, nées du commerce à longue distance, étalent leur fortune dans des constructions plus importantes et des palais. Cependant, l'ancien type architectural persiste tel quel ou réaménagé, pour les moins nantis et pour les nombreux immigrés. La maison à cour à ciel ouvert[10] continue d'être construite comme des maisons plus simples, composées de quelques pièces carrées alignées ou superposées. Très vite, ces quartiers se développent et s'équipent: jardins publics, cafés, lieux de culte, écoles et hôpitaux. La ville grandit: en deux générations, elle triple sa population, attirant la petite population de la montagne et celles des villes voisines. Et quand, à la fin du siècle, les divergences sociales s'accentuent, la bourgeoisie beyrouthine développe parallèlement son idéologie. Les mythes urbains se mettent alors à parcourir la ville: les sept familles patriciennes, le droit d'ancienneté et le mythe originel, ou à défaut des liens inventés avec les valeureuses tribus du désert arabique et même avec les descendants de Mahomet le Prophète.
La chute de l'Empire ottoman met fin à cet ordre. Avec le Mandat, l'urbanisation continue et la ville grandit encore de manière vertigineuse. Mais à partir des années 1920, la croissance ne fait plus le chemin avec le développement. Contrairement à l'époque précédente, le Mandat s'inscrit en rupture par rapport au passé, déséquilibrant l'organisation de la cité.
Le Mandat français: la ville coloniale
L'installation du Mandat français inaugure une nouvelle phase urbaine. Pour s'imposer, le Mandat va perturber l'ordre précédent, mais la ville ancienne ne disparaît pas totalement: elle voit se constituer des ensembles nouveaux qui tendent à s'imposer. Trois objectifs dictent les comportements. Tout d'abord la pacification, car le Mandat est le temps de l'occupation militaire et du rattachement de la ville à la montagne, contre son gré[11]. C'est le temps de la colère et des émeutes qui prennent naissance dans les soûq et les quartiers marginalisés. Ensuite, l'ouverture de l'espace du port et l'amélioration des contacts avec l'hinterland syrien sont une autre priorité. Enfin, l'hygiène et l'organisation de la circulation dictent aussi les comportements. Vitrine de la France au Levant, centre de rayonnement de la culture française, il devient urgent d'assainir la ville et de l'embellir. Progressivement, Beyrouth se met à la norme française. Elle acquiert deux aspects: quartier-général et ville coloniale, vivant au rythme des politiques militaires, des capitaux et de la "mission civilisatrice" des étrangers.
Quadrillant le territoire, les Français occupent les casernes ottomanes et en construisent de nouvelles qui enferment la ville de tous les côtés. Contrôle et liberté de mouvements nécessitent des percées rectilignes et des axes périphériques stratégiques reliant les casernes entre elles, et aussi avec un aérodrome. Des percées larges et droites sont ouvertes à travers le tissu tortueux ancien. Le port est étendu et le centre-ville remodelé (Fig. 2). Bousculant les obstacles fonciers et institutionnels[12], le Mandat crée progressivement une nouvelle centralité. Occupant la gendarmerie et le Petit Sérail, l'ancien siège de la Municipalité, le pouvoir français domine la Place Hamidiyyeh et redéfinit son rôle social, mettant un terme à cet espace d'expression, devenu point de rassemblement des populations soulevées, alliées du régime arabe puis ralliant la révolte des Druzes, les émeutes de Tripoli et les grèves de Damas. Plusieurs années plus tard, la Municipalité est déplacée vers de nouveaux bâtiments construits sur l'emplacement du Soûq al Fachkha, rebaptisée rue Weygand. Elle se réinstalle donc dans la vieille-ville, en face de la mosquée al `Oumarî.
Le Mandat fait aussi le ménage à l'intérieur de la vieille-ville déjà déstructurée par des percées ottomanes ouvertes à la veille de la première guerre pour désenclaver la région du port, et laissées en l'état. Deux projets mort-nés, les plans Danger et Ecochard[13], donnent naissance, dans les années 1930, à un projet d'urbanisme selon des normes en vogue en France: la Place de l'Étoile. A l'endroit même des soûq arabes et de leurs constructions en pierre à l'aspect terne, un centre moderne est érigé aux couleurs vives, utilisant les techniques nouvelles du bâtiment. Tout le secteur méridional de la ville intra-muros, avec sa résille de ruelles, ses marchés et ses ateliers, disparaissent. Ils sont remplacés par un système radial d'avenues bordées de galeries, de commerces et d'immeubles élevés, certains de style "arabo-mauresque" et qui convergent toutes vers la Place de l'Étoile. Là, tout en hauteur, s'élève le Parlement, une nouvelle institution née avec la République en 1926, souveraineté de la jeune nation libanaise que la Société des Nations a confiée à la France de former, légitimant par là l'occupation. Ainsi, les deux symboles du pouvoir local, le parlement et la municipalité, coupés de leur base, sont réinstallés dans la vieille ville "nettoyée", car, avec les soûq, le petit peuple est évacué. Vu le rapport de force, ce sont seulement des organes consultatifs. Quelques soûq anciens, celui des joailliers, des légumiers, des fromagers, des bouchers et d'autres émigrent vers le secteur de Soûq al Noûriyyeh, seul rescapé de cette grande oeuvre de remodelage; d'autres disparaissent définitivement. A leur place, dans des locaux "modernes", larges et hauts, des commerces s'installent au niveau de la chaussée, tandis que des bureaux et des locaux professionnels, mais surtout des banques et des agences, occupent les étages. Et pas loin, est construit un théâtre. Ainsi, le coeur historique de la cité est gommé, survivance des époques passées, résidu des deux phases urbaines précédentes, les villes arabe puis méditerranéenne des XVIIIème et XIXème siècles. Plus qu'un cadre matériel, Beyrouth perd la majeure partie de ses espaces de convivialité, ses foyers traditionnels de la diffusion et de la communication fonctionnant à l'ancienne et ouverts à toutes les conditions[14]. Le nouvel espace qui naît est différent de l'ancien. Il est moins public ou autrement public. Réservé à un groupe particulier, il établit moins d'interférences entre les différentes strates de la population. Il autorise certes de nombreux contacts, mais par sa structure et sa vocation, ceux-ci sont moins larges et davantage unidimensionnels.
Fig. 2: La ville coloniale.
L'avocat, l'ingénieur et le médecin partagent à présent l'espace central avec le marchand, grossiste ou détaillant, et qui se réserve toutefois l'espace des soûq du Nord-Ouest qu'il a lui-même engendrés à la fin du siècle dernier. C'est le temps de la relève. Les vieilles familles bourgeoises qui avaient dirigé la cité au XIXème siècle sont en déclin et toute la société est en mutation, grâce à une forte immigration, à la montée des classes moyennes et salariées, et surtout grâce à l'instruction qui porte au pouvoir un nouveau type d'homme. D'une association familiale et communautaire, la société se transforme en un agglomérat de groupes aux contours encore mal définis au sein desquels s'affirme une élite qui se définit par la fonction et la profession. C'est ainsi qu'au notable succède le spécialiste.
Cette élite ne fait cependant pas le poids face à l'élite de la montagne, propriétaires fonciers, petits notables de village ou émigrés retournés au pays[15], qui pratique maintenant de droit la ville qu'elle vient d'annexer avec l'aide des Français. Etendant à Beyrouth la logique du système politique de la montagne, cette élite introduit le confessionnalisme qui s'installe en ville en même temps que la République[16]. Les institutions ottomanes sont balayées et dans le but de favoriser des groupes privilégiés, elles sont remplacées par un système confessionnel qui ôte paradoxalement à la communauté l'ensemble de ses prérogatives dans l'organisation urbaine. D'organe de gestion et de régulation, la communauté est réduite à une confession, sa plus étroite dimension. Par ce biais, l'élite rurale arrive à écarter les citadins de la direction politique de la cité[17].
Plus qu'une rupture sociale et institutionnelle, le Mandat est aussi le passage d'une économie marchande à une économie de rentes. Les réseaux marchands patiemment tissés durant le XIXème siècle sont à présent perturbés par les frontières politiques instaurées au Moyen-Orient et les troubles qui continuent à secouer l'arrière-pays. Ils ne génèrent plus de surplus suffisant et l'économie urbaine, excentrée dans son ensemble et dictée par des intérêts étrangers, est en perte de vitesse[18]. Le déficit est comblé par des activités rentières, les dépenses des troupes françaises et les remises des émigrés[19]. Cette situation fragilise la ville et remet en cause sa capacité d'accueil, au moment où des populations rurales de plus en plus nombreuses viennent s'y installer à la recherche d'emploi et de sécurité. D'ailleurs, par cet apport démographique consistant, les faubourgs se densifient et s'étendent. La zone résidentielle double de surface, mais l'urbanisation n'exprime plus le développement. Les familles d'immigrés s'installent, pour la plupart, aux portes de la ville, occupant d'anciennes maisons rurales réaménagées ou des constructions récentes, très modestes et en béton. Elles gonflent d'anciennes localités, Râs al Nabe`, Mazra`a et Mousaytbeh, ou forment un nouveau type de quartiers tels que Rmayleh, Hayy al Siriân ou Fourn al Chebbak. Confessionnellement homogènes, ces derniers sont la négation même de la ville. C'est là d'ailleurs que germent des comportements politiques à l'image des sociétés européennes d'avant la deuxième guerre mondiale, prônant nationalisme étroit et populisme[20]. Loin de ces zones de mal-vivre, dans les vieux quartiers proches du centre, l'ancienne bourgeoisie, les classes montantes et les classes moyennes mènent leur train de vie habituel dans un espace résidentiel aéré. Dans ces lieux, la maison familiale à hall central résiste au mouvement démographique et continue de prédominer. Ailleurs, dans les nouveaux quartiers, à Râs Bayroût ou à Achrafiyyeh, elle ne disparaît pas totalement. Elle garde son jardin et sa structure, perd son toit rouge et change de façade alors que l'utilisation du béton autorise l'adjonction d'une véranda qui remplace l'étroit balcon. Dans ces quartiers nantis, la voiture est introduite. On généralise les vêtements à l'occidentale et les noms européens. Simultanément, la francophonie se répand et devient un fait de société.
Conclusion
Le Mandat Français installé, en fin d'époque coloniale, sur le Grand Liban, n'a pas engendré à Beyrouth, sa capitale, la dichotomie spatiale ville européenne/ville arabe. Toutefois, l'empreinte du Mandat fut profonde. Par ses méthodes d'administration et d'organisation, une "ville nouvelle" est née avec l'aide de ses capitaux et de ses conseillers, au coeur même de la ville et non pas à ses côtés. Par là, Beyrouth a été modelée de l'intérieur. Un ordre ancien fut extirpé et remplacé par un ordre qu'il était impossible de contester. Les plans d'aménagement ont physiquement exprimé cette conjoncture. Cependant, à l'image de la mission française de soutien aux jeunes nations, l'ordre politique nouveau n'était que façade. Placée au centre de la cité, dans le coeur historique du Vieux Beyrouth, la Chambre des Représentants ne fut qu'un symbole vide de substance. Plus qu'un lieu de débat et de liberté, elle a représenté, et représente toujours, la victoire d'un ordre confessionnel né dans un monde rural en crise sur un ordre urbain traditionnel.
Malgré les circonstances dans lesquelles ce nouvel espace a été engendré, son coeur, la Place de l'Étoile n'est pas le fossile d'une époque. Signe de l'histoire ou fatalité, c'est le seul secteur du centre qui n'a pas été détruit par les obus de la guerre civile ou rasé par les bulldozers de l'État après la fin de celle-ci. Les Beyrouthins le considèrent aujourd'hui comme une partie importante de leur patrimoine face au néant urbanistique de l'époque suivante, celle de l'Indépendance, caractérisée par une dégradation du cadre et la perte de toute esthétique urbaine[21]. Ils y sont d'autant plus attachés qu'aucune structure n'existe plus matériellement des deux phases urbaines précédentes, l'arabe et la méditerranéenne, hormis quelques constructions ottomanes épargnées miraculeusement pour témoigner du passé. La ville coloniale est ainsi paradoxalement devenue la "ville ancienne", après avoir été la vitrine de la France au Levant, l'avant-garde du progrès.
Juin 1994
|
 al@mashriq 960325/960614 |