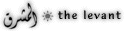
|
|
Université de Balamand, Institut d'Urbanisme de
l'ALBA, Beyrouth et Université François-Rabelais, UMR 6592 du CNRS "URBAMA", Tours
Journée d'études du samedi 12 avril 1997
LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN AU LIBAN : POUR QUI, POURQUOI, COMMENT FAIRE ?
ENJEUX ET IDENTITéS DANS LA GENèSE DU PATRIMOINE LIBANAIS
MAY DAVIE[1] [Annexe 1] [Annexe 2] [Annexe 3] [Annexe 4] [Annexe 5] "Patrimoine" : ce mot fourre-tout ne suffit plus à fédérer la multitude de débats et d'enquêtes effectués, depuis quelques années, tant sur les vestiges du passé que sur le paysage et le milieu naturel, ou encore sur l'urbanisation, l'architecture et la reconstruction du Liban. Cette polysémie témoigne pour le moins de l'engouement grandissant des Libanais pour leur environnement et son histoire, baptisé un peu hâtivement patrimoine, et de la volonté de sa consécration parmi les thèmes urgents du débat politique.
Manifestations publiques, expositions et collections, campagnes médiatisées, publications, autant d'efforts de la part de Libanais qui visent aujourd'hui à démontrer que le "patrimoine" vaut bien que l'on s'occupe de lui. Pour l'heure, l'élite politique y est engagée et les associations de sauvegarde deviennent malaisées à dénombrer, tant leur nombre va en grandissant.
Les faits
À la fin de la guerre, en 1990, un constat alarmant avait d'abord mobilisé les universitaires. Les ravages de l'urbanisation sauvage de la montagne et de la côte, la perte irrémédiable du cadre de vie familier des villages et des quartiers, l'oblitération des vieux soûq de Beyrouth, le rétrécissement brutal des places publiques et des espaces verts, l'étalement désordonné des banlieues, le tout accompagné d'un mal-vivre au quotidien (que ne tempérait plus par ailleurs l'économie libérale "à la libanaise" ou l'émigration) avaient touché tous les segments de la population. La dégradation de l'environnement humain allant de mal en pire, la prise de conscience fit alors tache d'huile parmi une population sérieusement déboussolée.
Ainsi, l'audience du Patrimoine grandit peu à peu. Les particuliers et les communautés inventorient aujourd'hui leurs archives ; les associations organisent de plus en plus de rencontres et d'expositions ; simultanément et surtout par effet de mode, les collectionneurs se multiplient ; architectes et urbanistes se mobilisent ; les politiciens, de leur côté, s'emparent régulièrement du débat et certains même se l'approprient ; le Pouvoir aussi réagit, en lançant une série d'études historiques et sociales. L'UNESCO a été un moment au centre de cette quête, que soutiennent par ailleurs des associations libanaises installées à l'étranger[2], voire des associations internationales[3].
Chemin faisant, le champ du patrimoine s'est aussi élargi. Avant-guerre, on mettait en exergue le modernisme. Les brochures du Conseil National du Tourisme et celles des compagnies d'aviation affichaient, hormis les monuments romains, les paysages de la Montagne et les Cèdres du Liban, le visage des quartiers contemporains de Beyrouth, la Corniche et le quartier de Raoucheh par exemple, ainsi que les grands hôtels des années 1950 et 1960, les plages et les boîtes de nuit. A contrario, la vieille cité, les soûq du centre-ville et les anciens quartiers du péricentre, n'occupaient qu'une infime partie dans ces publicités. Aujourd'hui, en revanche, on scrute le moindre témoignage du passé. On réédite des vieux journaux[4], des cartes postales et des photographies d'époque[5]. On fouille tous les coins de la mémoire. Des archives familiales et toutes sortes de documents personnels "anciens" deviennent des reliques. On est fier de conserver et d'exhiber précieusement des prises de vue de son quartier et de sa maison, et des vues générales de la ville du XIXème et du début du XXème siècles. L'édifice individuel, vestige archéologique, construction militaire ou monument religieux, n'accapare plus, à lui seul, le champ patrimonial. On recherche plus une atmosphère[6], un cadre matériel, des objets et des lieux qui situent la mémoire[7] et hantent le souvenir.
Récemment, depuis quelque cinq années, on a aussi été jusqu'à avancer la borne temporelle de l'historicité, incluant de la sorte la période du Mandat français, pour lequel on redouble désormais d'intérêt. On a même inversé la hiérarchie des lieux et des objets dignes d'appartenir à notre histoire. En effet, ce n'est plus la montagne et son patrimoine qui monopolise l'idéologie nationale ou la nostalgie de la population, ni même l'observation des historiens libanais ; ce sont les villes et leur histoire qui sont interpellées, et surtout Beyrouth qui occupe le premier rang dans les débats publics et dans les publications universitaires. Cette ville est également au coeur des préoccupations des archéologues. La presse internationale s'est emparée de ce créneau, et il n'y a pas de site Web d'Internet couvrant le Liban qui n'offre des images des vestiges dégagés.
On continue cependant à détruire
Élan nostalgique pour les uns, politique ou scientifique pour les autres, la quête patrimoniale, au Liban, ne dépasse pas toutefois, au plan pratique, sa nature discursive. En effet, et quoique la sauvegarde du patrimoine paraît aujourd'hui évidente aux yeux d'un nombre important de la population, il faut reconnaître que les destructions n'en continuent pas moins à grande échelle et sans aucune forme de retenue populaire, individuelle ou collective, ou de contrôle étatique. Particuliers, communautés, sociétés privées ou collectivités publiques, les Libanais, toutes échelles sociales et institutions officielles confondues, n'en finissent pas de saccager, en toute légalité, leur environnement naturel et le cadre bâti préexistant
De véritables murailles de béton, d'acier et de verre ont envahi, et continuent inlassablement et tout naturellement d'envahir, tous les coins du pays. Villas et logements collectifs, cités résidentielles, complexes balnéaires, centres d'amusement, immeubles de rapport en tout genre, ponts, rocades et carrefours, se construisent dans toutes les régions, sans relâche et sans résistance apparente. Ils défigurent des sites archéologiques millénaires (le port phénicien de Enfé, la vallée de Mousaylha), mettent à mort des milieux naturels uniques (les formes karstiques de Reyfoun, la vallée de Sfiré) et déstructurent encore les bourgs pittoresques de la côte et de la montagne (Chekka, Batroun, Broummana, Aley, Jiyeh ...). En outre, au nom de deux dogmes, à savoir la relance économique et le développement, corollaires de la "Reconstruction du Liban", l'urbanisation compromet quotidiennement, et tel un raz-de-marée, l'héritage architectural et urbain des villes de Zahleh, Chtaura, Mina, Tripoli, Saida et, bien entendu, Beyrouth. La capitale est d'ailleurs la plus touchée : centre-ville éventré, monuments publics démontés[8], architectures domestiques abattues, ensembles urbains décomposés[9].
Il apparaît bien que les valeurs patrimoniales, au Liban, ne sont pas encore rentrées dans les mentalités. Notion vague, aux contours encore mal définis ou mal assimilés, le patrimoine demeure, en définitive, l'apanage d'une minorité, et ce, malgré une histoire longue de cent cinquante ans environ.
La genèse d'un concept au XIXème siècle ottoman
"Déjà en 1855 Ahmed Féthi Pacha, grand maître de l'Artillerie, avait songé à former une collection publique d'antiquités ; il rassembla un certain nombre d'objets épars à Constantinople et les fit déposer dans la cour de Sainte-Irène (Djebhané). Bien que cette collection resta longtemps inconnue aux archéologues, elle ne cessa de s'accroître grâce à de nombreux envois des gouverneurs de provinces, parmi lesquels on peut citer Riza Pacha et Costaki Pacha Adossidès. Le musée a été formellement créé en 1869 en même temps que fût promulgué le premier règlement sur les antiquités".
C'est avec ce texte que G. Young (1905) introduit sa traduction, en langue française, de la première loi ottomane écrite, relative au musée et aux antiquités et applicable à l'ensemble des provinces de l'Empire, dont Beyrouth et sa région ainsi que le Mont Liban. Par manque d'études consacrées au sujet, nous ne connaissons pas encore le champ d'application de cette loi, qui fut promulguée en 1869, modifiée en 1884 puis en 1906. Cependant, la démarche première des hauts fonctionnaires de l'État et des cadres de l'armée impériale, formés par ailleurs en Occident (en France notamment), reflète une conception muséologique d'un "patrimoine" conçu et construit uniquement de vestiges archéologiques, des "antiquités".
G. Young ne nous livre pas, comme il le fait pour d'autres termes employés dans son ouvrage, le mot ottoman original qu'il a traduit par "antiquités"[10]. Mais l'article 1 du règlement spécifie :
"Sont considérés comme objets d'antiquité, tous les vestiges laissés par les anciens peuples des contrées formant aujourd'hui l'Empire Ottoman tels que : les monnaies d'or et d'argent et les autres pièces monnayées, les inscriptions historiques, les sculptures et les gravures, tout objet en pierre, en terre ou en métaux comme les vases, les armes, les instruments ou les figures, les pierres d'anneau, ainsi que les temples, palais, cirques et théâtres, les fortifications, ponts, aqueducs, tumuli, mausolées et obélisques, édifices sacrés et monuments, statues, colonnes et toutes sortes de pierres gravées et sculptées"[11].
Les articles suivants définissent, eux, les dispositions relatives au droit de propriété, aux conditions de fouille, aux pénalités et au transport des antiquités, indifféremment désignées par "objets d'antiquité", "vestiges" ou "ruines".
Menus objets archéologiques ou architectures majeures de toutes sortes, il découle de cette source textuelle que ce que l'on appelle de nos jours "patrimoine" fut d'abord introduit dans l'Empire et explicitement compris comme âthâr (vestiges ou ruines antiques), plutôt que comme tourâth (héritage, moeurs ou traditions), au sens large, matériel et social, qu'on attribue maintenant à ce concept. Les monuments antiques des différentes provinces de l'Empire devaient être préservés in situ, tandis que les objets devaient d'abord être transportés dans les écoles `idâdiyeh[12] où ils devaient être photographiés. Les objets les plus importants devaient ensuite être envoyés au Musée Impérial et les autres exposés dans les cours desdites écoles. Destiné donc au musée ou exposé au regard libre de la population, le âthâr semble en outre avoir été affecté d'une valeur cognitive, d'art et d'histoire, et ne concernait, en principe, que le passé lointain : un patrimoine "mort", si l'on peut dire, la date-butoir n'atteignant pas la période ottomane, ne dépassant donc pas le XVème siècle, comme le règlement l'insinue.
Faisant référence, par ailleurs, à tous les peuples qui avaient anciennement habité les contrées de l'Empire, et donc à toutes les civilisations sans exclusion d'aucune, le patrimoine âthâr ne semble pas a priori doté d'une quelconque connotation idéologique. Les textes relatifs à l'appartenance des antiquités de plein droit à l'État ottoman (Article 3) et à l'interdiction de les exporter (Article 8) reflètent assez une mesure économique, assurément associée à l'intérêt culturel. Ils ne suggèrent pas, en tous cas, une volonté d'appropriation de l'Histoire, une sorte d'héritage qui légitimerait une action ou une identité. L'article 14, qui stipule que la moitié des antiquités découvertes dans la propriété d'un particulier est abandonnée au propriétaire, confirme encore cette interprétation[13].
Cependant, et quoi qu'en dise la réglementation, il est remarquable, au plan concret, que peu de fouilles furent alors le fait de l'État ottoman central, ou de l'administration provinciale[14]. C'étaient des Occidentaux, pèlerins, savants, missionnaires et architectes, qui venaient admirer, décrire, dessiner ou photographier les monuments historiques de l'Orient. À Beyrouth comme ailleurs, ils retournaient le sol, dans le cadre de missions archéologiques officielles[15], sinon à leur bon gré[16] et sans approbation du Gouvernement, à la recherche des traces et des restes d'édifices effondrés. Certains quêtaient des sujets et des objets, statuettes, ustensiles ou bijoux, qu'ils revendaient sous cape aux collectionneurs qu'étaient quelquefois les notables autochtones, les consuls étrangers et les voyageurs[17].
L'attitude de la population
Avec les règlements ottomans, les relations de ces Orientalistes sont une source précieuse pour remonter aux origines du concept patrimonial en Orient, à la moitié du XIXème siècle. Elles nous instruisent, de manière très significative, sur la perception de la population autochtone et sur son attitude vis-à-vis des pratiques des fouilleurs étrangers et des objets retrouvés. Au prisme du commun de la population, plus étonnée et méfiante que curieuse et avenante, le âthâr ne semblait pas représenter un intérêt particulier, ne répondant sans doute pas à un besoin concret. Désigner le âthâr, une notion qui était encore sans portée populaire, par le terme patrimoine, pris dans l'acception occidentale du terme au XIXème siècle ou dans son sens actuel, n'est-ce pas faire preuve d'anachronisme ?
Mais toute différente était la position de la population "lettrée" de Beyrouth. On la saisit au travers la presse locale de la fin du XIXème siècle[18], qui rapporte l'avis de journalistes et, de temps à autre, celui de quelque personnage influent. Ceux-ci, et contrairement aux couches populaires, exprimaient souvent leur admiration pour les vestiges archéologiques. Ils vantaient le passé glorieux et les techniques de construction uniques, en louant l'apport des découvertes pour la connaissance historique et la culture[19]. Mais, et contrairement à l'époque actuelle, on ne détecte pas chez eux une quête identitaire, un vouloir de filiation ouvertement exprimé entre ce passé et la réalité immédiate, pour valoriser ou regretter une situation, ou encore pour se prévaloir de caractères identitaires spécifiques. L'étude de cette presse devra sans doute être plus approfondie, mais on note déjà, et qu'il y ait eu alors prise de conscience patrimoniale ou pas, c'est-à-dire que la filiation ait été assumée par la population et son élite ou pas, l'absence de nécessité de dire l'identité par le biais du patrimoine, et de la coucher par écrit.
La presse du XIXème siècle nous livre, au reste, les plaintes de l'élite quant à son cadre urbain, dénonçant l'encombrement des ruelles étroites et tortueuses et même quelquefois l'inconfort des habitations anciennes de Bayroût al Qadîmat, la ville intra muros[20]. Les configurations traditionnelles étant discréditées au nom de l'hygiène et de la santé publique, tout en faisant référence aux modèles des villes modernes occidentales, salubres et organisées[21], notons paradoxalement l'absence de distance historique et de prise de conscience patrimoniale vis-à-vis de l'environnement quotidien familier et des monuments ottomans anciens qui le composaient, khân, dâr, mosquée, madrasat, soûq voûtés, portes et forteresses, formes ancestrales d'habitat, de lieux et de coutumes urbaines, autour desquelles l'armature sociale était nouée.
Les aménagements planifiés ou spontanés, et effectués à partir de 1875 par l'élite urbaine beyrouthine, n'avaient-ils pas d'ailleurs déjà assailli plus de la moitié de ce cadre bâti ancien ? Dans cette optique, il apparaît que la nouvelle loi de 1906, avec sa formulation applicable aux "objets antiques, meubles et immeubles se rapportant aux arts et métiers islamiques", soit parvenue trop tard. La ville devenant effectivement un grand centre de commerce prospère et à l'urbanisme en plein essor, le réaménagement de larges secteurs anciens fut accompli, sous l'impulsion de la Municipalité et des notables civils et religieux, ainsi que de quelques compagnies étrangères. De nouveaux soûq furent construits, le port agrandi, des voies larges ouvertes, les ruelles alignées, les portes éventrées, les jardins intérieurs éliminés, la muraille abattue, le tramway installé, le château et le vieux sérail détruits et le port romain remblayé. De nouvelles formes architecturales avaient progressivement remplacé, entre 1875 et 1912, des éléments individuels ou des ensembles historiques entiers, que l'on aurait désigné aujourd'hui par "patrimoine architectural et urbain".
Il faut toutefois noter que, malgré l'introduction d'esthétiques d'inspiration occidentale et le respect des nouvelles règles de l'urbanisme et de la construction[22], la fin du XIXème siècle ne se caractérisait pas par une rupture architecturale ou géographique totale avec le cadre ancien, comme ce fut le cas dans certaines villes du Monde Arabe colonisé[23], ni par un dédain envers les formes autochtones d'occupation. À Beyrouth, on a aussi continué à bâtir à l'ancienne, conformément à des besoins précis et selon des modèles locaux connus et longtemps expérimentés, donnant par ailleurs un paysage urbain d'une grande complexité. Et si on a édifié des bâtiments dans des styles en vogue en Occident (le néo-baroque de la Banque Ottomane, des magasins Orosdi Bak, le néo-gothique de l'église Évangélique et du palais Pharaon, le romano-byzantin de l'église Saint-Louis des Capucins, le style composite italianisant des palais Soursouq et Dâ`oûq)[24], on n'a pas arrêté de construire -- ce qui ne sera plus le cas à l'avenir -- des khân et des soûq "arabes" (le khân Antoûn Bey et les soûq Ayyâs, Mâr Jirjis, Noûriyat, Abî Nasr et Hânî, Ra`d et Khayyât)[25], qui, bien que situés dans des ruelles maintenant élargies et arborant des vitrines plus grandes, n'en perpétuaient pas moins des modes anciens d'occupation (soûq voûtés, fontaines à l'orientale, proximité des constructions, intimité de la rue...). De même, on a adopté la "maison à hall central"[26], occidentale par sa taille, ses couleurs et certains traits extérieurs, mais très orientale quant à son organisation intérieure et sa belle façade ornée à l'arabe, d'arcs brisés.
Avec le Mandat français, un instrument du sectarisme culturel
La tutelle française, installée sur ce qui sera rapidement le Grand Liban après la chute de l'Empire ottoman, ouvre une nouvelle page du parcours historique du fait patrimonial au Liban, moins en rapport à son contenu concret qu'à sa signification.
Dès 1919, avant même la proclamation officielle du Grand Liban, un appareil juridique et technique est dressé, préconisant des mesures pratiques pour classer, inventorier, préserver et entreposer les vestiges archéologiques, désormais sujets à plus d'attention, si l'on peut dire : une inspection stricte et des critères de sélection, des méthodes d'inventaire et des procédures de conservation bien définis. Quelques années plus tard, une armature institutionnelle est créée : le Service des Antiquités du Haut-Commissariat, installé à Beyrouth. On fonde aussi le Musée de Beyrouth, dans le bâtiment même de la Mission Archéologique, à la rue de la Prusse rebaptisée Georges-Picot. Mais quelques temps après, il est transféré dans un nouvel édifice, bâti à la rue de Damas, son emplacement actuel.
Sous l'impulsion et le contrôle du Service des Antiquités, et aussi avec le concours de la Mission Archéologique permanente qui représente l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, des fouilles méthodiques sont entreprises et des conférences archéologiques régulièrement organisées sur les découvertes faites dans les villes côtières du Liban, dans son arrière-pays et en Syrie, sur laquelle le Mandat français a également été établi. Places fortes, monuments, objets d'art, instruments, armes, documents écrits, demeurés à la surface du sol ou enfouis dans ses profondeurs, les archéologues, pour la plupart des Français, traquent toutes sortes de ruines et de fragments, échelonnés entre le troisième millénaire et le Moyen-Âge, limites chronologiques à l'intérieur desquelles un vestige est maintenant considéré comme historique, le terme, à l'aval, étant d'abord fixé à 1600 puis repoussé à 1700 en 1933[27].
Ceci étire l'ère du patrimoine de 200 ans par rapport à la période précédente, et atteste d'une certaine évolution, dans les textes à tout le moins, puisque la teneur du concept reste formellement pareille : des vestiges archéologiques, encore du âthâr. Mais l'innovation par rapport à l'époque ottomane précédente n'est pas dans la loi. Elle réside dans l'usage original que font les Français du Levant de ce sujet, par un jeu de périodisation historique à valeur différenciée, riche en signification.
Il est curieux en effet de constater, et alors que déjà en France, le champ de l'héritage historique intégrait dans la catégorie des monuments historiques les architectures des XVIIIème et XIXème siècles, la conception du patrimoine au Liban, elle, reste restrictive de la période moderne et contemporaine, du patrimoine "arabe", dans sa version mamelouke et ottomane. De même, et alors que depuis la Révolution française, le domaine chronologique du patrimoine national s'était régulièrement élargi par des études architecturales et urbaines et par les découvertes des fouilles en cours, et avait englobé l'ensemble des biens de la Nation quel que soient leur type et leur inspiration, au Liban, on privilégie la recherche sur l'Antiquité, en retenant principalement la Phénicie, de même que les enquêtes sur les Croisés[28], qui sont "particulièrement émouvants au coeur des Français"[29].
On dégage l'Acropole de Tyr[30] et les sculptures du IIème millénaire de Sayda. On découvre, à Jbeil, le temple d'Isis et le temple et la nécropole des princes phéniciens de Byblos. Quant aux monuments laissés par les Croisés, ils font l'objet d'enquêtes approfondies : le monastère de Belmont, l'église de Saint-Jean de Jbeil et celle de Beyrouth, le château de Saint Louis à Sayda, des églises médiévales dans la région d'Amioun... Dégagés des constructions anciennes qui les encombraient, ces monuments sont restaurés et mis en perspective dans le décor urbain, sans être toutefois ramenés à la vie. En revanche, la période islamique, pourtant comprise dans les limites chronologiques légales, ne s'enrichit d'aucune découverte. On fait aussi l'impasse sur le patrimoine "arabe" récent, sur le riche héritage architectural et urbain du XIXème siècle ottoman, comme sur le patrimoine ethnique des nombreuses communautés autochtones qui composent la société (arménienne, maghrébine, assyrienne, etc.).
On constate alors que le patrimoine du Mandat, quelle que soit sa définition légale, n'est pas une succession chronologique d'éléments matériels sédimentés et bornés par les ruines en cours de découverte, d'un côte, et par les architectures récentes observées sur le territoire libanais, de l'autre, mais une série d'objets exclusifs appartenant à de périodes délimitées par des frontières idéologiques, des préjugés coloniaux.
Un schéma historique quintipartite doté d'un système de valeurs patrimoniales au service de l'occupant se construit donc ; il va d'ailleurs s'ancrer durablement dans la mémoire collective jusqu'à nos jours. Des cinq grandes périodes historiques que le pays a traversées, l'Antiquité, les Croisades et l'Indépendance sont des phases de grandeur et de progrès. Les Arabes et les Turcs sont par contre considérés comme des âges intermédiaires, et sont rapidement écartés ou passés sous silence[31]. Par suite, et sans se soucier des aberrations historiques et géographiques[32] et faisant fi de l'opinion de la population, le Liban est décrété phénicien d'origine et la Syrie voisine araméenne[33]. C'est dire que ces deux pays ne sont ni frères, ni arabes, histoire de rendre illégitimes les revendications des nationalistes qui luttent contre l'occupation[34]. On ne cherche effectivement pas seulement une légitimité aux territoires découpés et aux identités reconstruites, mais aussi une explication à l'occupation, par des mythes s'il le faut, et surtout à l'appropriation d'une ville, pour la rebâtir.
Nous connaissons la suite : engageant impérativement la ville dans un processus ouvert aux idées urbanistiques de la France, dans lesquelles les modes de construction locaux[35] n'ont aucune place, un projet d'urbanisme, baptisé "Beyrouth en cinq ans", nivelle la quasi-totalité de l'espace du centre-ville entre les deux percées de Jamâl Bâchâ[36]. Un centre moderne sera alors érigé, à l'endroit même du coeur historique de la cité, survivance des phases urbaines arabe et méditerranéenne des XVIIIème et XIXème siècles. Les soûq seront remplacés par un système radial d'avenues bordées de galeries et d'immeubles hauts, de style néo-mauresque, moderne ou art déco et convergeant toutes vers une place centrale, la place de l'Étoile[37]. Comme pour déguiser l'opération derrière une image suggestive du respect des traditions et, par ricochet, du rôle protecteur de la France, le Mandat adopte des façades de style néo-mauresque pour les bâtiments publics[38], un style qui, paradoxalement, est encore très peu répandu à Beyrouth[39], et avec lequel on va quand même marquer la nouvelle centralité.
Avec l'Indépendance, un héritage tronqué
À l'Indépendance, l'État libanais tente de mettre, non sans difficulté, une sourdine aux manifestations du sectarisme culturel et religieux prôné durant l'occupation, en respect pour la formule "Ni Orient, ni Occident" qui a servi de leitmotiv au Pacte de 1943 et qui veut rétablir l'équilibre entre les Chrétiens et les Musulmans du Liban.
Le dispositif juridique dressé par le Mandat est cependant reconduit et les recherches restent orientées vers les fouilles archéologiques des ruines antiques, à charge d'une institution nationale nouvellement née, la Direction Générale des Antiquités, les monuments récents demeurant généralement d'un intérêt secondaire dans l'échelle des priorités nationales[40].
On relève, néanmoins et pour la première fois, une extension typologique et chronologique officielle du domaine patrimonial, mais selon une loi non écrite. Le schéma des périodes historiques à cotes inégales remonte sur la scène politique et investit l'idéologie officielle du pays, acclimaté sûrement aux besoins récents, la construction nationale. À cet effet, on ressaisit les préjugés coloniaux vis-à-vis de la période ottomane, que l'on amplifie par les manuels scolaires et par des campagnes médiatiques, élaborant au passage toute une représentation idyllique des émirs du Liban, promus, pour la bonne cause, en ennemis des Ottomans et donc en Pères de la Nation. Le palais de Beiteddin et quelques exemples emblématiques (ou prétendus comme tels) des XVIIIème et XIXème siècles sont progressivement ranimés[41], symboles d'un patrimoine prétendu "typiquement libanais", cru euphorisant pour la conscience collective, et, au demeurant, bénéfique au tourisme naissant capteur de revenus. Mais on ne souffle mot de tous les autres monuments de ce passé récent, que l'on néglige ou détruit : les nombreuses citadelles et palais qui parsèment le territoire, les couvents et les églises de la montagne, les khân, hammâm, fontaines, mosquées et églises des villes principales[42]..., objets tous visibles à l'oeil nu pour celui qui veut bien voir.
Mais bien plus curieuse est l'utopie de la maison à trois arcades et toiturée de tuiles rouges[43], qui, à la suite de quelques études intéressantes effectuées par des architectes dans les années 1960[44], fait l'objet d'un culte populaire absolu. Conférences et expositions[45] sont consacrées à cette architecture mineure : une première dans l'itinéraire historique du patrimoine au Liban. Baptisée "maison libanaise" ou "habitat traditionnel", elle serait l'aboutissement d'un processus débuté à l'Âge du fer, puis affiné par le temps et influencée, semble-t-il, par des styles vénitiens ou florentins, pour atteindre la forme parfaite que nous lui connaissons au tournant du XXème siècle. Secouée par quelque étrange sentimentalité, sans doute un besoin d'identité, la population s'empare de ce cliché, qui symbolise, croit-elle, sa personnalité, mais que n'étayent malheureusement aucun savoir historique et aucun principe sélectif, étant construit à partir d'observations empiriques et de généralisations rapides[46]. Il est effectivement manifeste que cette architecture domestique, qui s'étend approximativement du sud de la Turquie jusqu'en Palestine n'est pas seulement propre au Liban. Née en outre vers 1850 et épuisée dans les années trente, il serait plus logique alors de parler d'étape que de tradition.
Mais qu'importent ces considérations pour un patrimoine "à la carte" vraisemblablement, puisqu'une fois de plus, on fait l'impasse sur les édifices contemporains de la maison aux trois arcades, surtout le dâr, la maison traditionnelle avec sa cour centrale à ciel ouvert[47], qui a vécu, elle, durant plusieurs centaines d'années, avant de disparaître aussi au début de notre siècle. De même, on occulte l'habitat traditionnel collectif, pourtant bien lisible dans les gravures et les photographies anciennes[48] et encore répandu dans toutes les villes du Liban, comme on écarte d'ailleurs les autres formes architecturales domestiques et publiques du XIXème siècle ottoman[49]. Car, rien n'est plus exemplaire de l'être libanais que cette maison aux trois arcades, objet d'une patrimonialisation procédant par ailleurs de la base pour la première fois.
Quels sont les mobiles de cette ferveur pour la maison aux trois arcades : la recherche d'un miroir pour se voir, d'une image à révéler ou un manque à combler ? Serait-ce la résistance de la bourgeoisie beyrouthine au Mouvement moderne dont les réalisations commencent à mettre en cause le cadre construit préétabli, balayant ses signes extérieurs et les codes sociaux qu'elle y avait établis[50] ? Serait-ce la réponse "nationaliste" d'une certaine élite, chrétienne notamment, face à la remontée de l'arabisme, dans sa version nassériste qui mobilise fortement au Liban ? Ne serait-ce pas plutôt une réaction "citadine" face à la laideur des quartiers surpeuplés de la banlieue (Chiyyah ou Fourn el Choubbak par exemple) et des bidonvilles occupés par les ruraux et les étrangers démunis, Libanais du sud, Palestiniens, Kurdes ou Assyriens, qui déferlent sur la capitale du Liban ?
Quoi qu'il en soit, la guerre civile arrive vite et dévie vers d'autres buts les incompréhensions.
Une crise identitaire qui perdure
À la fin de la guerre civile, la vie reprenant son cours normal, la question du patrimoine se réinstalle avec une exceptionnelle effervescence. Si la "maison libanaise" hante encore les esprits, elle n'accapare plus à elle seule l'élan affectif des Libanais, sensibles désormais à d'autres formes construites (architectures aux fantaisies florales du Mandat, immeubles de rapport du XIXème siècle ottoman, etc.), et même au patrimoine urbain arabe et vivant : soûq, placettes, fontaines et métiers anciens[51].
Mais, contrairement à la période précédente, des restaurations sont dorénavant entreprises par des particuliers ou quelques collectivités locales, comme par les grandes villes, Sayda, Tripoli et Beyrouth, alors que, curieusement, le débat public sur le patrimoine libanais est à peine commencé, n'ayant effectivement pas encore abouti à une action concertée dans un cadre de travail approprié ou à la création d'un appareil juridique adapté qui légitimise les opérations. On protège donc et on restaure hors de la loi, elle-même désuète, les règlements de 1933 n'ayant pas été réactualisés. Et on procède toujours sans inventaires et sans méthodes de classement des monuments publics et domestiques, et sans études historiques préalables des espaces urbains[52]. La mise en histoire des villes elles-mêmes n'est d'ailleurs pas encore perçue par l'élite intellectuelle, les responsables universitaires[53] ou les hommes politiques, comme une démarche scientifique primordiale[54].
Les incompréhensions perdurent alors tant sur le contenu que sur les époques, de même que les confusions de styles, d'influences et de périodes. Le "pourquoi" de la conservation et de la restauration (pour l'art ? pour l'histoire ? pour la société ?), n'est pas dit. On reste alors sans réponse quant à la vertu du patrimoine, comme on est par ailleurs sans connaissance quant à l'ampleur de la sollicitation et à la nature des protagonistes. Pour l'heure, la controverse va apparemment dans tous les sens. À croire que l'opacité arrange tout le monde.
Dans l'intervalle, si des restaurations de demeures particulières et d'immeubles de rapport dans le centre-ville de Beyrouth sont menées en connaissance de cause, il faut reconnaître que les saccages se poursuivent ailleurs, impunément et le plus souvent au nom du patrimoine même. Il n'est que de rappeler les dommages effectués régulièrement aux monuments civils et religieux, et à certains sites urbains, au nom de la restauration : le décrépissage des intérieurs des anciennes églises de la montagne, par exemple, pour mettre à nu la pierre à bâtir et rétablir l'état prétendu originel de ces monuments[55] ; ou les fouilles archéologiques du centre-ville de Beyrouth, qui se sont faites, et qui continuent à se faire, au détriment de la ville moderne et contemporaine, mais dissimulées sous le discours patrimonial des archéologues libanais et étrangers, comme des experts de l'UNESCO. Mais plus stupéfiante encore est la reconstruction ex nihilo, et sous l'apparence de l'expertise de quelques urbanistes, de cadres urbains dits traditionnels, tels les soûq de Beyrouth ou ceux de Sayda, mais sans études historiques et architecturales préalables de ces lieux, sur les conditions de leur formation, leur forme et leur fonction antérieures, ainsi que sur leur utilité future.
Il reste alors que le patrimoine, au Liban, dénué encore de sens intrinsèque, n'a toujours que valeur d'enjeu commercial et politique. C'est bien plus un instrument de discorde, reflet de la fragmentation de la société, qu'un thème national fédérateur.
Conclusion
Notion construite en Europe depuis le temps de la Renaissance, le concept de patrimoine a suivi une longue élaboration, faisant le chemin avec les grands moments de l'histoire des pays occidentaux : mise en place du nationalisme, métropolisation et haussmanisation, avènement de la culture industrielle... Ayant conquis des peuples entiers, il connaît aujourd'hui une grande actualité[56]. Il en est autrement au Liban.
Sans véritable portée sous les Ottomans, la question patrimoniale s'est installé effectivement au Liban avec le Mandat français, qui s'est occupé à souligner des dissemblances identitaires intérieures pour justifier l'occupation. Reprise ensuite par les Libanais et mise au service de la construction nationale, cette question servit en réalité à couvrir les enjeux hégémoniques d'une partie de la société ou encore à consolider les vues identitaires de groupes particuliers. Composé de quelques objets symboliques d'un héritage tronqué et construit d'a priori historiques, le patrimoine fut, et il est toujours, un instrument propice à marquer des inégalités, plus qu'un legs appartenant au peuple tout entier. Privatisé, en quelque sorte, il a aussi permis de gommer, en toute légitimité, des pans entiers du passé, comme ce fut le cas pour le riche héritage ottoman. Dès lors, ce concept antinomique et sans ancrage historique n'a pu jouer qu'un rôle national contraire à celui pour lequel il fut ailleurs inventé.
Il semble alors que la question est moins dans l'objet lui-même que dans ce qu'il représente aux yeux de certains Libanais, les destructions étant bien la preuve que les Libanais ne sont pas d'accord sur un passé partagé. Cela pose, en tous les cas, le débat sur l'histoire du Liban, une histoire qui soit acceptée par toutes les composantes de l'État libanais et dans laquelle tous les citoyens puissent se retrouver sans crainte. Partant, il y a une histoire à restituer et sans doute d'autres départs à prendre. Plutôt que de s'attacher à corroborer les traces matérielles d'une identité immuable et définie d'avance une fois pour toutes par certaines élites et quelques confessions[57], le patrimoine se définit et se construit avec l'ensemble des vestiges accumulés, apports civilisationnels de tout un chacun, individu ou communauté, beyrouthin, tripolitain ou montagnard, autochtone ou étranger, musulman, juif ou chrétien, arménien, palestinien ou assyrien.
Si donc le patrimoine n'existe pas per se, n'étant en réalité qu'un concept, il peut néanmoins participer à de nouveaux départs, celui des identités "nationales" assumées. Car, le patrimoine, son invention et son acceptation sont des sujets d'enjeux identitaires, et donc de mises sociales et politiques.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
ABDELNOUR A., 1896 : QANOUN AL ABNIYAT WA QARAR AL ISTIMLAK. BEYROUTH, AL MATBAAT AL ADABIYYAT, 105 P. ABOUSSOUAN C., 1985 : L'ARCHITECTURE LIBANAISE DU XVèME AU XIXèME SIèCLES. BEYROUTH, LES CAHIERS DE L'EST, 391 P. ANONYME, S.D. : 15 ANS DE MANDAT, 69 P. AZAR (LE P.), 1852 : LES MAROUNITES. CAMBRAI, FéNéLON DELIGNE ET ED. LESNE, 192 P. BéGUIN F., 1983 : ARABISANCES, PARIS, DUNOD, 170 P. CHAHINE R., 1996 : LIBAN, IMAGES DU PATRIMOINE. BEYROUTH, ÉDITIONS R.A. CHAHINE, 160 P. CHBARO I., 1987 : TARIKH BAYROUT MOUNZOU AQDAM AL OUSOUR HATTA AL QARN AL ICHRIN. BEYROUTH, DAR MISBAH AL FIKR, 342 P. CHEIKHO L., 1993 : BAYROUT TARIKHOUHA WA ATHAROUHA. BEYROUTH, DAR AL MACHREQ, 199 P. CHOAY F., 1996 : L'ALLéGORIE DU PATRIMOINE. PARIS, SEUIL, 261 P. CHOPIN (LE P.) 1891 : FRANCE ET SYRIE, SOUVENIRS DE GHAZIR ET DE BEYROUTH. TOURS, ALFRED MAME ET FILS. COLLECTIF, 1970 : BEIRUT - CROSSROADS OF CULTURES. BEYROUTH, LIBRAIRIE DU LIBAN, 220 P. DAHER G., 1994 : LE BEYROUTH DES ANNéES 1930. BEYROUTH, GIHAD ACHKAR, 139 P. DARAOUNI H., 1901 : "TADBIR AL SOUHHAT FI BAYROUT, AL MASKAN". AL MACHRIQ, NDEG. 7, PP. 700-704. DAVIE M. ET NORDIGUIAN L., 1987 : "L'HABITAT URBAIN DE BAYROUT AL QADIMAT". BERYTUS (BEYROUTH), VOL. XXXV, PP. 165-197. DAVIE M., 1996 : BEYROUTH ET SES FAUBOURGS, 1840-1940 : UNE INTéGRATION INACHEVéE. BEYROUTH, CERMOC, 153 P. DEBBAS F., 1994 : BEYROUTH, NOTRE MéMOIRE. PARIS, ÉDITIONS HENRI BERGER, 256 P. DEBBAS F., 1996 : LE MONT LIBAN, PHOTOGRAPHIES ANCIENNES. PARIS, ÉDITIONS FOLIOS. FANI M., 1996 : L'ATELIER DE BEYROUTH, LIBAN 1848-1914. PARIS, L'ESCALIER, S.P. HABIB É., 1997 : BAYROUT AL TOURATH. BEYROUTH, S.éD., 104 P. HAUT COMMISSARIAT DE LA RéPUBLIQUE FRANçAISE EN SYRIE ET AU LIBAN, 1935 : RèGLEMENTS SUR LES ANTIQUITéS. BEYROUTH, 41P. ITANI M. ET FAKHOURI A., 1996 : BAYROUTOUNA. BEYROUTH, DAR AL ANIS, 231 P. JARKAS R., 1996 : BAYROUT FIL BAL. BEYROUTH, RIAD EL-RAYYES BOOKS, 172 P. JIDéJIAN N., 1971 : SIDON THROUGH THE AGES. BEYROUTH, DAR AL MACHREQ, 287 P. JOUPLAIN M., 1961 : LA QUESTION DU LIBAN (RééDITION DE L'OUVRAGE DE 1908). JOUNIEH, IMP. BIBAN, 557 P. KALAYAN H. ET LIGER-BELLAIR J., 1966 : L'HABITATION AU LIBAN. BEYROUTH, PUBLICATION DE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET ANCIENNES DEMEURES, 2 VOL., 81 ET 85 P. KFOURY S. 1985 : "ORIGINES, INFLUENCES ET éVOLUTION DE LA MAISON TRADITIONNELLE AU LIBAN". L'ORIENT-LE JOUR DU 10, 14, 16 ET 17 FéVRIER ET DU 6 MARS 1985. KHATIB (AL) N., 1995 : BAYROUT AL TOURATH. BEYROUTH, CHARIKAT AL MATBOUAT LIL TAOUZI WAL NACHR, 107 P. LAMMENS H., 1994 : LA SYRIE, PRéCIS HISTORIQUE (RééDITION DE L'OUVRAGE DE 1921). BEYROUTH, DAR LAHAD KHATER, 389 P. MACHNOUK M., 1994 : BEIRUT, MORNING GLORY. BEYROUTH, MASTERS PUBLICATION COMMUNICATION, 56 P. MALLAT H., 1996 : RENAN AU LIBAN, 1860-1861. BEYROUTH, FMA, 132 P. MORICONI-ÉBRAD F. ET PUMAIN D., 1996 : "L'EUROPE". IN : LE MONDE DES VILLES, PANORAMA URBAIN DE LA PLANèTE, éDIT. PAQUOT T., PARIS, ÉDITIONS COMPLEXE, PP. 79-100. PINSON D., 1996 : ARCHITECTURE ET MODERNISME. PARIS, FLAMMARION, 128 P. RAGETTE F., 1974 : ARCHITECTURE IN LEBANON. THE LEBANESE HOUSE DURING THE 18TH. AND 19TH. CENTURIES. BEYROUTH, AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT, 214 P. RAGON M., 1995 : L'HOMME ET LES VILLES. PARIS, ALBIN MICHEL, 213 P. REBEIZ K. G., 1986 : RIZQALLAH A HAYDIL AL AYYAM YA RAS BAYROUT. BEYROUTH, AL MATBOU`AT AL MOUSSAWARAT, 191 P. SALAMé-SARKIS H., 1984 : "L'ARBRE GéNéALOGIQUE DANS LE DISCOURS HISTORIQUE LIBANAIS". ANNALES D'HISTOIRE ET D'ARCHéOLOGIE DE L'UNIVERSITé SAINT-JOSEPH, BEYROUTH, VOL. 3, PP. 35-66. SAULCY (DE) F., 1853 : VOYAGE AUTOUR DE LA MER MORTE ET DES TERRES BIBLIQUES. PARIS, GIDE ET BAUDRY éDITEURS, 2 VOL., 339 ET 655 P. YAMMIN M., 1994 : LOUBNAN AL SOURAT. BEYROUTH, JARROUS PRESS, 384 P. YOUNG G., 1905 : CORPS DE DROIT OTTOMAN. OXFORD, CLARENDON PRESS, VOL. 2, 411 P.
Revues
Asie Française, 1924, NDEG. 219. La Revue Phénicienne, 1938-39, réédition Dar an Nahar et Revue Phénicienne, 1996. Phénicia, collection 1919, réedition Dar an Nahar 1996. Al Ahrar al Mousawwar, 1926-27, réédition Dar an Nahar 1995.
|
 al@mashriq 970612 |