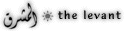
|
|
Colloque international "PETITES VILLES ET DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS LE MONDE ARABE" URBAMA, Tours 28-30 juin 1994
6ème session: "La petite ville, berceau de la citadinité: à l'articulation des dynamiques locales et des politiques étatiques, un pôle stratégique pour le développement?"
LES BANLIEUES DE BEYROUTH: ESPACES DE CRISE
Michael F. DAVIE[*]
Les espaces péri-urbains de Beyrouth, ses banlieues proches et lointaines, offrent deux visages: celui d'un aspect extérieurs d'un développement -- diversité sectorielle, étalement spatial, modernisme -- et celui qui révèlent que ces mêmes espaces sont en crise profonde: bidonvilles, squatterisations, dysfonctionnements sociaux.
Espace de développement car ce sont les lieux d'une extension spatiale surprenante mise en place durant les vingt dernières années et paradoxalement durant la période violente de son histoire, la guerre de 1975-1990. L'afflux de personnes depuis toutes les strates de la société, a fixé des populations selon des densités différentes là où quelques années auparavant s'étalaient de riches terrains agricoles du littoral, sinon sur des friches récentes en moyenne montagne. Cette redistribution de la population du Liban autour de la capitale a redéfini les fonctions centrales de Beyrouth. Elle a permis l'émergence d'opportunités d'investissement, notamment dans le foncier et l'immobilier, encouragé la consommation et la circulation de capitaux, ressuscité des villages moribonds ou en déclin. Elle a accéléré la circulation de capitaux et lancé la consommation, dynamisé les comportements démographiques. Enfin, les espace péri-urbains de la capitale ont acquis un sens et une fonction politiques qu'ils n'avaient pas avant la guerre.
Espaces de crise aussi car l'urbanisation s'est mise en place sans contrainte aucune, sans planification, sans projet urbain de la part des institutions et acteurs de l'État. Il n'y a donc eu ni équipements ni d'infrastructures publiques adaptées installés dans ces nouveaux espaces. La construction a pris aussi bien des aspects informels, illégaux, des logements de qualité très médiocre, mais aussi des aspects somptueux avec toute la gamme intermédiaire, dans une proximité spatiale surprenante. Les banlieues étaient le lieu de spéculations foncières éfrénées, mais aussi de d'actes illégaux de main-mise sur le foncier privé ou étatique, de spoliations de droits. Avec les migrations depuis la campagne ou depuis les autres villes du Liban, c'était aussi le lieu d'intenses migrations intra- et inter-quartiers, dont certains étaient forcées. Des espaces à la fois de mal-vivre et de manifestations ostentatoires de réussite, c'étaient des espaces fragmentés en territoires idéologiques fermés, intolérants, sans les espaces publics nécessaires à la régulation sociale. Les banlieues de Beyrouth présentent ainsi des caractéristiques communes à celles de nombre d'autres villes du Tiers-Monde avec cependant une variable supplémentaire, celle de la violence.
Notre intervention se veut une approche de ces banlieues[1] comme expressions physiques de stratégies d'acteurs, individus ou groupes qui ont évolué dans un cadre dépourvu de contraintes. Le résultat a été une somme d'espaces qui se sont peu articulés à la ville elle-même, mais qui ne sont pas, non plus, articulés entre eux. La fragmentation de l'espace, expression de logiques de survie en période de violence, est la cause et la conséquence d'une fragmentations sociale: elle porte en elle les germes de violences futures.
Les banlieues, production spatiale par des acteurs sans contraintes
Les banlieues ne sont pas évidemment que l'espace physique encerclant la ville, le simple cadre des activités; ce sont surtout l'expression de l'action de l'Homme, individus comme groupe sociaux, sur le site, avec leurs stratégies et leurs représentations. Ces sociétés n'étant pas socialement homogènes, les différentes banlieues de Beyrouth ne peuvent être extérieurement semblables. Les différentes densités et fonctions, la variété des composantes confessionnelles, la diversité socio-économique, les particularismes socio-démographiques, les appartenances idéologiques instables ont produit des espaces divers encerclant une ville elle-même intérieurement complexe. Chaque espace a eu une histoire différente; chacun a connu des trajectoires particulières; chaque espace actuellement en constitution a sa logique propre dans le continuum temporel et spatial de la capitale. Les banlieues de Beyrouth ne présentent alors aucune originalité par rapport aux autres grandes villes du "Sud" vues au prisme de ces approches.
Cependant, Beyrouth offre une particularité originale: la vaste majorité des espaces mis en place depuis 1975 se sont structurés dans un cadre dépourvu de contraintes institutionnels. La guerre a en effet balayé toutes les formes extérieures de la présence de l'État, neutralisé ses institutions et muselé les organes de contrôle. Sur le terrain, cela s'est traduit par la multiplication d'espaces bâtis dans l'illégalité la plus totale sinon dans un respect formel et superficiel de la légalité. Les codes de l'urbanisme, les lois sur la construction ont été ignorés ou contournés, comme ceux du foncier. Parallèlement, l'effondrement de l'État a eu comme corollaire la fin des recours légaux et l'absence de toute protection contre les excès: la population était soit livrée à elle-même, soit prise en mains par les milices et les institutions communautaires qui dictaient de manière explicite ou implicite le comportement spatial de ces populations. Les pouvoirs de remplacement autorisaient ou réprimaient la production spatiale, au gré des conjonctures et tactiques politiques.
En conséquence, la division spatiale et fonctionnelle de l'espace péri-urbain de Beyrouth répond mal en première lecture aux modèles classiques (divisions sectorielles de l'espace, ségrégations plus ou moins voulues, aréoles résidentielles et pôles structurants, uniformisation relative des comportements sociaux et politiques); il serait plutôt l'illustration d'un modèle aux manifestations externes d'incohérence, d'irrationnel, de dés-ordre. Pourtant, ces espaces ne sont pas le fruit de décisions, de stratégies, de comportements aléatoires. Le développement local, les choix spatiaux, la production d'espaces bâtis se sont articulés dans le cadre d'une économie libérale couplé cependant aux contraintes de la guerre qui a conditionné la recherche d'espaces de sécurité.
Trois cas illustreront cette articulation.
Les différentes invasions du Liban par l'armée israélienne, puis les opérations de contrôle du Sud-Liban ont poussé des centaines de milliers d'habitants à fuir cette région et s'installer dans des régions plus sûres: la banlieues méridionnale de Beyrouth. Ces espaces, pour partie encore vouées à une agriculture en crise, sinon des espaces libres dans des dunes littorales, étaient situés en marge de la ville en guerre. Le territoire de Beyrouth-Ouest, contrôlé par des milices idéologiquement diverses mais confessionellement semblables (les différentes sectes musulmanes) offrait un cadre de refuge. L'absence de l'État et des organes de quadrillage du territoire permettaient une installation rapide et sans contraintes. Cette région était en effet déjà en partie colonisée par des Chi`ites "montés" à Beyrouth durant les années 1960 pour fuir la misère du Sud, mettant ainsi en place des structures d'accueil encadrés, plus tard par une milice, dans des périphéries de villages préexistants; la présence palestinienne armée y était encore sensible, ce qui mettait toute la région hors-limites d'un contrôle spatial étatique. Il s'est constitué un territoire aux multiples visages: des espaces déjà constitués autour des villages de la région, mais vidés de leurs occupants et squattés par les nouveaux arrivés. Une fois le remplissage effectué, les bâtiments ont été étendus horizontalement (sur les jardins et autres espaces libres), et en hauteur, par rajouts d'étages. Autour de cet espace préexistant, la construction de logements de fortune, vite consolidés, sur des parcelles vouées aux cultures maraîchères a été la norme. Enfin, des lotissements illégaux, effectués avec la bénédiction et la protection des milices, sur des terrains appartenant à des propriétaires absents a donné lieu à la construction puis la vente d'appartements de standing.
Ainsi, l'insécurité à 100km de Beyrouth a enclenché des processus de migrations qui ont abouti à un développement local, la construction de banlieues structurés et organisés, quadrillés par des institutions idéologiques, éducatives et sanitaires miliciennes. Cette "banlieue", en fait la fusion des périphéries de noyaux préexistants et le remplisage des "vides", peut être qualifiée de fruit de décisions individuelles, de familles mais aussi d'éléments d'encadrement de la société dans un contexte d'absence de toute contrainte, de toute "friction" dans l'espace géographique. A l'échele du quartrier, la dynamique locale a permis l'émergence de fonctions centrales, souvent, mais pas toujours, à l'emplacement des centres ou des axes majeurs des noyaux préexistants, une ségrégations socio-économiques, des concentrations selon des appartenances géographiques des familles élargies. Le tri urbain a fonctionné dans ce cadre qui a émergé pratiquement ex nihilo.
2) Ce mouvement depuis le monde rural vers une banlieue n'était pas toujours la norme. La guerre a aussi provoqué des migrations, souvent forcées, depuis la ville stricto sensu vers les banlieues. Il s'agit de déplacements affectant la classe salariée, les classes moyennes et aisées de Beyrouth vers les espaces situés sur le littoral ou sur les premières pentes du Mont-Liban. Les raisons déclenchant la migration sont celles de la recherche d'espaces de protection, eux-mêmes identifiés en fonction de leur homogénéité confessionnelle et donc l'appartenance de ces espaces aux territoires miliciens, leur niveau social, leur accessibilité aux nouveaux lieux de travail, et enfin, la portée des armes. De façon synchrone, ces espaces ont aussi accueilli des migrants venant de petits bourgs affectés par la violence.
Les lieux d'accueil vont connaître un développement, voire une existence ex nihilo, engendrés par la satisfaction de cette demande sécuritaire: les versants du Mont-Liban central surplombant la ville, entre Jouniyé, au Nord, (dans le territoire "chrétien"), les hauteurs de Khaldé, au Sud (un noyau sunnite dans le territoire "musulman"), de nouveaux pôles dans le Chouf (le territoire "druze") ont été rapidement déboisés et construits. Ces espaces prenaient appui, souvent, sur des noyaux de villages preéxistants, produisant des auréoles "modernes" à l'architecture standardisée autour des villages aux vitesses de mutation plus lentes. Ils se sont articulés le long de grands axes à portée stratégique que les milices avaient consolidés pour articuler leurs territoires[2].
Dans l'ensemble de ces espaces, le jeu de l'offre et de la demande a battu son plein, surtout aux moments de grande violence à Beyrouth. Des terrains agricoles en crise, en friche ou abandonnés depuis près d'un demi-siècle (les pentes aménagés en terrasses de la moyenne montagne) ont été vendus directement par leurs propriétaires à ces "immigrés"[3], qui y ont construit leur résidence sans se soucier des équipements de base municipaux: égouts, électricité, eau, route d'accès, etc. Les municipalités étaient d'ailleurs bien incapables d'assurer ces services, les milices récupérant une partie des impôts locaux, exemptant la population d'en payer, sinon offrant une protection lors des sommations municipales de payer. Un second cas est celui de la vente de terrains lotis à des particuliers. Ces terrains avaient été préalablement achetés par des spéculateurs, que l'on peut quelquefois identifier à des proches des milices, à des particuliers émigrés ou même à l'Église[4]. Les capitaux qui ont servi à la constitution des lotissements et à l'achat de terrains par les particuliers étaient souvent des retours de fortunes accumulés à l'étranger (le Golfe, la Péninsule arabique) ou des profits de guerre. Le développement local est ainsi la conséquence directe de la disponibilité de capitaux injectés directement ou indirectement dans l'économie profitant d'une conjoncture de guerre.
3) Des migrations inter-banlieues sont un autre aspect de la constitution des espaces péri-urbains de la ville; elles se comprennent dans de contexte de logiques de mobilité sociale dans un environnement d'homogénéisation confessionnelle. La mobilité sociale s'exprime de deux façons: vers le haut de la pyramide, par suite d'accumulation de capitaux durant la guerre, ou vers le bas, par suite de perte d'emploi, de logement, du gagne-pain, du pouvoir d'achat avec la dévaluation de la monnaie nationale. Dans les deux cas, la mobilité spatiale a conduit à la constitution de nouveaux espaces géographiques, architecturalement typés: Adma, New Naccache, Baabda pour les classes aisées; remplissages de Naba`a, Haret el Ghawarné, à l'autre extémité de l'échelle sociale.
Dans ce groupe, on peut aussi ajouter les mouvements intra-banlieues, qui dénotent des stratégies individuelles (ou de ménages) en fonction des opportunités conjoncturelles: libération de logements par éviction, squatterisations autorisés ou encouragés par les milices, accès à la propriété par suite d'apports de capitaux par solidarité familiale, par l'économie de guerre. Elles sont l'expression d'une multitude de stratégies d'acteurs et de conjonctures très locales. Toutes, cependant, ont un point commun: elles se sont mises en place sans l'intervention de contraintes (ne serait-ce que dans le cadre de plans d'urbanisme), de régulation sociale, et dans un contexte de liberté économique totale.
Les banlieues, espaces fragmentés
Il s'ensuit que la morphologie urbaine des banlieues n'est pas nécessairement l'expression de sa composition sociale: la fragmentarité est poussée à l'extrême, la distance sociale et spatiale se réduisent ici à leur plus simple expression. Cependant, malgré cette liberté dans leur mise en place, les banlieues de Beyrouth ne sont pas des espaces géographiques "purs", expressions du jeu entre l'offre et la demande d'espaces selon les modèles classiques. On ne retrouve pas, par exemple, le modèle des auréoles concentriques autour d'un centre urbain; ni même celui des auréoles sectorisées homogènes; ni même des espaces fonctionnels hiérarchisés autour de centres-relais. Les banlieues de Beyrouth sont des espaces amorphes, non structurés entre elles et surtout désarticulées par rapport à la ville.
Ainsi, chaque banlieue s'est constituée en espace fortement autonomisé, ayant chacun son espace à fonctions centrales, ses auréoles grossièrement structurés, ses articulations à la voie principale de circulation. Cependant, dans le détail, ces espaces aussi sont celles de la mise en place de fonctions qui ne répondent à aucune logique de groupe ou de cadre urbain. On pourra, par exemple, trouver un noyau de boutiques de luxe dans un quartier résidentiel, à l'écart de toute route passante, dans un lotissement très récent; elles n'ont aucune fonction de proximité, ne répondent à aucune demande. Elles sont l'expression d'un investissement spéculatif individuel d'un surplus de capitaux qui n'ont aucune finalité de rentabilité immédiate. On pourra trouver une agence de banque, isolée dans un cadre semi-rural, sur une route passante. Cette fonction d'espace central se trouve ainsi éjectée de son cadre habituel.
On pourrait penser que les banlieues auraient des liens privilégiés entre elles; il n'en est rien. Entre une banlieue et une autre, aucune hiérarchie de fonctions, aucune complémentarité; toutes les fonctions -- hormis celles de l'État -- sont présentes, et on ne pratique que celles de "son" quartier.
Cette fragmentarisation des banlieues entre elles est à mettre en relation avec l'absence du rôle dévolu à Beyrouth. En effet, la guerre a non seulement détruit son centre fonctionnel, politique et symbolique, mais aussi l'ensemble des réseaux qui s'étaient tissés entre la capitale et ses espaces périphériques. La coupure de la ville en deux territoires distincts (Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest) n'a fait que déstructurer la trame du territoire.
En admettant que la guerre a été l'oeuvre de populations périphériques allant à la conquête de la centralité nationale, il s'ensuit que les périphéries de la ville ont intégré le centre dans leur espace et logiques propres, chacun de part et d'autre de la ligne de démarcation. Ayant les mêmes fonctions, étant tous les deux déconnectés du centre, cet espace amalgamé de la ville et du péri-urbain a constitué un espace sans référents, sans structuration économique. Car la fusion s'est effectuée sans la mise en place de centres de remplacement qui auraient pu jouer un rôle structurant de l'espace. Mise à part la petite ville de Jouniyé-Kaslik, à qui, pour des raisons de constitution de territoires confessionnels, les milices lui ont conféré un rôle de "capitale" régionale[5], l'ensemble des banlieues s'articule sans centres de relais. Il s'ensuit un espace (un territoire édulcoré) aux centralités diverses et faiblement articulées entres elles.
Au plan institutionnel, ces espaces sont certes formellement gérées par des municipalités. Cependant, submergées par l'afflux de migrants, elles n'avaient pas la capacité de prendre la moindre initiative, ni même d'assurer la mise en place ou la gestion élémentaire des services urbains de base. D'ailleurs, les municipalités elles-mêmes n'étaient plus l'émanation politique d'une quelconque expression des résidents, les dernières élection remontant à plus de vingt ans. Quant aux autres représentants, les députés, ils ne représentaient pas la population résidente, puisque la loi électorale libanaise n'autorise que le vote dans son lieu "d'origine" quelles que soient les années passées ailleurs. Le dysfonctionnement démocratique a ainsi ouvert la voie au désengagement des institutions de l'État dans la gestion des espaces récemment urbanisés; le désintérêt apparent des habitants quant à l'avenir de leur espace de résidence s'explique par leur exclusion politique de ceux-ci. Sans droits, les populations ne pouvaient avoir des responsabilités, dont celle du respect de la Loi. Quant aux milices, elles n'ont proposé aucun plan de gestion de l'espace: leur finalité même, celle de la conquête du pouvoir liée à de ponctions rentières dans l'économie locale, interdisait toute vision dans ce sens. Pouvoirs de remplacement, elles n'offraient pas plus de démocratie que l'État; la population ne pouvaient se sentir entièrement solidaires.
Ainsi, au plan individuel, l'habitant s'est organisé l'espace selon ses propres stratégies, souvent celles de la survie, sinon de sa propre perception des espaces immédiats.
Les banlieues, espaces de nouvelles citadinités en gestation?
Se pose alors la question de la citadinité en gestion dans ces territoires atomisés, sans solidarité sociale aucune, sans hiérarchisation spatiale, sans démocratie. Car il est frappant de constater que les banlieues de la ville sont maintenant la ville elle-même, en attendant la reconstruction, controversée[6], de son centre. Or celui-ci, ne sera pas le sommet d'une pyramide hiérarchique de fonctions urbaines, mais simplement le lieu de la gestion d'un secteur économique particulier. Les différents centres de remplacement, construits durant la guerre, continueront à fonctionner pour leurs espaces propres situés en périphérie. L'atomisation économique sera ainsi maintenue, avec des spatialisations particulières, comme c'est actuellement le cas, sans articulations privilégiées avec la ville.
Celle-ci ne sera non plus le noeud de relations entre sujets sociaux regroupés autour de d'activités durablement stabilisées sur un territoire restreint. Les banlieues, lieux de dilution d'une ville amputée de son centre, ne sont peuvent être porteuses d'une citadinité particulière; elles ne sont pas le berceau d'une quelconque identité urbaine commune. Quel lien, en effet, entre un néo-urbain de Jouniyé et de Bir el-Abed? Quel sentiment de communauté de destin entre les habitants de la périphérie de Antélias et ceux de son centre? Quelles solidarités entre Jdaidé et de Chouaifât, entre Broummana et `Aley? Les différents territoires de Beyrouth et de ses banlieues produisent, chacun, leur propre citadinité, qui se réduit à une faible et simple identification aux lieux de résidence. Car enfin, la citadinité au sens fort va aussi de pair avec la démocratie locale, avec la participation à la définition et au devenir du rôle de l'espace. Sans démocratie locale, et donc sans démocratie au plan national[7], le citoyen-habitant est condamné à subir l'absence de la gestion de son espace de vie, à inventer des solutions médiocres pour sa survie et à suivre les idéologies d'exclusion. La fragmentarité spatiale et sociale est poussée à l'extrême et rejoint la fragmentarité idéologique.
Conclusion:
Les banlieues de Beyrouth sont ainsi en crise: crise existentielle et d'identité, car elles ne se sont pas définies une spécificité par rapport à un centre, à la ville. Crise politique, car elles sont des espaces sans représentation, sans relais dans les institutions étatiques; elles ont été récupérées par les idéologies d'exclusion et de violence. Crise économique car ces espaces ne portent aucune centralité locale ou nationale. Crise sociale car la distance sociale et la distance spatiale sont souvent proches.
C'est dans ces espaces que réside plus de la moitié de la population libanaise. Laissés à eux-mêmes, ils portent en eux les germes de la violence future.
Bibliographie
BODET, F., 1993: Télédétection appliquée à l'étude des extensions urbaines Sud et Est de Beyrouth-Liban. Utilisation d'une image SPOT de 1991. Mémoire de Maîtrise, Universté François-Rabelais, Tours. 133p.
DAVIE, Michael F., 1992: "La reconstruction de Beyrouth: quelles voies pour le futur?" Annales de Géographie (Beyrouth), Vol. 12-13, pp 65-77.
DAVIE, Michael F., 1994a: "Guerres, idéologies et territoires: l'urbanisation récente de la côte libanaise entre Jbayl et Sayda". Annales de Géographie (Paris), Ndeg. 575, pp 57-73.
DAVIE, Michael F., 1994b: Beyrouth, quelle ville pour quel citoyen? Publications de l'Institut du Monde Arabe. (sous presse).
DURAND, F., 1993: Télédétection et périphéries urbaines. Application aux extensions Nord-Est de Beyrouth (Liban). Interprétation d'une image SPOT de 1991. Mémoire de Maîtrise, Universté François-Rabelais, Tours. 169p.
Juin 1994
|
 al@mashriq 960325/960614 |