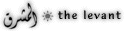
|
|
Université Michel de Montaigne (Bordeaux III) Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine Centre d'Études des Espaces Urbains Talence, 23-24 mars 1995 Colloque International "Villes en projet(s)"
DISCONTINUITÉS IMPOSÉES AU COEUR DE LA VILLE: LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE BEYROUTH
Michael F. DAVIE[*]
RÉSUMÉ:
Dans un premier temps, les stratégies des acteurs et promoteurs du projet de la reconstruction du Centre-Ville de Beyrouth seront examinées; dans un second temps, nous démontrerons que le nouvel espace projeté sera en discontinuité spatiale, économique, sociale et politique par rapport au reste de la ville. En conclusion, nous soulignerons qu'une ségrégation spatiale ou territoriale imposée dans une ville à peine sortie d'une longue guerre civile, en l'absence de structures démocratiques, pose les fondations de violences urbaines futures.
ABSTRACT: Imposed Discontinuities in the Heart of the City: The Reconstruction of Beirut Project
This paper will firstly examine the strategies of the various figures and promoters of the project to reconstruct Beirut. Secondly, it will demonstrate how the planned new area will be in spatial, economic, social and political discontinuity in respect to the rest of the city. In conclusion, it will stress that the spatial or territorial segregations imposed on a city that has just emerged from a long civil war and in which democratic structures are absent, will lay the foundations of future urban violence.
* * *
La ville de Beyrouth, depuis la fin de sa guerre en 1990, fascine. Non pas d'une fascination morbide pour les ruines, ces témoins d'une ville traumatisée et déchirée par la violence des hommes, mais pour la taille et l'ambition du projet de sa reconstruction. C'est une entreprise d'une échelle surprenante, 400 ha, qui vise à récréer ex nihilo le centre d'une importante capitale arabe, et non pas de réhabiliter ou de restructurer un espace préexistant historiquement riche. Ce nouveau centre-ville ne sera pas un clone modernisé du centre de l'avant-guerre, mais un nouvel espace articulé aux impératifs spatiaux de l'économie internationale par des acteurs précis qui visent à exciser le centre de la ville de son contexte historique, fonctionnel et sociologique, pour lui imposer de nouvelles morphologies et fonctions.
Le texte ci-dessous présentera ce projet de ville, analysera les stratégies des acteurs et soulignera surtout les discontinuités nouvelles que le projet va imposer au reste de la ville, dans un contexte d'absence de démocratie ou de régulation urbaine.
Le Centre-Ville: un enjeu stratégique de la guerre
Un rappel succinct des raisons de la destruction est nécessaire. Si la guerre à Beyrouth a essentiellement été une violence couvée et née en banlieue, elle s'est rapidement installée au centre même de la ville. Objectif stratégique à conquérir par les sociétés des périphéries, c'était l'espace vital pour leur survie et leur reproduction. Il abritait en effet aussi bien les lieux du pouvoir politique (le Parlement, des ministères-clés, la Municipalité), que ceux du pouvoir économique (le port, les sièges principaux des banques, les commerces). Contrôler le Centre-Ville, c'était garantir, pour ces populations de la périphérie, la pérennité d'une rente puisée sur l'économie de services qui avait permis l'affirmation de Beyrouth comme escale incontournable de la Méditerranée orientale depuis plus de 150 ans. La survie économique de ces populations issues de l'exode rural était assurée, comme l'était celle, politique, des élites s'étaient chargées de les représenter
La violence des combats dans l'espace commercial et financier central de l'économie libanaise traduit l'importance stratégique de l'enjeu. Après son pillage par les miliciens des deux bords, le centre est ensuite divisé par une ligne de séparation entre belligérants qui, avec le temps, est devenu une bande de destructions progressivement plus large, la "Ligne Verte", qui a englobé aussi bien le centre stricto sensu que les espaces péricentraux et les banlieues proches et lointaines.
Les plans de reconstruction avortés
Mais la guerre ne fut pas continue entre 1975 et 1990. De nombreux cessez-le-feu ont fait naître l'espoir d'un retour à la normalité urbaine et une réaffirmation de la centralité primatiale du Centre-Ville dans l'économie nationale et régionale. En 1977, le gouvernement libanais demande une aide technique de l'Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) pour la réhabilitation du Centre-Ville. Les idées sont conservatrices, privilégiant la réhabilitation des édifices endommagés ou leur reconstruction à l'identique, avec un souci d'améliorer la desserte de cet espace; les fonctions de celui-ci ne sont pas redéfinies en fonction de la nouvelle donne géopolitique ou économique. En quelque sorte, le plan de l'APUR signale que la ville n'avait pas sensiblement changé avec la guerre et qu'elle pouvait assumer à nouveau son rôle central dans l'économie locale, position qu'elle partageait, en partie, avec l'autre centre, plus "moderne", de la ville, la rue Hamra. Celle-ci était plus liée à la fois l'économie des pays productuers de pétrole et au Nord. Une reprise de la guerre met fin à ce projet.
En 1983, l'État fait appel à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile-de-France (IAURIF) pour établir un Schéma Directeur de la Région Métropolitaine de Beyrouth. Si Beyrouth est confirmée dans son rôle de centre des activités tertiaires, et ses industries et la main-d'oeuvre repoussées vers sa périphérie lointaine, il privilégie aussi la prise en compte des centres secondaires de la banlieue nés durant la guerre, dans une volonté de rééquilibrage social de la périphérie, mais en tenant compte aussi de la réalité des nouveaux territoires confessionnels. En effet, face à la destruction du Centre-Ville, des "centres de rechange" se sont développés, grâce à l'incitation active des milices, conscientes des effets structurants de ces centres sur les territoires idéologiques qu'elles quadrillaient. Le plan prévoit la reconstruction et la récupération de son rôle économique d'avant-guerre dans le contexte d'un État interventionniste en matière d'aménagement du territoire. Il signale aussi que le Pouvoir politique et économique a changé de nature et d'échelle. Il était précédemment issu des structures rurales ayant comme finalité des stratégies de positionnement au coeur du système politique qui lui permettait de ponctionner les surplus de la ville, généré par le commerce et les services, aux mains des citadins. Il est maintenant issu des milices structurées, beaucoup plus efficientes dans leur positionnement dans les rouages de l'État et de l'économie de la ville. Le pouvoir des années 1980 est à leur image: riche, monopolistique, ne souffrant d'aucune critique ni concurrence, il conçoit la ville comme un espace à son service exclusif dans un cadre qu'il quadrille parfaitement, le lieu de pérennisation de ses investissements financiers, et de la spéculation foncière. Le nouveau Centre-Ville est pensé comme l'espace de la constitution rapide de plus-values consistants et de la gestion des finances des milices et des ses successeurs.
Avec l'élimination des milices, en 1990, cette logique d'appropriation stratégique du Centre-Ville doit être révisée, car d'autres acteurs les ont remplacées.
Le plan actuel: collusion et confusion des pouvoirs
Cette fois-ci, les acteurs politiques sont également ceux du pouvoir économique mais ils opèrent à des échelles bien plus vastes. Entrepreneurs libanais des BTP installés à l'étrange, spéculateurs et financiers introduits dans les réseaux bancaires arabes et internationaux, ces acteurs ne sont pas issus de la ville de Beyrouth. Leur champ d'opérations est international et le Liban n'est que très marginal dans leur quête de profits. Pour eux, la ville est simplement un des lieux pratiques pour les échanges, tant par sa position géographique dans le monde arabe que pour ses avantages législatifs en matière de secret bancaire; ils n'y investissent que peu, et ne participent pas à son monde politique local. Leurs alliances sont ailleurs: l'Arabie Saoudite et les Émirats du Golfe, et par là, le Nord. Ce changement d'échelle induit une autre vision de l'utilité de la ville. Ce n'est pas le lieu de ponctions de rentes, un espace de survie, mais un lieu à structurer pour l'élite politique actuelle, dans le cadre d'une politique économique au service des finances régionales ou internationales et dans laquelle l'économie "nationale" ne tient qu'une place marginale. Aucune communauté autochtone ou territoire idéologique n'est en effet concerné par cette reconstruction.
L'instigateur du dernier plan est à la fois le Premier Ministre, l'homme le plus riche du pays et le PDG des institutions chargées de la reconstruction. Dar el-Handassah, une très importante société d'ingéniérie et de consultants, a préparé un plan de reconstruction, en liaison étroite avec OGER, l'entreprise d'ingéniérie au Premier Ministre. Grâce à sa position au coeur du pouvoir, le Conseil pour le Développement et la Reconstruction et la Direction Générale de l'Urbanisme, institutions étatiques, ont été invités à approuver ce plan privé.
Le plan concerne le Centre-Ville, un espace lentement élaboré pour des fonctions économiques tournées vers des besoins régionaux. Les raisons du choix de cet espace sont nombreux. Le Centre-Ville est après tout le lieu de la centralité symbolique de la ville: le point de convergence du réseau routier, le siège du pouvoir municipal, le coeur originel de la ville, la capitale de l'État. C'est aussi le lieu d'expression de la centralité politique et économique nationales: le Parlement, les sièges centraux des banques et des entreprises, le port et les souks, les ministères de l'intérieur, de l'économie. La ville ne peut être reconstruite ailleurs qu'en son centre.
Elle ne peut être que l'oeuvre du groupe au pouvoir. Pour cette raison, il faudra contrôler la propriété foncière. Or, en raison des partages d'héritages, la propriété était morcelée à l'extrême, les locataires et les autres ayant-droits étaient innombrables. D'où un problème majeur pour la reconstruction. Ne pouvant acquérir l'ensemble des titres de propriété, incapable aussi de solutionner la multitude de cas en litige, le pouvoir se crée alors une société foncière, SOLIDERE, puis fait voter des lois lui assurant la main-mise sur le Centre-Ville et le monopole de la reconstruction. Dès lors, il devient impossible aux propriétaires de réhabiliter ou de reconstruire leur propre parcelle; ils sont par contre contraints de céder leurs titres de propriété à SOLIDERE, en échange d'actions dans la compagnie. La valeur des terrains est estimée par cette même compagnie, sans possibilité de recours ou d'arbitrage par une tierce partie indépendante.
Car l'option retenue dès le départ est de faire tabula rasa du cadre ancien et de construire une ville nouvelle en fonction des besoins des investisseurs. Par là, le Centre-Ville ne peut être une réplique de la Beyrouth de l'avant-guerre et ne peut offrir les même fonctions. Pour cela il faut que SOLIDERE contrôle également toute la conception du plan d'urbanisme du Centre-Ville. Cela aussi est acquis grâce à la récupération des services de la Municipalité et de la Direction Générale de l'Urbanisme. La société est ainsi en mesure d'imposer un projet à la ville et faire assumer à la Municipalité les coûts des nouvelles infrastructures et d'entretien, en s'exemptant pour une longue durée des impôts et des charges, tout en se réservant les parcelles les plus intéressantes, notamment celles du front de mer et du remblai (40 ha), pour des projets propres.
Le contrôle du centre-ville est total, par les aspects politique, foncier, urbanistique et économique. Sa finalité est complexe, celle d'en faire un espace "moderne", duquel toute trace de la ville antérieure, jugée archaïque, sale et encombrée, est éliminée en faveur d'une ville nouvelle, rationnelle, aérée et à l'image des grandes capitales occidentales. Les modèles d'inspiration sont à la fois New-York, le quartier de la Défense à Paris et les villes de la péninsule arabique. Elle ne peut être qu'architecturalement et urbanistiquement originale par rapport à l'ancienne ville, avec des buildings étincelants animés d'hommes d'affaires pressés, de larges avenues plantées d'arbres et parcourues de flots de voitures individuelles, des magasins de luxe fréquentés par une population aisée résidant dans les nouveaux immeubles du front de mer. Des tours, dont un World Trade Centre dominent ce centre; une vaste marina et même un jardin public -- une innovation à Beyrouth depuis le départ des Ottomans -- sont prévus.
Les discontinuités imposées
Ce Centre-Ville en projet (car rien n'a encore été construit) impose une série de discontinuités que la ville d'avant-guerre ignorait. Avant tout, le plan impose un espace totalement nouveau: puisque l'essentiel de la "vieille ville" a été rasé entre 1983 et 1994. Sur un immense terrain d'une superficie d'environ 250 ha et desquels il ne survivent que les lieux de culte (églises, mazars et mosquées), des bâtiments officiels, dont la Municipalité et le Parlement, ou d'autres, plus ou moins intacts. Le projet prend pour ainsi dire le Centre-Ville à zéro et le refonde dans une période étalée sur 25 ans.
Discontinuité morphologique
Par là, le Centre-Ville est d'abord en discontinuité morphologique par rapport au reste de la ville, et notamment l'espace péri-central. Dans le futur, il sera l'espace vertical, celui des tours modernes en acier, marbre et verre, tandis que la ville qui l'entoure, pour laquelle aucune réhabilitation n'est prévue, est plus basse et horizontale, expression des périodes architecturales qui s'y sont manifestées entre 1870 et 1974. De nouveaux gabarits et coefficients d'occupation des sols sont introduits; la recherche de la rentabilité impose des remembrements plus grands, des reculs plus importants. Le Centre-Ville sera ainsi homogène, tant par l'empreinte des bâtiments que par par les matériaux utilisés ou les formes et les couleurs imposées. Malgré les quelques pastiches destinés à "préserver l'atmosphère et la couleur locales" que l'on introduira par le biais des souks reconstruits (mais selon un plan d'ensemble qui hérite très peu des anciens souks rasés en 1993), le Centre-Ville aura une physionomie totalement nouvelle.
Quant aux symboles urbains présents dans la ville de l'avant-guerre, ils disparaissent aussi. La célèbre statue des Martyrs, précédemment érigée au centre de la Place des Canons, est maintenant placée entre deux avenues à circulation rapide; elle perd ainsi totalement sa fonction symbolique, celle de signaler un point fort de la cité dans une ville déjà pauvre en repères urbains. Même les lieux de culte, ces manifestations extérieures de l'identité communautaire, sont perdus dans une trame urbaine aux fonctions étrangères à celles qui avaient légimé leur présence, écrasés par la monumentalité des nouveaux bâtiments qui les dominent de toutes parts.
Discontinuité fonctionnelle
Le Centre-Ville est reconstruit pour répondre à trois fonctions nouvelles, celles de la finance internationale, du commerce local et de la résidence de luxe. De cet espace sont exclues les activités manuelles, le petit commerce, la résidence pour classes moyennes et inférieures, les activités ludiques, la restauration, et la prostitution, toutes les fonctions qui ont caractérisé le centre d'avant-guerre et qui perdurent dans l'auréole péri-central. Les promoteurs ont ainsi prédéfini les activités du Centre-Ville reconstruit, ne laissant rien aux évolutions spontanées, ni aux recompositions en fonction des conjonctures. Du Centre-Ville reconstruit aux secteurs péri-centraux, on passera d'une City animée aux heures de bureau et morte dès le coucher du soleil, à une ville qui ne dort jamais; d'une ville technocratique et réglementée à une ville sans ordre; d'un espace pour des classes sociales sélectionnées à la Ville "vraie", lieu privilégié des rencontres et des brassages; d'un monde organisé à celui où tout est possible, y compris rêver. Un ghetto dans une ville.
Discontinuité de desserte et d'accessibilité
L'espace central sera desservi par des avenues et des rues plus larges que les anciennes, certaines mêmes crées ex nihilo, qui se raccorderont tant bien que mal avec l'infrastructure existante, du reste de la ville, non réhabilitée et déclassée depuis les années 1970. La voiture individuelle sera d'ailleurs privilégiée par rapport aux transports collectifs, car c'est le moyen de déplacement des cadres supérieurs et des classes aisées, éléments centraux des nouvelles fonctionnalités de cet espace. L'infrastructure routière ainsi conçu repose sur la mobilité de travail depuis les périphéries résidentielles éloignées de la ville vers la nouvelle "City"; il n'y aura que peu d'employés venant de la ville elle-même, sinon ceux résidant dans les nouveaux front de mer luxueux. Les transports collectifs n'ont alors plus aucune raison d'être, et il est alors possible de remodeler ce centre en un espace de mouvement linéaire le long d'avenues centrales surdimensionnées qui remplaceront la fonction antérieure de gare routière de la ville. Alors que le projet du métro fait l'objet de discussions sans fin, des parkings immenses sont déjà prévus pour absorber 30 à 40.000 voitures inutilisées durant la journée; même les souks reconstruits reposent sur un dédale de parkings souterrains.
Discontinuités sociales
Nous avons vu que le centre-ville sera le lieu des classes aisées; celui de l'auréole contigue sera celui des classes très modestes, voire pauvres. Cet espace péri-central a été, durant la décennie d'avant-guerre, l'espace en voie de paupérisation et de déstructuration. C'était l'espace-refuge des populations issues de l'exode rural des périphéries nationales déshéritées (le Sud, la Béqaa) ou des espaces en crise du Moyen-Orient (le Kurdistan, la Syrie rurale, la Palestine). Avec la guerre, elles sont ensuite devenues des espaces-refuge pour les déplacés : Chi`ites du Sud-Liban et Maronites du Mont-Liban, pour l'essentiel des squatteurs plus ou moins protégés qui avaient délogé les populations précédentes. Ils survivent dans un cadre dégradé. Autour du Centre-Ville, donc, une auréole compacte en crise qui passe sans transition aucune vers l'espace équipé et prospère du centre l'espace où les services publics de base (eau, électricité, télécommunications, voirie...) seront assurés, contrairement au reste de la ville, sous-équipée, et laissée à elle-même. Au-delà de cette auréole péri-centrale, c'est l'espace des classes moyennes fragilisées par la guerre et la crise économique.
Mais le contraste entre le centre et le reste de la ville sera flagrant par le tri social opéré par les nouvelles fonctions. Les classes moyennes qui convergeaient sur le centre-ville de l'avant-guerre pour travailler seront naturellement exclues de ce centre d'affaires. D'ailleurs il ne reste plus rien qu'ils puissent s'approprier ou revendiquer: ni les commerces, ni le foncier, ni l'histoire, ni "l'âme" de la ville. L'exclusion s'appliquera aussi aux populations réfugiées du péri-centre qui ont recomposé des territoires en fonction de leurs propres réseaux.
Discontinuités politiques
Au plan politique, ce Centre-Ville sera l'expression spatiale des intérêts d'un groupe au pouvoir. Non élu, il ne se considère soumis à aucun contrôle populaire, car la représentation même de la population de Beyrouth pose problème. En effet, bloqués par l'archaïsme des lois électorales, les résidents, anciens Beyrouthins comme les nouveaux-venus, ne sont pas peuvent exprimer leurs revendications et n'ont aucune prise sur le déroulement de la reconstruction. Quant au pouvoir municipal, non représentatif d'une part et piégé par le le pouvoir en place, d'autre part, il n'a aucune autorité.
Enfin, le Centre-Ville sera l'espace-symbole du pouvoir de l'après-guerre: un espace privatisé, aménagé par les intérêts d'un très petit groupe d'entrepreneurs stratégiquement placé au coeur de l'appareil de l'État, lui-même au service de ce groupe. Ce pouvoir s'exprime sur un espace bien délimité. Il l'utilise pour la spéculation et la haute finance écartant les groupes politiques ou confessionnels qui continuent à fonctionner "à l'ancienne" grâce à la bureaucratie. Situé dans cet espace remodelé, le Parlement a été paradoxalement marginalisé; deux logiques de pouvoir cohabitent dans une même ville, toutes deux autonomes par rapport à la population.
Discontinuité historique
Enfin, le centre-ville reconstruit est en rupture totale avec le passé. S'il est vrai qu'aucune ville n'est un continuum espace-temps parfait, le cas de Beyrouth, lui, nie tout lien spatial avec l'histoire. Espace construit par les citadins, il était l'expression de jeux subtils de composition et de redéloiement d'espaces et de territoires depuis 150 ans, selon des rapports de force entre l'ensemble du corps social et entre des intérêts qui se conjugaient ou s'annulaient. Le Centre-Ville reconstruit ignore aujourd'hui cette riche sédimentation et impose un espace fondamentalement différent, l'oeuvre d'une oligarchie au pouvoir qui planifie des scénarii diffeerents pour les temps à venir. De ce point de vue, la reconstruction du centre signale la fin de l'histoire de Beyrouth, qui continue pourtant ailleurs sur ses autres territoires.
La crise annoncée
Il apparaît alors que le Centre-Ville reconstruit va s'imposer, comme une île, un ghetto, dans une ville traversée par d'autres temporalités. Aucune passerelle, fonctionnelle, sociale, architecturale ou autre, n'est prévue afin de connecter ce Centre au reste de la ville, jusque là occulté par le promoteurs.
Le plan de reconstruction repose sur l'affirmation péremptoire de sa propre centralité "toute naturelle", et qu'il convient de consolider avec les fonctions nouvelles afin que les centres périphériques, nés de la guerre, et à ce titre aberrants, s'éteignent rapidement. Même si les promoteurs nient que les périphéries de la ville ont pu parfaitement remplacer le Centre-Ville détruit durant les 15 ans de guerre, et qu'ils peuvent perdurer dans le futur de par leur caractère versatiles, il est un fait que ces nouvelles centralités, économiques et politiques, peuvent être de redoutables concurrents. En quelque sorte le conflit sera entre les périphéries constituées par l'action des milices étayée par le petit commerce et le centre, constitué par le groupe bureaucratique et financier au pouvoir. Le conflit opposera la logique des territoires confessionnels péricentraux et périurbains à une logique de Centre-Ville, elle-même non articulée d'ailleurs au territoire national et à ses modes de fonctionnement régionaux.
A un autre niveau se posera le rôle de ce Centre-Ville dans la constitution ou la consolidation de la citadinité des Beyrouthins, car le Centre-Ville tel qu'il est planifié a tout d'un espace d'exclusion. Les modèles classiques de la ville affirment que les centres sont les lieux de l'émergence de citadinités, par le jeu subtil des brassages, d'influences, d'opportunités et d'intégrations. Beyrouth, du moins son centre, offre un cadre contraire, l'offre d'un seul modèle culturel et politique, d'une seule intégration, celle qui précisément n'a pas de territorialité car branchée sur le monde international et immatériel des finances. Le Centre-Ville se présente alors comme un lieu en porte-à-faux par rapport au reste de la ville, qui continue à intégrer des populations venus d'horizons divers avec des spécificités de quartier, certes, mais dans un moule "beyrouthin". Le lieu de la citadinisation, et par là celui de la démocratie, ne serait ni l'espace reconstruit, ni le péri-urbain déstructuré, mais ailleurs, là où les classes moyennes ont survécu, là où les noyaux de citadinité subsistent encore, là où le qualificatif "beyrouthin" a encore un sens.
Conclusion
La reconstruction du Centre-Ville de Beyrouth, avant même son démarrage physique, fascine par l'ampleur de la crise et des violences annoncées. Ce sera inéluctablement un espace d'envies et de jalousies, car il ne répondra qu'aux intérêts immédiats d'une classe sociale très limitée stratégiquement positionnée dans une conjoncture historique particulière. Espace moderne, certes, mais plaqué au coeur d'une ville laissée à elle-même, qui se recomposera au gré des initiatives privées limitées. Le reste de la ville n'est pas compris comme le prolongement naturel du centre, qui vit de ce centre et qui le fait vivre, (qui fournit la force de travail et qui en retour garantit la paix sociale), mais un espace étranger, économiquement inintéressant, socialement en rupture, politiquement en marge de la cité.
Il repose également sur le déni de l'importance des centres de rechange nés durant la guerre, de leur dynamisme certain et de leur rôle structurant pour les populations nouvellement installées et les espaces périphériques. Il nie également que l'espace libanais est fortement territorialisé, formé de sous-ensembles hérités des clivages confessionnels de la guerre.
Le Centre-Ville reconstruit, lieu en creux de toutes les contradictions de la ville et du pays, sera sans doute celui des confrontations futures. Il nous semble alors que la reconstruction pose paradoxalement les fondations de prochaines violences urbaines.
Michael F. DAVIE 1er mars 1995
|
 al@mashriq 960602/960614 |