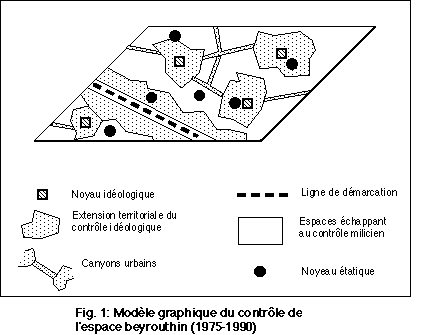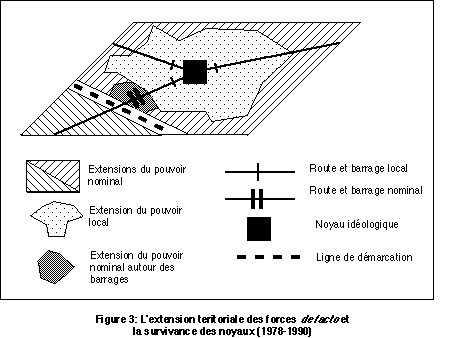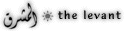
|
|
Texte proposé à L'Affiche Urbaine, Ndeg. 2, 1992 (Groupe EIDOS et Maison des Sciences de la Ville, Tours)
LES MARQUEURS DE TERRITOIRES IDEOLOGIQUES à BEYROUTH (1975-1990)
Michael F. DAVIE[*]
Résumé:
Les différents messages visuels (affiches, panneaux, graffiti, drapeaux, calicots, statues) visibles à Beyrouth entre 1975 et 1990 délimitataient des territoires idéologiques. La combinatoire, les lieux d'affichage privilégiés et la densité permettent de saisir la stratégie du quadrillage du territoire civil et son évolution dans le temps.
Mots-Clés: Beyrouth (Liban); Guerre urbaine (1975-90); Messages visuels; Idéologie; Territoires ; Centre-Périphérie.
Abstract:
The Markers of Ideological Territories in Beirut (1975-1990)
The different visual messages seen in Beirut between 1975 and 1990 (bill-boards, posters, graffiti, flags, statues, streamers) were used to mark the boundaries of ideological territories. The way they were combined with other messages, their number, the choice of the places they were exposed all lead to a comprehension of the intensity of the control of civilian territory and its evolution through time.
Key-Words: Beirut (Lebanon); Urban Warfare (1975-90); Visual messages; Ideology; Territories; Centre-Periphery.
Entre 1975 et 1990, durant toute la période de la guerre civile, la ville de Beyrouth a assisté à une prolifération de graffiti et d'affiches de toutes dimensions, couvrant murs, portes, balcons, piliers de soutènement, poteaux téléphoniques, devantures de magasins, recouvrant même des carcasses de voitures abandonnées et rivalisant avec les calicots et les portraits géants de chefs de milices et de personnalités politiques, militaires ou religieuses.
L'oeil exercé, celui du Beyrouthin, était sensible à toutes les subtilités de ce placardage iconographique qui, au-delà du message politique, définissait un espace idéologique particulier. Il lui était possible d'identifier, grâce aux signes extérieurs exhibés, les territoires contrôlés par chaque groupe politique et suivre dans le temps l'évolution de leurs contours. Toute modification du contenu iconographique, tout changement dans la combinatoire figurative d'éléments particuliers, tout déplacement des lieux de placardage, lui ont reflété les évolutions internes des émetteurs et la qualité de leur quadrillage du territoire, espace perpétuellement contesté par les forces en présence.
Cet article se propose de présenter la riche gamme de l'affichage qui était visible dans la Beyrouth en guerre et de décoder une partie de son rôle en tant que marqueur de territoire politique. Tous les moyens visuels furent mis en oeuvre par les nombreux acteurs de la guerre urbaine pour exprimer sentiments et points de vue. Le plus usité fut sans doute la bombe à peinture servant à peindre des graffiti; bon marché, légère et donc aisément transportable par le milicien en armes, elle fut l'outil le plus communément utilisé. Les affiches et affichettes étaient massivement présentes; imprimés ou photocopiés, en monochromie ou en couleurs, leurs dimensions étaient variables, depuis le classique A4 au panneau de plusieurs mètres carrés. Véritables produits d'une industrie des arts graphiques, leur coût et leur affichage ont posé des problèmes de logistique qui ont échappé au créateur, individuel, des graffiti. Toutes les milices, les partis politiques et les armées étrangères présents à Beyrouth, de même que l'État, eurent une préférence pour ce vecteur. Plus rares, par contre, furent les panneaux peints géants (jusqu'à 4 x10m) qui avaient été érigés à des points particulièrement passants: grands carrefours, points de passage d'un secteur à un autre de la capitale, façades d'immeubles bien visibles. Plus original était le recours à des silhouettes géantes de chefs de milices: de 3 à 6 m de haut, découpées dans des plaques de plastique blanc semi-translucide, ils étaient souvent éclairées de nuit. A cet inventaire il faut ajouter les calicots, moins fréquents néanmoins que les autres vecteurs car plus fragiles, les bourrasques étant imprévisibles dans cette région de la Méditerranée; ils rythmaient l'espace aérien dans les canyons urbains de la ville, suspendus d'un côté à l'autre des nombreuses rues passantes, accrochés entre des poteaux électriques et des lampions, ou des balcons en vis-à vis. Des faire-parts de décès[1] ou des annonces de requiems occupaient de surcroît le peu de place encore disponible ou s'y superposaient. Enfin, les drapeaux, moins nombreux que les affiches, décoraient eux aussi la ville: en toile ou en papier, flottant au-dessus de positions militaires et de barrages de contrôle, ils signalaient efficacement l'identité de ceux-ci. Quant aux monuments, très rares, ils étaient le plus souvent des hauts-reliefs à l'effigie d'un chef, et occupaient tout un pan de mur à des carrefours incontournables. A cette diversité, s'ajoutaient les plaques publicitaires qui encombraient elles aussi l'espace de la ville et exagéraient l'apparence désordonnée et anarchique de l'ensemble.
Une observation pertinente de ce matériel, de son importance qualitative et quantitative, sa présence dans des lieux préférentiels dévoile une logique particulière de contrôle, issue non seulement de contraintes géographiques mais aussi de la superposition des nombreuses forces idéologiques.
Le message idéologique le plus courant fut le graffiti: il avait l'avantage précieux d'être immédiatement visible, et donc libre des aléas d'une chaîne de production de l'imprimé. Indélébile, il a été apposé partout, à tous les moments de la guerre, acquérant une fonction identitaire, confirmant l'existence d'un acteur précis dans l'anonymat des combats. Une classification des graffiti de la guerre a été tentée par CHAKHTOURA (1978) et HABIB (1986). Les plus visibles par le public étaient ceux peints sur les murs extérieurs, les entrées des immeubles, les rideaux des magasins, voire sur les panneaux de signalisation routière, ou les séparations des voies d'autoroute. Les camions militaires, l'intérieur des tunnels routiers et des abris de fortune n'échappaient pas à la bombe à peinture; même les salles de classes et les cours de récréation d'écoles, les enceintes des églises et cimetières se recouvraient inexorablement de slogans et de sigles, dont certains peints au pochoir. Les graffiti, spontanés, n'étaient souvent que des signatures, des "tags" qui avaient l'unique fonction de marquer le passage sur un lieu précis d'un combattant isolé; ils étaient des variantes de "Abou-`Ali est passé par là" ou de "Zouzou est passé par là". D'autres, dont l'inventaire pour la période 1975-1983 a été présenté par HABIB (1986), ont exprimé une position politique ("Avec les Kataëb jusqu'à la mort", "Mort aux Kataëb"), glorifié ou insulté un chef ("Aoun" [sous-entendant Vive le Général Aoun], " Assad [=Lion] au Liban, lapin au Joulân"). D'autres n'étaient que des insultes les plus obscènes adressés aux chefs de l'autre bord, ou aux ennemis réels ou imaginaires. Par souci d'efficacité, de rapidité d'exécution et de couverture territoriale, certains messages étaient peints au pochoir. Enfin, certains graffiti n'étaient que le sigle du parti: croix biseautée de Forces Libanaises, Cèdre stylisé des Kataëb, "Allah" pour le Hizb Allah, etc, ou les initiales de ceux-ci: FPDLP (Front Populaire et Démocratique pour la Libération de la Palestine), HHA (Hizb Harrâs al-Arz), etc.
L'affiche, par contre, était toujours plus soignée, plus réfléchie, car émanation d'une institution organisée, à objectifs définis. Véritables productions d'ateliers d'arts graphiques, soigneusement imprimées sur papier de fort grammage, les affiches devaient projeter une image positive des émetteurs au plus grand nombre de récepteurs. Contrairement aux graffiti, elles ne pouvaient être l'oeuvre d'un individu; ils disparaissaient là où la spontanéité du geste peint perdait son sens.
L'affiche omniprésente à Beyrouth, dans les deux secteurs de la ville, l'occidentale ou l'orientale[2], était incontestablement celle des chefs de milice. Héros du moment, ceux-ci étaient représentés sous tous les angles: debout, ils avaient souvent le drapeau national ou milicien derrière eux (Bachîr Gémayyel, Samir Geagea); assis, ils tiennent un livre ouvert ou sont représentés perdus dans leurs réflexions (Ibrahim Qolaylât). Ils sont habillés en civil (costume-cravate pour les plus âgés, comme Camille Chamoun), tenue décontractée pour les plus jeunes: son fils Dany Chamoun, Samir Geagea, Nabih Berri, Elie Hobeiqa, Daoud Daoud. Ils ont été représentés en tenue de combat, l'arme à la main (Bachîr Gémayyel); lorsqu'il s'agit d'un officier supérieur (Général Aoun, Général Lahoud), il sera il sera photographié en treillis camouflé ou en grande tenue d'apparat, galons bien en vue, toujours devant le drapeau national.
La personne n'était pas toujours seule. Elle partageait souvent l'affiche avec d'autres personnages: le père (souvent le membre fondateur d'un parti politique: Pierre Gémayyel avec son fils Bachîr ou Amîne), une trinité familiale (le père et les deux fils: la famille Gémayyel; Frangiyyé et ses fils), ou encore avec un homme prestigieux, de stature nationale ou internationale (Ibrahim Qolaylât et Gamal `Abd al-Nasser, par exemple), ou, du moins implicitement, avec Dieu (affiche du quarantième du décès de Bachîr Gémayyel).
Les ministres, les députés, les za`im-s[3] qui ont eu ou qui ont encore un poids dans la vie politique du pays par suite de leur appartenance à une milice, ont eu leurs portraits présents aux lieux stratégiques de leur circonscription, "leur" quartier ou village d'origine -- le député ou le ministre sans étiquette politique n'a jamais eu droit à ce privilège. Même le Président de la République sera virtuellement absent des murs de la ville, sauf s'il a appartenu à un parti politique ou à une milice (Bachîr Gémayyel, Amîne Gémayyel). Il sera alors représenté debout, le torse barré de l'Ordre du Mérite Libanais, le drapeau national en deuxième plan.
Par ordre décroissant de fréquence d'apparition, suivent les affiches commémorant le décès de "martyrs" morts pour "la patrie", pour "la liberté", pour "l'honneur", pour "le Liban". Souvent rien que des agrandissements de photographies d'identité agrémentés du sigle du parti, ces affiches imprimées à la hâte, fleurissent sur les murs aux lendemains de batailles importantes gagnées par les amis des défunts[4]; l'appartenance politique des "martyrs" est toujours bien signalée, avec emblème, logo en évidence à côté du nom et du grade du défunt. D'autres affiches ont couvert les murs durant les batailles décisives telles la bataille de Zahlé en 1981, la débâcle du Chouf en 1983, ou le conflit entre les Forces Libanaises et le Général Aoun en 1989-90: les motifs préférés ont été le fusil, le combattant fixant l'horizon, le canon d'artillerie en action, des images de massacres. Pour des anniversaires de batailles, de mort d'une personnalité politique, des affiches idoines ont fait leur apparition: anniversaire de la mort de Bachîr Gémayyel, de Moussa as-Sadr, du Mufti Khaled; à l'occasion d'une victoire ou d'une défaite, colombes de la paix; lors de campagnes contre la drogue, des affiches montrant des têtes de mort, des seringues etc. seront placardés en ville; lors de campagnes de propreté on a utilisé des personnages tirées des bandes dessinées françaises tels que Gaston Lagaffe.
Plus rares ont été les affiches de membres de la hiérarchie religieuse: le Patriarche maronite, à l'occasion de son intronisation ou d'une prise de position politique; le Mufti de la République, lors d'une prise de position ou le lendemain de son assassinat, comme ce fut le cas du Mufti Khaled; le Pape (lors de cérémonies religieuses importantes: on affichera ses portraits autour des églises); l'Imam chi`ite Moussa al-Sadr ou ses successeurs; l'imam Obeid, enlevé par les Israéliens en 1990; les Imams iraniens Khomeyni, Khaméne'i, dans certains secteurs de la banlieue chi`ite de Beyrouth.
A ce groupe il faut ajouter les images religieuses, mais qui ne seront jamais exposées sur les murs: plus intimes, elles occuperont l'espace privé de la ville, l'intérieur des maisons, des entrées d'immeubles, l'espace et des objets personnels et non pas l'espace public. Des images de la Vierge Marie (présentes sur les crosses des fusils, sur le tableau de bord de véhicules militaires, sur les affûts des canons), de Saint Elie, réputé pour sa protection dans des situations dramatiques, Saint Christophe, Sainte Rita (la sainte patronne des cas désespérés), Sainte Thérèse, ou, pour les Musulmans, des versets du Koran et, plus rarement, des images des lieux saints musulmans tels que la Ka`aba, ou du Harâm ash-Sharîf -- la Mosquée du Dôme à Jérusalem -- ou de l'ascension de Muhammad.
Mais les affiches ne représentent pas toujours que des portraits: le sigle du parti peut suffire, ou être remplacé par un message écrit, des initiales, un mot ("Oui", "Non"), des chiffres ("10.452 km[2]"[ 5]) ou des dates ("24 avril" [6]), un slogan court ("Non au confessionnalisme. Oui à la laïcité") ou long, sous la forme de vers patriotiques. D'autres ont montré une carte du Liban, pays déchiré et ensanglanté ou en forme de puzzle défait; ailleurs, une carte d'Israël symbolisé par un poignard planté au coeur du monde arabe, ou un poing ou une arme détruisant Israël, identifié par une carte de la Palestine portant l'Étoile de David.
Quant aux panneaux géants, leur contenu était tout aussi varié: silhouettes ou portraits en pied construits d'assemblages de plaques peintes ou simplement des silhouettes de visages, souvent entourées d'ampoules électriques: ce sont des portraits de chef de milice (Bachîr Gémayyel sur le Boulevard du Nahr), de chef religieux (Khomeyni sur le Boulevard de l'Aéroport), de chef politique (Pierre Gémayyel à la Place Sassine d'Achrafiyyé). Ce sont des portraits sur contreplaqué, conçus selon les affiches géantes pour films à succès. A ce groupe se rattachent les silhouettes en plastique blanc en pied de Bachîr Gémayyel placés à des points bien visibles. A Beyrouth-Ouest, en plus de ces portraits classiques de chefs de milices (Nabih Berri, Fadlallah Fadlallah, Moussa al-Sadr), des reproductions de lieux saints: la Ka`aba de la Mecque, la mosquée du Haram al-Sharif (Dôme du Rocher) à Jérusalem, des mosquées iraniennes. Aux portraits et lieux saints se sont ajoutés des symboles ou logos géants des partis politiques: la croix biseautée des Forces Libanaises, le cèdre stylisé des Kataëb, le logo de 'Amal[7]; pour le Hizb Allah, le mot "Allah" en lettres soulignées par un éclairage au néon.
Les drapeaux étaient aussi variés que la multitude des forces qui s'étaient succédées sur le terrain: les partis politiques, les milices, l'armée nationale et aussi la Syrie, Israël ou les membres de Forces Multinationales ou de Dissuasion: Etats-Unis d'Amérique, France, Iran, Italie, Grande-Bretagne, Libye, Arabie Saoudite, etc... Ces armées régulières étrangères ont utilisé aussi l'affiche ou les graffiti comme support de leur message idéologique ou militaire, phénomène particulièrement visible entre 1982 et 1984, lors de la présence de la Force Multinationale dans la ville, mais aussi durant la période précédente (1976-1979) avec la Force de Dissuasion Arabe, ou la suivante, avec le retour de militaires syriens à Beyrouth en 1986. Ces derniers ont exhibé des affiches de Hafez al-Assad, des slogans du parti Ba`ath, des drapeaux syriens et palestiniens; l'armée israélienne avait eu une préférence pour les drapeaux, et une prédilection pour la couleur bleue et blanche; accessoirement, car leur présence était géographiquement très limitée, des graffiti et affiches ont également été utilisés par les armées U.S.: portraits de Ronald Reagan, drapeaux, emblèmes divers des Marines à proximité des cantonnements, messages en langue anglaise; les régiments français (signes des régiments, drapeaux) ou italiens (drapeaux, Lion de Saint-Marc); la Force de Dissuasion Arabe avec les divers contingents a également fourni un lot important d'affiches et de graffiti, toutes avec une symbolique propre ...
Par ailleurs, la ville fut aussi couverte de faire-parts de décès ou d'annonces de requiems. Certes, on réservait une place de choix à des faire-parts, trouvant un espace moins encombré tout en étant parfaitement visible. Même ces messages étaient divers: chaque communauté religieuse a des subtilités de présentation, selon la forme et disposition de la croix ou des formules appropriées encadrées de noir pour les Chrétiens; les Musulmans des sourates du Koran sur un fond parfaitement blanc. Le portrait du défunt "martyr" pouvait figurer en couleurs s'il s'agissait d'un élément important de la milice. La photo des jeunes célibataires y figurait souvent, mais presque jamais celle d'une personne d'âge mûr. Selon le niveau social de la famille (patricienne, notable de quartier ou de village, etc...), les faire-parts étaient nombreux et bien en vue, tant dans le quartier du défunt que dans la ville, où ils ne figuraient que dans le quartier ou à l'entrée des habitations de la famille étendue.
Enfin, quelques rares monuments meublaient des espaces publics de la ville. Il étaient érigés par des milices, entre 1975 et 1990[8], en souvenir de leur fondateur ou de leur maître à penser. Ainsi, une statue de Gamal `Abd al-Nasser fut érigée à `Ain Mrayssé par le Parti des Nassériens Indépendants; un monument aux Kataëb fut construit à Rmailé; un cas unique à la ville est un monument au style moderniste figurant une silhouette schématisée de Bachîr Gémayyel, à la place Sassine.
L'ensemble des messages émis était très souvent explicite: un texte[9] en prose ou en vers, sinon une image comme des photos de massacres, de bombardements de la ville, du désespoir d'une mère. Le texte prit aussi plusieurs formes stylistiques: la prose et le style télégraphique facilement mémorisables ont eu un impact certain. Conçus par les professionnels des médias, ces slogans courts sont apparus à des moments forts de la vie militaire ou politique. Les vers, souvent panégyriques, appuyaient les actions notables d'une personne, ou exprimaient la tristesse lors d'un deuil.
A l'inverse, les messages implicites étaient tout aussi nombreux. Leur compréhension nécessitait une connaissance du terrain et de la conjoncture. Un mot ("Oui", "Non") ou un sigle (l'Étoile de David, le cèdre des Kataëb, le marteau et la faucille ...) ont suffi. Une affiche ou un graffito ne portant que le sigle d''Amal indiquait bien que l'espace était sous le contrôle de ce parti; un cèdre stylisé géant, posé sur la terrasse d'un immeuble dominant la ligne de démarcation, signifiait l'appartenance du secteur aux Kataëb; le sigle des Forces Libanaises, apposé sur les panneaux de signalisation routière, a signalé que ce territoire était "libéré"; le mot "Allah" poché sur les poteaux électriques, sur les murs et les tranchées des routes signifiait que le territoire était aux mains du Hizb Allah. On a même vu des cartes plus ou moins schématisées du Liban, formées par la multiplication de logos d'un parti politique, qui ont occupé des pans entiers de murs; ailleurs, un assemblage d'affichettes du drapeau national a donné un cèdre géant ... Le sigle, par sa puissance d'évocation, était utilisé intensivement: chaque parti affirmant par là sa présence et délimitant, par ce marquage, un espace vital.
Des combinaisons de texte, sigle et image, ont évidemment existé: un sigle et un slogan ou mot d'ordre identifiaient parfaitement l'émetteur; une image et un sigle aussi, mais l'impact se diluait alors, deux messages se concurrençant pour occuper l'espace du support, donnant un message confus, hermétique aux non-initiés. Ainsi, une image pieuse montrant Saint Georges terrassant le dragon a été modifiée, la figure du Saint remplacée par celle du Général Aoun, celui du dragon par le visage du Président syrien Hafez al-Assad, le bouclier du chevalier par l'écusson de l'Armée Libanaise, le tout complété par un slogan; l'ensemble a été photocopié artisanalement et, de machine en machine, l'affichette a perdu de sa clarté idéologique et de son intensité.
La langue la plus utilisée était évidemment l'arabe: cependant, des affiches et graffiti en français ou en anglais étaient présents, destinés aux journalistes et à la communauté étrangère certes, mais aussi aux nombreux Libanais francophones ou anglophones. Dans des quartiers arméniens ou kurdes, des graffiti dans ces langues primèrent sur l'arabe; quelques graffiti en hébreu ont apparu dans le secteur oriental de la ville, preuve de la présence d'Israéliens ou héritage d'un stage d'entraînement de miliciens des Forces Libanaises en Israël.
En sus de l'outil scriptural, la couleur fut aussi un moyen de propagande. Les Forces Libanaises ont privilégié les affiches en rouge et vert, sur fond blanc éclatant, les couleurs de leur drapeau; 'Amal a privilégié le vert, une des composantes du drapeau national, et surtout couleur de l'Islam, puis le rouge et le blanc; les Kataëb ont utilisé le vert sur fond blanc, les couleurs de leur drapeau, tandis que les Palestiniens ont privilégié le rouge, le vert, le noir et le blanc, couleurs reprises par les partis pan-arabes (les différentes tendances du Ba`ath, les organisations palestiniennes, etc.) car étant celles du drapeau de la Révolte Arabe (1915-1918) et celles des drapeaux de la plupart des pays de la région.
Nous avons vu qu'aucun support ne fut oublié pour afficher; de même, tous les sites qui avaient une position stratégique étaient envahis systématiquement par le placardage; les espaces privés n'échappaient pas à cette règle. Le Beyrouthin discernait néanmoins un certain ordre à travers cette masse, celle de la géographie des forces idéologiques présentes sur le terrain.
C'est sans doute à proximité des permanences et des positions militaires que la symbolique des affiches idéologiques a pris toute sa richesse. En effet, la position militaire était par définition l'expression d'une volonté de contrôle d'un espace géographique. Les positions militaires qui se sont fait face, de part et d'autre de la ligne de démarcation, ont été ornées de sigles et d'affiches clairement visibles par l'ennemi. Côté "ami", ces positions étaient encore plus riches en symboles: les miliciens, durant les périodes creuses de la guerre ont eu tout le temps de les orner. Les positions ont montré parfois une symbiose entre le politique et le religieux, statues et images pieuses s'entremêlant avec des photos de chefs de milices et de "martyrs".
Les barrages de contrôle d'identité étaient marqués de la même manière: drapeaux, affiches des chefs de milice, slogans et mots d'ordre, le tout collé sur les sacs de sable ou sur les fûts métalliques qui servaient de chicanes à la circulation. Il en est découlé une géographie mentale pour le civil, qui a pu ou dû planifier son trajet dans la ville en fonction de l'appartenance des barrages, évitant certains, se pliant à la volonté des autres, en fonction de ses opinions politiques ou de sa confession.
Les permanences répondaient au même souci d'identification: elles se démarcaient visuellement de l'environnement urbain par le jeu des couleurs de leurs façades, par la taille des sigles et symboles utilisés et par le nombre de drapeaux. Les casernes des Forces Libanaises étaient peintes en blanc, et se détachaient de l'environnement urbain, délabré, sale, traumatisé par les effets de la guerre[10]. Ces permanences, souvent des postes de contrôle ou des dépôts d'armes en arrière du front, étaient disséminées dans la trame urbaine de la ville, occupant des premiers étages d'immeubles à proximité des grands carrefours, les ponts ou les autres points stratégiques de la ville. Certaines permanences étaient situées à côté de grands terrains vagues propices à l'installation de pièces d'artillerie ou à proximité des immeubles les plus élevés[11] de Beyrouth.
Des oratoires[12] étaient relativement abondants à proximité de ces positions, du moins dans la partie orientale de la ville: des statuettes de la Vierge, de Saint Élie, du Sacré-Coeur protégeaient des effigies de chefs politiques, le tout dans des enceintes à formes surprenantes: cèdre, grotte, pyramide ...
Parallèlement à la trame urbaine, l'espace qu'il a fallu marquer en priorité a été la ligne de démarcation entre les deux secteurs principaux de Beyrouth: c'était l'interface avec l'ennemi. C'était le domaine privilégié des portraits géants et des drapeaux, supports visibles de loin. Les drapeaux occupaient les terrasses des immeubles dominant la ligne ainsi que tous les autres points élevés supposés bien visibles depuis l'autre secteur. Les panneaux et portraits géants veillaient pas loin du premier barrage de contrôle, véritable porte dégagée entre les positions militaires et champs de mines. Ces panneaux géants des chefs indiquaient sans équivoque l'allégeance de l'espace, appartenance soutenue par des affiches plus petites et des graffiti, mais dont l'impact visuel était moindre. Afin d'éviter qu'un franc-tireur ou qu'une rafale ennemie gâche le portrait, objet coûteux, il a toujours été placé à l'abri d'un obstacle ou d'un immeuble, tout en étant parfaitement visible pour celui qui a effectivement traversé. L'ensemble était éclairé a giorno, fait surprenant dans une ville privée d'électricité et d'éclairage public: même de nuit, on ne pouvait éviter de les regarder avec une certaine fascination.
Ces portraits en pied de chefs de milices ou d'officiers, ces silhouettes et ces sigles ont été remplacés, mais très exceptionellement (été 1990), par des portraits géants du Christ proclamant: "Ne craignez rien, Je suis avec vous". Ce portrait était placé face aux personnes qui sortaient du territoire contrôlé par les Forces Libanaises; conçu pour encourager les combattants, il signalait aussi que le Christ était avec ceux qui s'aventuraient en territoire ennemi, celui contrôlé par le Général Aoun, quelques dizaines de mètres au-delà de la barricade.
L'affichage ne s'est pas limité à l'espace militaire qu'étaient permanences et "portes" de la ville: les espaces publics démilitarisés qu'étaient les carrefours ont été les lieux privilégiés pour les vecteurs visuellement très efficaces que sont les affiches et les drapeaux géants, les monuments et les silhouettes. Les carrefours majeurs, dont l'importance a été définie par le nombre de voitures les traversant et par la perspective visuelle, ont fait partie de cette catégorie: la place Sassine (ou "place des Martyrs Kataëb" dans le jargon des miliciens de Beyrouth-Est) a focalisé toute la circulation d'Achrafiyyé, et a été le lieu d'affichage de portraits géants de Pierre Gémayyel guidant le peuple, ainsi le lieu d'un monument à son fils Bachîr; on y a vu également des drapeaux géants draper des immeubles entiers, ainsi que tous les espaces muraux recouverts de sigles et slogans des Forces Libanaises. Le carrefour Barbir-Basta ou le rond-point "Coca-Cola", à Beyrouth-Ouest, ont été les passages obligés depuis le centre-ville vers les banlieues méridionales: ils ont été les lieux privilégiés pour l'affichage palestinien (le camp de Sabra est à proximité), puis des Mourabitoun[13], du PSP[14], du PPS[15] de l'État libanais et de 'Amal.
Certaines voies, habituellement anonymes, ont fait l'objet d'un soin particulier au moment de quelque événement exceptionnel: défilés de soutien, axe de cortège funèbre, routes menant à un rassemblement politique important. Ces canyons urbains, dont certains ne sont que des ruelles, ont pris alors une importance momentanée que rien ne justifiait habituellement. La surcharge de messages idéologiques le long de ces axes s'expliquait par le nombre disproportionné de personnes qui devait emprunter cette voie privilégiée. Ainsi, les grands axes transurbains qui menaient au palais présidentiel de Ba`abda, le point focal des mouvements de soutien au Général Aoun entre 1989 et 1990, ont été saturés d'affiches, de portraits géants, de drapeaux, de calicots, d'autocollants, couvrant les façades des immeubles, s'enroulant autour des poteaux électriques, pendant des câbles téléphoniques, masquant les panneaux de signalisation, collés sur tous les supports, y compris les plus incongrus: pots de fleurs, pompes d'essence, cartables des écoliers. A Ba`abda même, aucun arbre n'a échappé au mouvement; toutes les clôtures, les points de contrôle d'identité, les séparations des voies étaient couverts de drapeaux, certains nationaux, d'autres des partis sympathisants au Général. D'avion, on avait l'impression de voir des faisceaux rouges, blancs et verts (les couleurs du drapeau national) converger vers le palais (BOURRE, 1990; DAVIE, 1990; RONDEAU, 1991). Au même moment (Décembre 1989 et Janvier 1990), des affiches, calicots, portraits géants etc. des Forces Libanaises guidaient les militants depuis le coeur de Beyrouth-Est et de sa banlieue vers la Quarantaine, Q.G. de cette milice, où se tenaient les contre-manifestations au mouvement du Général Aoun.
L'espace public utilisé s'est étendu aux façades, murs et clôtures érigés des deux côtés des rues et ruelles. Le cas le plus simple était celui d'un mur soigneusement enduit et peint aux couleurs de la milice locale, sigle et identification bien en vue. Ailleurs, les murs de l'espace public étaient saturés d'affiches, donnant à la longue des couches successives d'une certaine épaisseur, que les pluies ne manquaient pas de détacher. Les quelques murs épargnés par le papier ont été rapidement défigurés par des graffiti ineffaçables de tout ordre, de faire-parts que l'on ne détache pas, par respect au défunt, et par des publicités. L'ensemble des messages ne s'élevait que rarement plus haut que 2 m, la limite de l'affichage manuel; il correspondait d'ailleurs à l'altitude idéale pour s'imposer au regard.
Les devantures des magasins
Les vitrines, un des interfaces compartimentant l'espace public, ont été des lieux privilégiés pour l'affichage politique de petite dimension. Lors de campagnes d'affichage massives, les rideaux de fer et les vitrines ont été couverts de portraits et de slogans; des liasses d'affiches furent données, afin que l'intérieur soit également utilisé. Les plus enthousiastes se sont exécutés sans hésitation, et les comptoirs, l'intérieur de la porte d'entrée et autres espaces disponibles furent couverts; certains sont même allés jusqu'à placer des portraits de chefs politiques à côté de petites images pieuses que l'on trouve également dans des coins discrets des commerces. Les moins enthousiastes ont "scotché" l'affiche à l'extérieur de la porte d'entrée, ou sur la face extérieure de la vitrine, espérant que les intempéries et les actes de vandalisme (quelquefois encouragés) feraient leur travail rapidement: 24 heures étant la durée acceptable. Ces vitrines étaient généralement nettoyées très vite; les autres endroits publics mitoyens, rues, entrées de garages, etc. sont restés saturés par la nouvelle couche d'affiches; aux éventuelles questions posées par la milice sur la "disparition" des affiches distribuées à grand frais, leur pérennité à proximité immédiate était la preuve de la bonne foi des accusés.
Les voitures ont été d'excellents supports de transmission. Mobiles, elles amenaient directement le message politique au coeur de l'espace public. Lors de meetings politiques importants, lors de deuils nationaux, d'élections ou de victoires militaires, les voitures ont défilé, couvertes d'affiches collées aux capots, aux portières, aux fenêtres, et même sur une partie du pare-brise. Des calicots et drapeaux flottaient au vent, tenus par des militants quelquefois eux-même bardés d'affiches ou de portraits. Le support préféré a été le drapeau flottant au vent et des portraits des chefs collés sur la carrosserie; les slogans avaient moins d'impact (vu la vitesse de l'auto) et les graffiti refusés, le propriétaire veillant à l'état extérieur du véhicule. Par contre, les carcasses de voitures, témoins immobiles de vols, destructions et d'abandons, ont également été recherchées. Immuables, elles occupent la même place durant des mois, voire des années; trop lourdes pour être déplacées par la voirie, elles ont fait partie de l'espace visuel des Beyrouthins, et se sont lentement couvertes de couches successives de papier et de graffiti. Quelques-unes ont même fini par devenir des repères dans la ville, intégrées dans la cartographie mentale; quand elles ont été effectivement élevées (parce qu'elles bloquaient la manoeuvre de blindés, ou gênaient les quelques rares travaux d'asphaltage), la population a immédiatement perçu le vide laissé.
Les entrées des immeubles
Cet espace privé fut aussi envahi par les messages. Les affiches ont été placées également aux entrées des immeubles souvent protégées par des empilements de fûts métalliques remplis de sable servant de protection contre les obus. A l'intérieur, elles jouissaient d'un statut particulier, protégées des intempéries et d'éventuels vandales. Souvent la présence d'une affiche a servi à identifier l'appartenance du propriétaire de l'immeuble, du concierge ou de certains des habitants. Si l'analyse de l'ensemble de ces codes rend aisée la compréhension du comportement politique d'un quartier, elle l'est aussi pour planifier des actions de représailles dès que celui-ci change de maître: en effet, quand un quartier ou in îlot est occupé par une partie adverse, les opposants de ce nouvel ordre se sont désignés eux-mêmes par un affichage public sur leur espace individuel.
Quelques fois, ces affiches politiques partagent l'espace de l'entrée avec des images pieuses: dans les quartiers "chrétiens" (mais, en fait, les quartiers à majorité maronite), il n'est pas rare de voir, dans des niches idoines, de petites statues ou portraits de la Sainte Vierge, de Saint Elie ou du Christ au Sacré-Coeur; une veilleuse les éclaire en permanence, et ils sont souvent fleuris et décorés, et peuvent être entourés d'autres images d'autres saints (Saint Joseph, Sainte Thérèse, Saint Georges). Ces images pieuses s'entourent de photos d'hommes politiques, de chefs de milice ou de"martyrs", afin que la protection et la baraké[16] des saints se répande sur ces mortels. La combinatoire et la hiérarchie des affiches prend d'autant plus d'intérêt quand on sait qu'il est possible de connaître la confession de celui qui a placé ces images grâce au choix des saints et de la statuaire: une image du Saint-Coeur, de la Vierge, du Pape, de Saint Elie, signifierait une appartenance Maronite ou Grecque-Catholique; une icône de la Vierge ou une image de Saint-Georges indiquerait un Orthodoxe, bien que cette habitude soit peu répandue dans cette communauté. Pour les communautés musulmanes, cette habitude est inexistante dans les espaces publics; elle est réservée à l'intimité de la famille: des sourâtes et 'âyât du Koran, brodés et encadrés avec soin, s'entourent de portraits des proches décédés.
L'espace aérien fut également utilisé. Privilège de l'armée nationale, la seule force à posséder une aviation, qui en a profité pour déverser sur la ville des milliers d'affichettes et de drapeaux imprimés lors de moments importants. Cependant, cet atout a été vite perdu lorsque les milices ont menacé d'abattre tout aéronef de l'État survolant leurs positions ...
Si la présence de message visuel est le signe d'une occupation idéologique de l'espace, son absence a également une signification politique. Un espace privé vierge signifiait le désintérêt, le défi ou le refus de la personne ou du quartier. Tout un jeu visuel se dévoile donc à l'observateur: certains immeubles, tous étages confondus, ont étalé une appartenance politique uniforme -- par conviction, par force ou par complaisance -- couvrant leurs murs de portraits et de drapeaux. Ailleurs, seulement certains appartements se sont signalés par cet étalage; d'autres immeubles, dans des quartiers plus cossus, en étaient vierges, le concierge décapant régulièrement les entrées, les murs, les poteaux de signalisation situés à proximité...
Pas d'espaces donc sans message idéologique ou identification d'appartenance. Une exception, les cimetières et les tombes, espaces sacrés, domaine de Dieu, vierges d'affiches politiques. Pour les Chrétiens ou les Musulmans, la dernière demeure d'un grand homme politique ou d'un "martyr" ne porte aucune identification politique. L'affiche s'arrête aux portes des lieux de culte; l'espace consacré au Divin ne peut recevoir un message politique.
Après avoir effectué un inventaire des vecteurs, des lieux privilégiés de leur exposition, ainsi qu'une approximation de leur densité autour de points forts du quadrillage territorial, une constatation s'impose: mise à part la ligne de démarcation, c'est dans les banlieues que le placardage fut le plus intense. Ailleurs, la trame fut moins serrée. L'inventaire a également fait ressortir que l'espace a été couvert de façon irrégulière par les différents vecteurs. Ainsi, la "densité" d'affiches atteint son maximum autour des permanences des partis ou des milices, valeurs diminuant selon la distance à ce "noyau". On note la même diminution des messages au fur et à mesure que l'on s'éloignait des barrages de contrôle et des lignes de démarcation; certaines rues étaient vierges d'affiches, non par opposition ou défiance de la population, mais bien parce que trop loin des centres idéologiques. La grande variété des messages, ainsi que l'intensité de leur diffusion, sont des critères d'identification de territoires. Au-delà de l'analyse du contenu, indicative des courants de pensée politique, nous nous intéresserons aux relations entre l'affiche, les territoires et les pouvoirs.
A partir de 1975, le contrôle de Beyrouth s'est effectué selon un quadrillage que nous avons modélisé graphiquement (Fig. 1). Les étendues de la ville étaient polarisés autour des "noyaux durs idéologiques": permanences, casernes, bureaux, qui formaient l'équipement urbain de la milice. Leurs environs immédiats, sur approximativement une centaine de mètres, jouaient le rôle d'une enceinte protectrice, première ligne de défense de ces "citadelles" qu'étaient ces centres du pouvoir milicien: les barrages de contrôle d'identité étaient érigés, avec des chicanes ralentissant la circulation automobile. Ces abords étaient tous "sûrs", ces espaces ayant été purgés de toute opposition. Ces territoires centraux aux dimensions réduites captivaient le plus grand nombre d'affiches et encore de drapeaux. La permanence elle-même était souvent peinte aux couleurs de l'étendard de la milice, alors que les barrages de contrôle et les espaces muraux portaient les portraits du chef, sa silhouette et des drapeaux. Les bureaux administratifs et les dispensaires, le plus souvent des appartements réquisitionnés du premier étage, arboraient aux balcons des enseignes au nom du parti, affiches et graffiti ornant leurs cages d'escalier. Les casernes, quelquefois des villas isolées ou des chantiers d'immeubles interrompus, étaient ceintes de murs de sable, de cubes de béton métriques, et de conteneurs renforcés de sacs de sable; leurs entrées étaient surveillées au moyen de barrières renforcées par des positions d'armes légères et décorées par le même affichage.
Figure 1: Modèle graphique du contrôle de l'espace beyrouthin (1975-1978)
Ces noyaux, véritables centres névralgiques étendaient leur pouvoir sur une auréole de territoire large d'environ 200 à 300m et parfaitement quadrillée par les hommes du noyau: les patrouilles y étaient fréquentes, la surveillance étroite. Ce quadrillage fut rendu aisé par le terrain lui-même car l'infrastructure urbaine permettait aux milices un contrôle efficace et plutôt facile en tenant quelques lieux particuliers situés sur des artères stratégiques. Dans ce glacis protecteur l'affichage était intense, sans atteindre toutefois l'intensité du centre: au-delà d'une certaine limite d'ailleurs, les vecteurs issus du centre devenaient de moins en moins nombreux, presque inexistants. La dilution du message idéologique placardé marque bien la limite d'une zone d'influence maximale. L'auréole nous apparaît ainsi comme une partie du territoire que nous appelons "quartier milicien", équivalent à l'optimum de l'extension spatiale du message et du quadrillage possible par chaque faction. Du côté oriental de la ville, de 1975 à 1978, les auréoles appartenaient à des milices différentes, toutes "chrétiennes" certes, mais aux allégeances multiples; à l'Ouest, cela se vérifiait également, mais avec d'autres religions ou rites.
Cependant, Beyrouth était incomplètement couverte par ces cellules dures et leurs auréoles associées: dans les espaces "vides" d'affiches, les interstices entre les auréoles, apparaissait un territoire amorphe, aux appartenances mal définies. La fréquence du message visuel y était nulle, sporadique sinon peu fréquente, marquant pour les milices un désintérêt évident au niveau de la couverture militaire et idéologique. En fait, ces territoires flous étaient les rues et ruelles de connexion inter-quartiers miliciens, lieux communs à toutes les parties, y compris la population civile. Ces endroits qui ne subissaient en apparence aucune domination particulière n'étaient toutefois pas des lieux de consensus, mais de chocs; c'est là que les différentes milices mettaient régulièrement en spectacle leurs forces au moment d'un défilé militaire, par exemple, d'un enterrement ou d'une fête quelconque, en défi aux autres partis. Les artères principales étaient alors envahies par un affichage impressionant tranchant avec l'intérieur des quartiers civils qui restaient généralement calmes et insensibles aux différentes exhibitions militaires. C'est dans ces lieux aussi que la population civile s'est exprimé le mieux: loin des cellules miliciennes, elle a osé arracher les placards, les mutiler, les effacer, repeindre à neuf ou applaudir à d'autres milices de passage. C'est dans ce territoire "flou" que sont apparus les affichages clandestins, furtifs, sans stratégie territoriale, se rapprochant des "tags". Ces messages utilisaient aussi des espaces publics ou privés sans danger pour le créateur: cages d'escalier, murs en retrait, bancs d'écoliers ou d'université. L'opposition aounienne aux Forces Libanaises, à Achrafiyyé en 1989-90, s'est exprimée de cette manière.
Cet espace resté public mais restreint et à proximité de l'espace militaire était devenu duel: une partie avait été réquisitionné régulièrement par les milices, l'autre, en retrait, était le domaine des civils.
Quant à la grande ligne de démarcation entre les deux secteurs de la ville, de nombreuses positions militaires s'y alignaient parallèlement au front, allant jusqu'à former une ligne continue de casernes, de blockhaus, de dépôts, reliés entre eux par un dense réseau de boyaux, de tranchées, de passages dégagés à l'intérieur même de logements abandonnés. Ces positions étaient le lieu préféré des graffiti, oeuvres des miliciens solitaires. Un peu en retrait et à l'abri des opérations du front commençait l'affichage intensif: une population civile, nombreuse -- les déplacés -- y avait élu résidence, justifiant par là l'investissement dans les messages idéologiques pour un endoctrinement et un recrutement éventuels. Quelques rares ouvertures dans cette ligne avancée, les "portes" entre les deux secteurs de la ville, connaissaient des contrôles d'identité sévères et une circulation bloquée des heures durant. Ces points étaient signalés par une abondance de portraits, d'affiches, de sigles; aux points bien visibles par la population sortante ou rentrante étaient placés les portraits géants des chefs ou des images religieuses.
En contradiction avec cette logique d'appropriation complète et totale de l'espace urbain, l'Armée nationale n'était présente que là où les pouvoirs de facto, ceux des milices, lui avaient concédé quelque rôle mineur, tel des barrages de contrôle d'identité: ils étaient identiques à ceux des miliciens mais arboraient plutôt le drapeau national, le cèdre et le sigle de l'institution. Mais le pouvoir de l'Armée était ponctuel et il ne débordait pas en surface. Même autour des casernes[17], le pouvoir militaire ne pouvait se créer un territoire.
Les différentes administrations publiques de l'État libanais étaient en principe présentes partout sur le territoire national grâce à leurs antennes hiérarchisées: ministères, municipalités, police, etc.; elles n'occupaient que des lieux ponctuels, des sièges de pouvoirs administratifs et minimes: un ou quelques étages d'un immeuble. A ce groupe s'ajoutent des organismes non-gouvernementaux (ONG) et autres associations[18] privées, la Croix et Croissant Rouges Libanais. Ces derniers opéraient dans les deux secteurs de la ville et s'étaient aussi organisés selon le modèle des "noyaux-auréoles", bien sûr démilitarisés. Ils n'occupaient que des espaces très limités et géraient une partie de la vie quotidienne sous la contrainte du découpage milicien.
Les messages qui étaient l'oeuvre aussi bien des individus, des milices que de l'État figuraient une véritable guerre des affiches. Seules échappaient aux objectifs de celle-ci les associations civiles. Tous recherchaient une optimisation de l'efficacité visuelle, de la rapidité d'exécution et du coût. Les graffiti coûtaient peu, étaient aisés à exécuter, mais couvraient un territoire limité: ils étaient l'affiche du pauvre. Les affiches spontanés des comités de quartiers ou de groupuscules dissidents étaient le fruit de petits moyens. L'affiche, le panneau ou des portraits géants mettaient en oeuvre une organisation et un financement qui étaient l'apanage des grandes milices ou de l'État, structures militaires et économiques puissantes. Ils avaient fait appel à des professionnels pour les concevoir; les plus riches avaient leurs propres ateliers et graphistes, leurs propres imprimeries et réseaux[19] de fourniture d'encre et de papier, sans compter un personnel important pour coller, afficher, suspendre ou peindre les messages partout sur un territoire étendu. Ce type d'affichage était donc planifié et géré dans le temps et dans l'espace. Cependant, l'affichage de l'État, très pauvre pour l'effort de propagande, s'est contenté des places traditionnelles qui lui étaient réservées ou concédées: les bâtiments publics, les bureaux officiels, les ministères et quelques barrages en ville où trainaient des portraits du Président ou de petits drapeaux du pays.
Beyrouth a fonctionné selon ce schéma pendant toute la période dite "guerre de deux ans", de 1975 à 1978. Le contrôle du territoire beyrouthin s'est effectué essentiellement à partir de chaque noyau idéologique milicien vers une zone périphérique. Même si tous n'avaient pas la même appartenance ni même la même efficacité sur le terrain, ils signifiaient un morcellement et la possibilité qu'avait une faction d'exercer son pouvoir sur les rues et leur population, sans concurrence, ni contestation. Jusqu'en 1978, on voyait dans le découpage des deux secteurs de la ville une série de pouvoirs adjacents non ou mal hiérarchisés. Les partis "chrétiens" (Kataëb, Tanzîm, Harras al-Arz, Parti National Libéral, etc.) tentaient d'unifier leur action au sein du Front Libanais; en face, la partie occidentale de la ville tentait d'unifier ses rangs autour du Front National. Cependant, l'union des milices au sein d'un front élargi, qui devait contrôler un terrain nominalement mis en commun, n'était que tactique: le commandement n'était pas unifié et reposait sur une concertation et un consensus renouvelés à chaque bataille entre les différents groupes.
Cette dynamique politique et par là spatiale est un système de pouvoir qui s'explique à travers la composante humaine des milices, expression complexe de la société beyrouthine et surtout de sa distribution géographique. Il est vrai que la ville était grossièrement divisée selon le critère "Chrétien-Musulman", critère opératoire pour comprendre le partage spatial en deux secteurs: Beyrouth-Est étant à majorité chrétienne, Beyrouth-Ouest à majorité musulmane. Ce critère religieux certes nécessaire à la compréhension de la ville reste insuffisant: les deux religions n'ont pas engendré uniquement deux territoires distincts séparés par la "ligne Verte", la ligne de démarcation. S'il est vrai que dans chaque territoire, les affiches, les unes d'inspiration chrétienne, les autres musulmane, avaient identifié l'appartenance confessionnelle des miliciens, la réalité était autre et plus riche encore. En fait, chaque territoire se caractérisait par une variété confessionnelle (Maronites, Orthodoxes, Sunnites, Druzes) et une variété ethnique (Arméniens, Syriaques, 'Alaouites). La différence touchait aussi l'origine nationale ou géographique (Palestiniens, Egyptiens, Syriens) et même l'origine locale telles que le Liban-Nord, le Kesrouan, le Chouf, de villages particuliers comme Moukhtara ou Bcharré[20]. Mais les variables les plus déderminantes étaient le statut social de la population, la durée de présence en ville, la citadinité et le lieu de résidence. Couplées à l'histoire urbaine de Beyrouth, ce sont les trois dernières variables qui ont joué un rôle important quant à la répartition différenciée de la population dans les quartiers et la dynamique spécifique à chaque ensemble dans le comportement idéologique.
Figure 2: L'espace civil et le quadrillage milicien à Beyrouth (1975-1985)
Beyrouth, entre 1975 et le début des années 1980, se présentait schématiquement sous la forme de deux ceintures enveloppant un noyau central. Celui-ci, grossièment la Beyrouth-Municipe, regroupait les populations et quartiers à longue histoire urbaine et connaissait un degré de mixité élevé. A l'Est de la rue de Damas, à Achrafiyyé, à Gemmayzé, la population était en grande partie Grecque-Orthodoxe ou Grecque-Catholique, avec quelques noyaux maronites; à l'Ouest de cette ligne, elle était beaucoup plus mélangée, avec un dosage variable selon les quartiers, de Sunnites, de Chrétiens de toutes les confessions et d'étrangers arabes, européens ou américains: Basta-Moutraniyyé, Ras-Beyrouth, Hamra, Verdun, Moussaitbé, Mazraa. La population de ce noyau appartenait majoritairement à la moyenne et la haute bourgeoisie, formée de propriétaires fonciers, de commerçants, de cadres supérieurs, de membres des professions libérales, d'intellectuels, etc. La "Beyrouth Centrale" était cependant inégalement couverte par cette trame citadine. Quelques vides, tels que les quartiers de Sioufi, Mazra`a, Barbir, Hôtel-Dieu, avaient été tardivement comblés par une urbanisation liée à l'exode rural des années 1950 et rejoignaient la première ceinture périphérique. Ici, la population était essentiellement composée de salariés, de fonctionnaires, de petits artisans, citadins de la deuxième génération, occupant l'espace résiduel entre la cité et les anciens noyaux villageois de la banlieue: Ain el-Remmané, Chiyah, Tariq Jdîdé, Dekouané. Pour des raisons historiques, les populations chrétiennes étrangères à la ville s'étaient concentrées autour de la partie orientale du noyau central, les musulmanes à l'Ouest (DAVIE, 1992a), avec cependant des exceptions liées au dynamisme interne confessionnel propre des quartiers, comme à Nab`a, Moussaitbé, Berjaoui-SODECO. Au-delà, la deuxième auréole, périphérie éloignée, était habitée par des déplacés d'installation toute récente, les années 1970 et 1980. Entassé dans des quartiers spontanés, mal desservis, souvent des réfugiés de la guerre au Sud-Liban ou du Mont-Liban, ces groupements étaient confessionellement homogènes: Bir el-`Abd, Bourj al-Barajné de la "Banlieue-Sud", la périphérie de Jdaidé, d'Antélias, de Hadath. La Figure 2 n'est qu'un modèle schématisé à l'extrême. En réalité, ces trois entités spatiales n'étaient ni toujours homogènes ni aussi clairement limitées. Des interpénétrations étaient fréquentes entre îlots appartenant à l'une des trois catégories: des quartiers sous-intégrés s'étalaient à proximité de villas dans la deuxième auréole; des quartiers entiers de la première occupaient des portions de la Beyrouth Centrale; dans la première auréole, des îlots entièrement occupés par des réfugiés nouvellement arrivés côtoyaient des quartiers à population stable (NASR, 1985). La classification elle-même est à nuancer aussi, puisque la deuxième ceinture de la ville a connu une expansion extraordinaire durant la guerre, avec l'arrivée de populations de la Beyrouth Centrale et de sa première périphérie, mais aussi avec des mutations internes propres. En effet, la troisième auréole, encore semi-rurale au début des années 1970, s'est métamorphosée, tant dans sa physionomie que dans les fonctions économiques et les comportements de ses habitants, en une banlieue urbaine classique. Elle a cependant ravi à la Beyrouth Centrale l'essentiel de ses fonctions, dans un mouvement de décentralisation anarchique provoqué par les destructions au coeur de la capitale.
Le découpage proposé présente néanmoins un intérêt certain sur le plan du comportement politique de la population. Le centre était conservateur, attaché au fonctionnement efficient de l'urbs et habitué au mélange de confessions; il recherchait le compromis politique et la paix civile. La première auréole, formée de salariés venus en ville depuis une ou deux générations, maintenait des liens étroits avec le monde rural, celui du repli en temps de danger et de guerre. Leur condition sociale moyenne les rendaient soucieux de préserver leurs acquis limités; ils étaient sensibles à une vision manichéenne de l'histoire et de la société libanaise, et rejetaient les compromis politiques échafaudés autour du Pacte de 1943[21]. Quant à la deuxième périphérie, ses populations n'avaient aucune allégeance à la ville vers laquelle elles avaient été projetées lors d'affrontements militaires dans leurs régions d'origine. Ces populations n'étaient que peu intégrés dans l'histoire propre de la cité, qui les excluaient tant sur le plan social qu'économique. Extrêmement mobiles, elles changeaient de lieu de résidence au gré des conditions militaires sur le terrain: des retours temporaires vers les villages d'origine s'effectuaient quand la situation le permettait, couplé à une mobilité intra-quartiers quand des occasions se présentaient. Regroupées autour des chefs civils ou religieux de leurs villages d'origine, ces populations perduraient un mode de vie rural dans un contexte semi-urbain. C'est dans ce vivier formé par les deux ceintures périphériques et sensible aux fluctuations économiques, qu'est née la rancune, fruit des frustrations; les milices y recrutaient, proposant une idéologie basée sur la défense, la revanche et le retour.
Les comportements politiques de ces quartiers imbriqués les uns dans les autres ont créé des frictions entre les habitants respectifs: les Beyrouthins du centre et ceux de la première auréole n'ont eu aucune solidarité avec les populations de la troisième. Les comportements politiques de la population de la première auréole ont hérissé les Beyrouthins, mais étaient insuffisamment "durs" pour satisfaire la population de la périphérie externe. A l'intérieur même des deux banlieues, des tensions naissaient entre les habitants des quartiers les plus démunis et ceux jouissant d'une prospérité ou d'une stabilité socio-économique marquée.
C'est sur cette toile que les milices ont tissé leur quadrillage militaire. Nous relevons de la Figure 2 que les quartiers "civils" ne correspondaient pas partout aux quartiers miliciens découpés par les partis; l'expression du pouvoir milicien et sa relation avec la population étaient en fait différentes en ville ou dans chacune des périphéries. Il est vrai que partout à Beyrouth, la milice partisane n'avait pas été élue et qu'elle s'était imposée par la force; il reste toutefois que le degré de tolérance et d'identification de celle-ci avec la base était différent d'un endroit à un autre. L'écart entre la population civile et la population militaire est moins remarqué dans les périphéries de la cité que dans son centre, les miliciens étant majoritairement issus, du moins jusqu'à la moitié des années1980, de ces quartiers urbanisés tardivement et confessionnellement ou socialement relativement homogènes. Plus tard, d'autres facteurs ont modifié ce cadre. Quant à la population des quartiers mixtes du centre de Beyrouth, formée essentiellement de citadins de vieille souche et connaissant un niveau de vie supérieur, elle restait réfractaire aux idéaux politiques que la milice représentait. C'est d'ailleurs dans les périphéries que les placards étaient relativement plus nombreux: il fallait constamment fidéliser une population sollicitée pour les buts de la guerre et légitimer l'action des milices. Les pentes d'Achrafiyyé, coeur grec-orthodoxe du secteur chrétien, bourgeois, composé en large partie de citadins de longue date, de fonctionnaires et de cadres supérieurs, n'ont pas subi la même intensité du bombardement idéologique de la part des Kataëb et des Forces Libanaises (auxquel ils étaient hostiles) que Sioufi-Saydé, anciens quartiers mixtes certes, mais socialement inférieurs, ou que Ain el-Remmané, quartier à majorité maronite, formé de réfugiés et de citadins de première génération et à la condition sociale précaire; ces derniers ont constitué la masse des recrues des milices de la première génération. Ici, les campagnes d'affichage étaient massives, le nombre de permanences étant grand. De même, Tallet Khayyat, actuellement le coeur de la bourgeoisie sunnite, a été approché autrement que Chiyah, quartier Chi`ite pauvre de la banlieue.
A partir de 1978 , avec Bachîr Gemayel, face aux contradictions et à l'inefficacité des groupes en place, un commandement unique pour l'ensemble du secteur chrétien a été imposé, au prix d'une courte guerre intestine; le résultat en a été une concentration du pouvoir et une unité du territoire. Les territoires locaux disparates furent placés en relation hiérarchique avec le nouveau pouvoir central: la partie orientale de la ville, précédemment compartimentée entre les Kataëb, le PNL, et d'autres groupuscules, fut dominée par une organisation-mère, les Forces Libanaises, qui planifiait la stratégie, faisait exécuter les ordres, assurait la sécurité, et encadrait la société dans ce secteur de la ville. La partie occidentale de Beyrouth est restée réfractaire à l'homogénéisation totale. Toutefois, un regroupement dans des organisations plus larges s'est effectué: 'Amal, le PSP, les Palestiniens et plus tard le Hizb Allah. Mais au niveau hiérarchique inférieur, et pour les deux parties de la ville, les disparités perduraient malgré l'existence de ces manteaux idéologiques supérieurs. Ce système de pouvoir vertical portait en lui ses propres contradictions: gérant des centaines de km[2], il devait organiser la vie idéologique et militaire d'une population et s'opposait continuellement aux pouvoirs inférieurs sous-jacents, seulement tolérés, mais qui perdaient progressivement leur potentiel de contrôle sur "leurs" auréoles respectives. Les permanences locales, limitées au point de ne plus s'étendre au-delà de leurs enceintes, perdaient progressivement le potentiel de contrôle de "leurs" auréoles et ont muté en centres d'exécution de décisions émanant des forces nominales centralisatrices.
Figure 3: L'extension territoriale des forces de facto et la survivance des noyaux (1978-1990)
Cette résistance à la centralisation était manifeste à travers le contenu même des messages affichés à partir de cette période.
L'art combinatoire des affiches, au-delà de sa signification territoriale, définissait un rapport de forces entre les groupes. Dans la partie orientale de la ville, les bataillons des Forces Libanaises, répondant aux ordres personnels du Qâ'id[22] Bachîr Gémayyel, ont arboré uniquement les drapeaux de cette milice, avec des portraits de son chef. Au moment de la prise de pouvoir par Geagea, une branche moins liée à la personne du nouveau Commandant en chef a continué à afficher des portraits de Gemayyel, signifiant que ces miliciens suivaient la ligne "orthodoxe" et ne reconnaissaient pas nécessairement toutes les options du nouveau leadership, surtout si celui-ci venait d'une autre région[23]. Si les étendards des Forces Libanaises étaient associés à ceux du Parti Kataëb ou des P.N.L., cela signifiait que les miliciens de la permanence étaient d'anciens militants du Parti, mais regroupés au sein des F.L. au moment des guerres intestines de 1978. Une permanence des Forces Libanaises sans drapeaux, mais avec des affiches d'un chef de quartier ou de "martyrs" collées aux murs mitoyens signifiait une loyauté hésitante, avec un chef ayant pris la décision de faire cavalier seul, mais qui sera rappelé à l'ordre à la suite d'une occupation de "ses" locaux par la Centrale, ou par son exécution pure et simple: les quelques "séparatistes" qui ont pu survivre l'ont fait parce qu'ils étaient des chefs charismatiques de bataillons endurcis, irremplaçables sur le front[24], sinon des personnes incontournables car seules capables d'assurer la loyauté de la base.
Même l'Armée Nationale à partir de 1978 mais surtout à partir de 1984 n'a pu échaper à cette logique. Chacune de ses brigades a répondu à des allégeances différentes de celles dues à l'institution, hésitant entre un za`im, un officier supérieur ou une milice. Ainsi, un barrage arborant simplement le drapeau national appartenait à des brigades ou à des bataillons "réguliers", professionnels, assez distants de la vie politique. Plus ou moins bien équipés, mais sans les dernières acquisitions, ni un entraînement de pointe par des conseillers étrangers, ils étaient cantonnés loin du centre politique, dans des rôles tout à fait secondaires, avec l'ordre de ne pas intervenir sur le terrain. Certains bataillons ont arboré, en plus du drapeau national, des affiches de partis politiques, signifiant que tout en étant dans l'armée, ils suivaient une ligne politique bien précise définie par des miliciens. Ces combinaisons de messages visuels se sont également étendues aux véhicules: blindés, VTT et jeeps ont pu être identifiés aussi bien par l'emblème du régiment (l'appartenance militaire) que par les affiches et autres sigles (l'appartenance idéologique). Les uniformes ont joué également un rôle dans l'identification des brigades: les tenues neuves, sorties directement des entrepôts US, bottes cirées, armes standardisées et bien entretenues, munitions à profusion, signifiaient, en 1989-90, une brigade proche du pouvoir du Président Amine Gémayyel, puis du Général[ ]Aoun; les tenues bigarrées, d'un modèle ancien, des armes hétéroclites, des drapeaux effilochés, une discipline approximative, et une propension à afficher des messages politiques proches du mouvement "'Amal" a signifié que l'unité avait été écartée du noyau central de l'armée, et que les soldats ne recevaient souvent pas leur paie, qu'ils étaient considérés comme "récupérés" par la milice Chi`ite, etc. Contrairement aux milices, l'Armée ne contrôlait pratiquement pas de territoire, si l'on exclut les périmètres du Ministère de la Défense à Yarzé et du Palais présidentiel à Baabda. Cependant, l'Armée était convaincue qu'elle était partout; de son fait même, elle n'avait pas besoin de marquer l'espace supposé sien. En réalité, elle étendait un contrôle fictif sur un territoire national morcelé en entités idéologiques, chacune tolérant de manière inégale sa présence symbolique. L'Armée nationale était en attente de territoire face aux milices qui avaient fait main basse sur son terrain.
Entre 1978 et 1988, la hiérarchie du pouvoir milicien, dans la partie orientale de la ville est restée semblable malgré les changements successifs à la tête des Forces Libanaises. On est simplement allé vers un renforcement de plus en plus étroit du pouvoir central entraînant graduellement l'élimination des forces locales; ce modèle était valable également pour le secteur occidental. Ceci était définitivement visible à partir de 1984 à Beyrouth-Ouest et à partir de 1986 à Beyrouth-Est. Le renforcement progressif s'explique par une modification en profondeur du paysage sociologique de la ville. En effet, l'arrivée par vagues successives vers Beyrouth de personnes déplacées par la guerre a bouleversé la structure démographique et sociale de l'ensemble des quartiers; à Beyrouth-Ouest, les réfugiés des invasions israéliennes à répétition ont occupé l'ensemble des quartiers cossus du centre commercial de Hamra, de Verdun, de Tallet Khayyat, de Raouché, refoulant progressivement leurs habitants, chrétiens ou sunnites, vers d'autres secteurs, "ruralisant" ces quartiers, balayant leur comportement politique en le remplaçant par un autre, né dans la troisième auréole. Dans le centre-ville commercial dévasté par la guerre, ils ont occupé magasins et bureaux, les converstissant en logements ou ateliers. Dans la périphérie lointaine, la "Banlieue Sud"[25] a connu un développement spatial spectaculaire. Du côté oriental de la capitale, l'arrivée de réfugiés chrétiens chassés du Chouf[26], du Iqlîm al-Kharroub[27] ou du Liban-Nord[28] a modifié l'appartenance socio-confessionnelle de quartiers entiers: ces populations ont été installés dans les logements abandonnés de la ligne de démarcation, ou en périphérie, dans les quartiers vidés de leurs occupants musulmans en 1975-76. Les quartiers du centre bourgeois, eux, ont été "colonisés" par les familles des miliciens, leur parentèle et clientèle qui avaient progessivement réquisitionné maisons et appartements à partir de 1978. Majoritairement maronites, ces groupes aux comportements différents de ceux de la ville ont progressivement envahi les quartiers traditionnellement occupés par la moyenne et haute bourgeoisie grecque-orthodoxe assortie de Grecs-Catholiques, d'Arméniens et de Maronites, tous citadinisés de longue date, ainsi que de riches familles bourgeoises originaires de Damas, d'Alep, d'Antioche ou d'Alexandrie.
Cette transformation du cadre humain, censée en principe rappocher la population de son élite politique -- la milice --, n'a pourtant pas généré une symbiose sociale. Face à la montée de manifestations de particularismes locaux des factions miliciennes de la première génération, la direction des Forces Libanaises, sous la direction de Samir Geagea, a créé des unités spéciales de miliciens, originaires du Liban-Nord, sa région natale, qui lui étaient fidèles; elles recrutaient aussi dans les îlots de pauvreté du monde marginalisé à l'intérieur même des deux auréoles de Beyrouth-Est, écartant par là les premières vagues de miliciens installés précédemment en ville. Le quadrillage de la ville et de sa banlieue par des troupes aux allégeances lointaines a élargi de plus en plus le fossé entre la milice, l'ancienne garde et la population civile. A l'Ouest de la ville, la population chi`ite a été progressivement encadrée par des milices concurrentes, mais toutes les deux bien organisées, structurées et armées: le mouvement 'Amal et le Hizb Allah. Néanmoins, le fossé entre la population civile et les milices était beaucoup moins large qu'à l'Est, la population chi`ite se retrouvant dans ses milices, malgré quelques tensions entre populations d'origine sud-libanaise et békienne.
Parallèlement, les objectifs mêmes de la guerre ont changé: d'unités de défense de quartiers des années 1975-78, les milices se sont métamorphosées en corps politiques, militaires et financiers de grandes dimensions. De petite milice qui affirmait un rôle d'auto-défense de la "société chrétienne" , les Forces Libanaises ont évolué vers une "armée de résistance et de libération du territoire national" (SABA, 1989). L'investissement politique exclusiviste s'est accompagné d'une mainmise sans partage sur les affaires économiques du territoire sous leur contrôle. `'Amal a évolué d'un ensemble peu cohérent de deshérités chi'ites vers une force militaire contrôlant presque la moitié du Liban. Des changements à la tête, des scissions, des retournements, des recrutements différents ont profondément modifié la composition et la structure interne de celles-ci. Les messages idéologiques émis n'avaient plus de répondant, et l'écart s'élargissait entre elles et la population civile qu'elles dominaient de plus en plus sévèrement.
C'est dans ce contexte complexe, où s'imbriquaient les variables spatiales, politiques et sociales, que la dernière phase de la guerre au Liban a eu lieu. Vers la fin des années 1980, le degré de tolérance de la population civile pour les milices a dépassé le seuil critique. Dans la partie occidentale de la ville, la population a été épuisée par la lutte entre 'Amal, PSP et Hizb Allah; côté oriental, l'introduction progressive par les Forces Libanaises de mesures impopulaires fit monter la tension d'un cran supplémentaire. A Beyrouth-Est, l'idéologie des Forces Libanaises, visant à restructurer la "société chrétienne" sur un territoire confessionellement homogène mais restreint, décevait la ligne dure des Maronites, qui rêvaient de "libérer" le reste du Liban; la crise économique était imputée, en partie, aux nombreux rackets de la milice; l'ordre arbitraire inquiétait la population. Les Beyrouthins percevaient la lente colonisation de leur espace par des étrangers comme une tentative planifiée de contrôler "leur" cité, ses opportunités et ses richesses. La première auréole acceptait de très mauvaise grâce sa mise au pas en plein coeur d'une crise économique; ses quelques acquis accumulés lors des années de prospérité de l'avant-guerre avaient été réduits par le conflit militaire et la récession; les promesses répétées de batailles décisives futures l'inquiétaient, même si elle souhaitait que la milice chrétienne puisse imposer ses vues politiques sur le reste de la population. Quant à la troisième auréole, sa situation précaire a été renforcée par la crise économique et par sa mise à l'écart au profit d'unités miliciennes proches de Geagea. A l'Ouest, la situation était similaire, avec un écart moins sensible entre la population et les milices. Pour les deux côtés, les horizons étaient bouchés par des perspectives de conflits, de destructions, d'arbitraire et d'humiliation. Les populations de Beyrouth et de ses banlieues ont vu, dans l'Armée nationale et dans son chef, le Général Michel Aoun, la solution à leurs problèmes. L'Armée, à cette date, était politiquement "innocente", elle n'avait pas participé aux massacres confessionnels et n'était pas impliquée dans l'extorsion de fonds. Elle jouissait d'une certaine crédibilité quant à la libération de l'ensemble du pays. De surcroît, commandée par un officier chrétien, elle ne pouvait être soupçonnée d'aller à l'encontre des intérêts des Chrétiens du Liban.
Paradoxalement, la population appuyait là un système de pouvoir identique à celui des milices, un corps composé d'éléments tout aussi étrangers à la cité[29] et, plus grave, une force sans assise territoriale réelle. Quant à la libération du pays, il fallait commencer par l'élimination des milices, dont la chrétienne, fortement incrustée dans un espace urbain très dense, puissamment armée et sans allégeance particulière au monde urbain. Le conflit a mis aux prises deux groupes étrangers à la ville: le premier, la milice, jouissait d'une assise territoriale constamment contestée par la base, le second, l'Armée, était sans assise territoriale mais fortement appuyé par cette même base. Chaque partie se trouvait en porte-à-faux par rapport aux composantes de la population civile qu'elle prétendait défendre; finalement chacune s'est découpé un territoire, espace de survie délimité par des marqueurs similaires. L'écart grandissant entre la population et les deux forces adverses, l'une milicienne et l'autre militaire, a permis l'élimination de toutes les deux en 1990, et le retour de l'État libanais qui a promptement effacé les marqueurs précédents pour les remplacer par les siens.
Beyrouth était fragmentée, entre 1975 et1978, en micro-territoires idéologiques contrôlés, pour la plupart, par des chefs de gangs, za`im-s ou personnages charismatiques, petits tyrans s'arrogeant le droit de vie ou de mort sur la population civile. Au coeur de ces espaces miliciens élémentaires, un noyau idéologique, la permanence, la caserne. Tout autour, une auréole aux contours flous, sur laquelle l'identité et l'autorité de la milice s'exprimaient avec une intensité variable, grâce à des messages visuels: panneaux, affiches, graffiti, calicots dont l'assemblage et la combinatoire avaient permis l'identification des émetteurs. Le compartimentage milicien de la ville cachait une géographie complexe, hétérogène par l'ethnie, la confession, la nationalité, l'origine et le niveau socio-économique. Selon l'âge des quartiers, l'origine géographique et le statut social des habitants, le maillage milicien épousait avec plus ou moins de précision les contours de l'espace géographique. La population réceptrice des messages ne pouvait s'identifier aux milices que dans la mesure où ses intérêts de groupe se confondaient avec ceux des émetteurs, harmonie qui avait du mal à perdurer. La géographie politique et la géographie sociale de Beyrouth étaient en évolution conflictuelle. Les milices connaissaient des soubresauts intérieurs qui remettaient en cause la loyauté des partisans et, par extension, des groupes sociaux sous leur contrôle. A partir de 1978, dans les deux secteurs de Beyrouth, ces micro-territoires idéologiques disparates furent soumis à des organisations plus puissantes qui leur ont progressivement ôté leur particularisme identitaire qui s'exprimait encore par le jeu subtil de la combinatoire des messages visuels.
Les messages dans leur ensemble avaient pour finalité la délimitation de territoires idéologiques. Ils balisaient leurs contours extérieurs, les interfaces avec les espaces idéologiques adverses; cependant, le marquage était tout aussi nécessaire à l'intérieur même de ces espaces, car il fallait constamment fidéliser ou neutraliser la population. L'appartenance idéologique était imposée; changer de quartier impliquait un changement d'allégeance et l'acceptation d'un nouvel ordre politique. La population était en quelque sorte l'otage du "prince", chef de milice, qui affirmait, grâce à l'affichage, l'étendue de son domaine et le bouclait au moyen de barrages de contrôle, véritables "portes" de quartier.
Comme toute publicité moderne, l'affiche à Beyrouth joua un rôle commercial -- on "vend" une idéologie. L'originalité ici réside dans le fait qu'elle fut, au delà de son rôle de marquage d'espace politique, l'affirmation d'un pouvoir personnel. Les messages n'exprimaient pas un programme, ils étaient l'expression de l'étendue d'un pouvoir associé, dans tous les cas, à la personne du chef. Les territoires étaient alors moins des espaces idéologiques que des espaces de subsistance au profit du "prince" et de sa cour. Le marquage fut donc le moyen obligé pour délimiter des zônes d'exploitation économique des lieux comme des hommes, au profit des gangs au pouvoir. Les taxes, les contributions et les rançons prélevées enrichissaient ces groupes qui s'étaient retrouvés, à la fin des années 1980, au sommet de la pyramide économique, concurrençant efficacement les anciennes familles, les entreprises et l'État (DAVIE, 1991).
L'origine sociale, confessionnelle et géographique des miliciens et de leurs chefs peut aider à expliquer cette fragmentation territoriale propice au pillage. Les milices sont nées et se sont développées en milieu semi-rural (le Haut-Metn, le Kesrouan, le Sud-Liban) et en périphérie de Beyrouth (Ain al-Remmané, Bourj-Barajneh, Chiyah, Dekouané, Nab`a). Symptomatiquement, le conflit libanais a commencé dans les marges de Beyrouth et s'est nourri par les migrations venues des périphéries nationales. Il a mis aux prises des milices issues de populations confessionnellement différentes mais de condition sociale identique. L'extension des combats vers le coeur de la ville, moteur économique du pays, eut comme résultat le contrôle de l'ensemble de l'urbs par les milices (BEYHUM, 1991). Les Beyrouthins de longue date n'ont pas participé aux combats. Victimes, ils perdirent leur puissance économique et leur place politique avec l'effondrement de la cité et la remise en question de son rôle de création et de distribution de richesses lié à l'activité portuaire et aux services bancaires. La périphérie qui a phagocyté le centre, n'a pas pu mettre en place de nouvelles structures de production; elle s'est contentée de vivre sur des revenus illicites, des rackets et de la spéculation foncière ou monétaire. Une crise économique profonde s'est progressivement installée durant les années 1980, justifiant une mainmise de plus en plus serrée sur les territoires de l'ensemble des groupes de pillage issus des différentes échelles de la milice. Le marquage devenait alors avec le temps impératif, surtout en période de mouvance des interfaces liée aux évolutions de la conjoncture locale ou régionale. Les affiches ont suivi la "topographie des lieux de crise ... et ont épousé les contours de l'événement" (HABIB, 1986;40).
BEYHUM, Nabil, 1989: L'organisation de la vie quotidienne d'un quartier de Beyrouth-Ouest; habitants, commerçants, miliciens. Maghreb-Machrek, 125, juill-sept. 1989, pp. 100-116. BEYHUM, Nabil, 1991: Espaces éclatés, espaces dominés: étude de la recomposition des espaces publics centraux de Beyrouth de 1975 à 1990. Thèse de Doctorat en Sociologie, Université Lyon 2-Lumière. 2 vols, 795 p. BOURRE, J-P., 1990: Génération Aoun. Vivre libre au Liban. Paris, Robert Laffont, 1990, 237 p. CHAKHTOURA, Maria, 1978: La guerre des graffiti. Liban 1975-1978. Beyrouth, Editions Dar an-Nahar, s. p., bilingue (Arabe-Français). DAVIE, M.F., 1992a: "Beyrouth-Est" et "Beyrouth-Ouest": aux origines du clivage confessionnel de la ville. Les Cahiers d'URBAMA (Tours), 8, 1992 (sous presse). DAVIE, M. F., 1992b: Demarcation Lines in Beirut. Routledge, London, et International Boundaries Research Unit, University of Durham, 1992 (sous presse). DAVIE, M.F., 1991: Les circuits parallèles à Beyrouth. in: "Reconstruire Beyrouth, les paris sur le possible". Etudes sur le Monde Arabe, 5, 1991, pp. 157-193. Lyon, Maison de l'Orient . DAVIE, M.F., 1983: Comment fait-on la guerre à Beyrouth? Hérodote, 29-30, 1983, pp. 17-54. DAVIE, May, 1990: Aoun ou le refus chrétien. Liban: octobre 1989-janvier 1990. Les Temps Modernes, 536-537, 1990, pp. 147-180. HABIB, Tania, 1986: Les graffiti de la guerre libanaise, 1975-1983. Annales de Sociologie et d'Anthropologie (Université Saint-Joseph, Beyrouth), 2, 1986. NASR, S., 1985: La transition des Chiites vers Beyrouth: mutations sociales et mobolisation communautaire à la veille de 1975. in: Mouvements communautaires et espaces urbains au Machreq, CERMOC, Beyrouth, pp. 87-116. RONDEAU, D., 1991: Chronique du Liban rebelle. 1988-1990. Paris, Grasset, 186 p. SABA, Karol, 1989: La sécurité et la liberté des Chrétiens dans le discours des Forces Libanaises. Mémoire de Maîtrise, Beyrouth, Université Saint-Joseph, 1989, 157 p. TABET, J., 1986: Beyrouth et la guerre urbaine: la ville et le vide. Peuples méditerranéens, 37, 1986.
Michael F. Davie Mars 1992
[*] Département de Géographie, Université François-Rabelais, Tours et Laboratoire CNRS Associé 365 "URBAMA" (Urbanisation du Monde Arabe), 23, rue de la Loire, 37023 Tours Cédex (France). [1] Appelés "Chokolaré", de l'italien "circolare"= note circulaire. [2] La division de la ville en deux entités confessionnellement distinctes est une invention des média, libanais et étrangers. Ce géographisme repose sur une interprétation simpliste d'une réalité géographique autrement plus complexe. Il a cependant eu un succès certain au point où "Beyrouth-Est" est devenu synonyme non seulement de la partie orientale de la ville, mais également de tout le territoire, beyrouthin ou non, contrôlé par les milices des Forces Libanaises, et par extension ("l'Est politique") la position idéologique de celle-ci. "Beyrouth-Ouest" ou "l'Ouest politique" regroupe les notions sous-entendues de territoire, de formations miliciennes et d'idéologie de "gauche", ou musulmanes. A Beyrouth même, la ligne de séparation des deux entités est le front militaire, qui serpente au coeur de la ville, suivant un tracé imposé par les hasards de la guerre. [3] Chef politique, leader, homme charismatique. [4] Durant les différentes phases de guerre urbaine, les faire-parts étaient presque toujours ceux de miliciens ou de militaires; pourtant de nombreux civils ont également péri, sans que leur disparition soit signalée. [5] Superficie du Liban, référence à un discours de Bachir Gémayyel qui préconisait la libération de tout le Liban, de chaque kilomètre carré) [6] Date du début du génocide des Arméniens, en 1917, par les autorités turques. Cette date apparaît sur tous les murs, à cette date, sous la forme de graffitis et d'affiches, mais exclusivement dans les quartiers à dominante arménienne. [7] Parti fondé par l'Imam Chi`ite Moussa al-Sadr, qui "disparut" en Libye en 1981; il a été dirigé depuis cette date par Nabih Berri. "Amal" signifie "espoir". [8] Il est curieux de noter que presque tous les monuments, statues ou bustes de la période d'avant 1975 ont été détruits ou volés durant la guerre. Quant à ceux érigés durant la guerre, ils n'ont survécu que si le territoire de leur installation n'a pas changé de maître: sinon, ils étaient les premiers symboles du pouvoir précédent à être détruits. [9] Texte que le nombre grandissant d'analphabètes ne pouvait déchiffrer... [10] La symbolique était claire: seule la milice est en mesure d'assurer la netteté, la propreté et un espace visuel contrôlé dans une ville qui serait vouée, sans elle, à l'anarchie totale n'était-ce ces îlots d'ordre. [11] Ces immeubles, les "tours" de Beyrouth, étaient utilisés par tous les combattants, militaires comme miliciens, comme points d'observation et de direction des tirs, leurs sous-sols servant de dépôts de munitions. La "Tour Rizk" et la "Tour Abou-Hamad" étaient situées dans la partie orientale de la ville, la "Tour Murr" dans l'occidentale; tous les deux ont été sérieusement endommagées par les tirs réciproques. [12] "Kabella" en arabe, de l'italien Capella = chapelle. [13] Milice dirigée par Ibrahim Qolaylât, des Nasseriens Indépendants. [14] Parti Socialiste Progressiste [15] Parti Populaire Syrien, ou PSNS [16] Bénédiction [17] Ce sont des casernes construites par l'Armée Française entre 1920 et 1945, et ayant pour but de ceinturer la ville sur son flanc méridionnal; depuis cette date, l'expansion de la ville les a englouties dans la trame urbaine. [18] Association de la défense des droits de l'Homme, Association des Industriels, des Commerçants etc. [19] Souvent en relation avec des "ports parallèles", euphémisme pour désigner les ports appartenant aux milices et échappant ainsi au contrôle de l'État et des services de la Douane et de la Perception. [20] Respectivement fiefs du clan Joumblatt et de Geagea. [21] Le "Pacte de 1943" était un compromis oral agréé par les chefs politiques chrétiens et musulmans autour du partage du pouvoir à la veille de l'Indépendance du pays; il établissait le cadre du partage du pouvoir entre les différentes communautés. [22] "Le chef", le commandant en chef d'une milice. [23] Les loyautés étaient très souvent basées sur le territoire d'origine: des bataillons et régiments des Forces Libanaises, formés d'éléments du Nord du Liban, ont suivi Samir Geagea, parce que lui-même venait de Bcharré, village du Nord. D'autres ont suivi les membres de la famille Chamoun, car originaires du Chouf. L'animosité entre groupes "régionaux" a quelquefois dégénéré en conflit ouvert, chaque groupe tentant d'occuper le territoire de l'autre, là où cela était possible, c'est-à-dire en ville; l'occupation des régions d'origine était impossible pour les groupes adverses. [24] Les "Tioûs" (= les têtus, les obstinés) tenaient le passage du Musée; les Syriaques constituaient le noyau dur de certaines brigades très proches du Quartier-Général des Forces Libanaises. Les Syriaques sont venus au Liban d'Irak, fuyant persécution politique et misère. Sans nationalité libanaise, ils se sont entassés dans des camps de fortune; alléchés par des promesses d'intégration et d'acquisition de la nationalité libanaise, ils se sont enrôlés dans la milice "chrétienne". [25] Géographisme inventé par les média pour désigner l'ensemble des quartiers Chi`ites au Sud de la ville, s'étalant de part et d'autre de l'ancienne route de Saida et longeant les pistes de l'aéroport. [26] Territoire Druze d'où les Chrétiens ont dû fuir à la suite de la débâcle de l'occupation de la région par les Forces Libanaises. [27] Enclave chrétienne située au Nord de Saida; tenue puis perdue par les Forces Libanaises. [28] Région à majorité chrétienne, d'où les sympathisants des Kataëb et des Forces Libanaises ont été contraints de partir à la suite de l'assassinat, par un commando des Forces Libanaises, du fils de l'ex-président Franjiyyé. [29] Les brigades "chrétiennes" sous les ordres du Général Aoun étaient recrutées dans les villages du Nord-Liban, notemment Qobbayât, ou des régions rurales du centre du pays. Comme pour les milices, les recrues étaient de souche rurale. |
 al@mashriq 960325/960614 |